-

Traitement de l’erreur purement matérielle : droit à l’erreur ou rigueur, telle est la question
Par Baptiste JAFFRE, Avocat collaborateur
Le 13/02/2025
TA Nîmes, 28 janvier 2025, société Froid Cuisine Hérault, n°2405036
Est-il possible d’ajouter 100 m² de cloisons oubliées par erreur dans le cadre d’une demande de précisions au titre d’une offre potentiellement anormalement basse ? Non, répond le Tribunal administratif de Nîmes.
Les faits
Dans le cadre la passation d’un lot « cloisonnement et faux plafonds isotherme » la communauté de communes de Petite Camargue relevait que la proposition financière de la société Froid Cuisine Hérault divergeait sensiblement de ses estimations puisqu’elle se trouvait inférieure de 28% par rapport à son évaluation et de 23% par rapport à l’offre de l’attributaire et lui adressait dès lors une demande de précisions et de justifications conformément aux dispositions de l’article L.2152-6 du code de la commande publique relatif au traitement des offres anormalement basses.
Point important à souligner, la demande de la communauté de communes imposait à la société « de ne pas modifier les caractéristiques substantielles de – son – offre (dont le montant et les quantités chiffrées) en réponse à la présente demande et de – s’- en tenir à la justification du montant de – son – offre et à la réponse aux questions ».
Or, dans sa réponse, la société requérante faisait valoir qu’elle avait omis, par erreur, 100 m2 de cloisons. Aussi, elle décidait d’ajouter la surface manquante mais sans toutefois modifier son prix global et forfaitaire.
La question qui se posait était donc celle de savoir si, sur le fondement de l’existence d’une erreur purement matérielle, la société requérante pouvait modifier son offre sans pour autant porter atteinte au principe d’intangibilité des offres.
Sur le fond
D’emblée, on rappellera qu’au titre d’une jurisprudence désormais établie, l’erreur purement matérielle se définit comme une erreur tellement grossière qu’aucune des parties ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi (CE, 26 novembre 1975, société Entreprise Py, n° 93297).
Dans un arrêt plus récent, le Conseil d’Etat a par exemple admis que la correction d’un prix de 22 € à 220 € ne visait qu’à la rectification d’une erreur purement matérielle et que cette modification ne portait pas atteinte au principe d’intangibilité des offres (Conseil d’État, 21 septembre 2011, Département des Hauts-de-Seine, n° 349149).
Dans la mesure où, si elle était établie, le principe d’une erreur matérielle est qu’aucune partie ne peut s’en prévaloir de bonne foi, on peut légitimement en déduire que, lorsqu’un acheteur décèle l’existence d’une possible erreur matérielle dans l’offre d’un candidat, il doit la mettre en mesure de la rectifier, à plus forte raison si ce candidat dispose de chances sérieuses de l’emporter.
En ce sens, il ressort par exemple de la jurisprudence « Département des Hauts-de-Seine » précitée du Conseil d’Etat que l’acheteur qui élémine l’offre d’un candidat, laquelle contient une erreur matérielle sans l’avoir mis en mesure de la corriger, manque à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
En l’espèce, la communauté de communes de Petite Camargue s’étonnait du prix de la société Froid Cuisine Hérault qui était sensiblement inférieur à son estimation. Aussi, elle la sollicitait afin d’obtenir un complément d’informations tout en lui indiquant dans sa demande qu’elle ne devait en aucun cas modifier les caractéristiques essentielles de son offre et de s’en tenir à l’apport des réponses sollicitées.
La société requérante, sous l’impulsion de l’acheteur, s’aperçoit alors en réexaminant son offre qu’elle a omis 100 m2 de surface de cloisons.
Constatant son erreur, la société requérante décide par conséquent d’ajouter à son offre technique les surfaces manquantes mais sans modifier son prix, décidant sans doute de prendre à sa charge les conséquences de son erreur dans une démarche commerciale et de bonne foi.
Elle ne s’attendait probablement pas à ce que sa démarche conduise à l’exclusion de son offre.
En effet, en ayant ajouté les surfaces manquantes mais sans modifier son prix global et forfaitaire, il a été estimé qu’elle avait alors irrégulièrement modifié son offre et ainsi méconnu le principe d’intangibilité de l’offre :
« En ajoutant ainsi, sans y avoir été invitée par le pouvoir adjudicateur qui lui avait, au contraire, expressément interdit d’y procéder, une quantité de métrés qui ne figurait pas dans son offre initiale, sans en modifier le prix global et forfaitaire, la société Froid Cuisine Hérault ne s’est pas bornée à rectifier une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où son offre aurait été retenue mais l’a complétée en méconnaissance du principe d’intangibilité de l’offre »
Autrement dit, dans une réalité alternative, sa modification aurait pu être acceptée si elle avait également ajusté son prix en fonction des surfaces ajoutées.
Si la solution retenue par le Tribunal administratif marque une application stricte du principe d’intangibilité de l’offre, on peut toutefois s’étonner, voire regretter, que la formulation de la demande d’informations et de justifications adressée par la communauté de communes de Petite Camargue n’ait pas d’avantage été débattue.
En effet, et même si l’ordonnance ne donne pas une lecture complète de cette demande, force est d’admettre que sa formulation très restrictive a sans doute jouer un rôle sur la réponse apportée par la société requérante qui a sûrement cru qu’elle ne pouvait pas modifier son prix même si elle corrigeait les quantités afin « de ne pas modifier les caractéristiques substantielles » de son offre.
En tout état de cause, on peut s’étonner qu’il n’ait pas été davantage recherché dans quelle mesure la communauté de communes de Petite Camargue n’a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne mettant pas explicitement la société Froid Cuisine Hérault en mesure de corriger son erreur, à plus forte raison dès lors qu’elle en eu confirmation, au travers de la réponse apportée par cette dernière, de l’existence d’une erreur présentant toutes les caractéristiques d’une erreur purement matérielle.
-

« 1% Logement » : ne pas être à jour de vos obligations au 31 décembre vous condamne à payer plus de 4 fois la note initiale
Par Margaux TRIPIER, Avocate collaboratrice
Le 06/02/2025
Le ton quelque peu racoleur de cet article appelle un démenti introductif : le terme « 1 % logement » désigne la participation à l’effort de construction (PEEC) due par les employeurs depuis sa création en 1953.
En effet, si l’expression persiste, le taux initial de 1% a sensiblement été réduit, depuis 1992, à 0,45% de la masse salariale.
Ainsi, tout employeur de plus de 50 salariés doit consacrer 0,45 % de sa masse salariale brute au profit de :
- la réalisation d’ « investissements directs » en faveur des salariés, sous forme de prêts ou de constructions et réhabilitations de logements locatifs ;
- et/ou aux versements à Action Logement de prêts sans intérêts ou de subventions ; à charge alors pour cet organisme de délivrer à l’employeur un reçu attestant du caractère libératoire du versement (c. constr. et hab. art. R. 313-6).
Les employeurs ont jusqu’au 31 décembre de l’année N, au titre des salaires versés en N-1, pour réaliser ces différents investissements et peuvent, le cas échéant, reporter l’excédent éventuel sur les exercices suivants (c. constr. et hab, art. L313-1 4e al.).
A défaut de réaliser de tels investissements dans ce délai, les employeurs sont alors assujettis à une cotisation au taux majoré de 2 % à raison des salaires pour lesquels l’obligation d’investissement n’a pas été respectée (c. constr. et hab. art. L. 313-4 ; CGI art. 235 bis, anc.).
Ainsi, cette cotisation est due par les employeurs qui se sont « abstenus » – pour reprendre les termes de l’administration dans sa doctrine – de procéder aux investissements auxquels ils étaient tenus ou qui ont effectué des versements insuffisants.
Et, les abstentionnistes ayant toujours torts, c’est donc bien 4,44 fois l’investissement initialement dû (et non simplement « le double » comme à l’origine, lorsque le taux initial était de 1%) que les employeurs doivent alors s’acquitter spontanément avant le 30 avril de l’année N+1 (c. constr. et hab. art. L. 313-4 et R. 313-3).
Ainsi, pour reprendre l’exemple fourni par Action Logement : « la pénalité appliquée à un versement de 10.000€ le fait passer à 44.444€. »
Or, cette « abstention » n’est pas de facto une omission volontaire mais résulte bien plus raisonnablement – au vu de l’enjeu financier de cette « pénalité » – d’une simple erreur qui s’avère particulièrement coûteuse pour l’employeur de bonne foi.
En effet, pour prendre le cas typique d’exigibilité de la cotisation exposé par l’administration fiscale :
- la participation due par les employeurs doit faire l’objet d’investissements pour une durée de vingt ans (sauf le cas de la subvention) ;
- l’employeur n’a alors pas la libre disposition des fonds avant l’expiration de ce délai, et ce, même si les prêts consentis aux salariés ou Action Logement ont une durée inférieure à ce délai ;
- l’employeur a alors l’obligation de réinvestir pour la période restant à courir les remboursements perçus dans les trois mois de leur perception ou au plus tard le 31 décembre de l’année civile (c. constr. et hab. art. R. 313-9 du CCH ; BOI-TPS-PEEC-40-20141218, §120).
Ainsi, ne pas avoir pris les mesures pour réinvestir ces sommes dans ce court laps de temps assujettira l’employeur à la cotisation de 2% sur les remboursements perçus.
Par ailleurs, l’employeur sera également soumis à cette cotisation si les investissements ne respectent pas les formes ou les conditions fixées par la réglementation tels que :
- des prêts consentis à un taux supérieur à 3 % ou pour une durée inférieure à cinq ans ;
- ou encore la réalisation d’une construction directe financée sans autorisation préalable du préfet.
Enfin et surtout, tout versement simplement tardif de participation, même seulement quelques jours après le 31 décembre, justifie, ipso facto, l’exigibilité de la somme majorée du coefficient de 4,44.
Le contribuable malencontreux pourra alors vivre cette situation comme une injustice, qui plus est à l’heure de la promotion du « droit à l’erreur ».
Pourtant, la jurisprudence française affirme itérativement que la cotisation de 2 % ne constituerait pas une « sanction ayant le caractère d’une punition » (voir ég. TA de Paris, 1re section – 3e chambre, 19 juillet 2024, n° 2210736 : pour un refus d’application du droit à l’erreur pour la cotisation de 2%).
Or, par là-même, la jurisprudence dénie donc au contribuable la protection de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et notamment, le principe de proportionnalité des peines.
Les juges ont pu tenter de justifier leur position en arguant que :
- l’administration se bornerait à constater « l’option exercée » par le contribuable de ne pas procéder au versement libératoire ;
- et que la cotisation due résulterait donc de la stricte application des règles fixées par la loi « sans aucune appréciation » de l’administration fiscale (CAA Douai, Ministre de l’Economie, c/ SA FACON, 26 juillet 2001, n°98DA01709).
Si l’on peut (doit ?) se réjouir que les juges confirment que l’administration fiscale se doit de respecter la loi ; l’on peine à y trouver une justification du refus de qualification de « sanction » de ce seul fait, qui plus est dans un Etat de droit…
Surtout, peut-on raisonnablement affirmer qu’un contribuable auquel la cotisation est réclamée a postériori par l’administration fiscale, a délibérément « opté » pour payer 4,4x plus que l’addition, aussi noble que soit la cause de l’amélioration de l’habitat des salariés ? Sachant à ce titre, que la cotisation alors due au Trésor, au contraire des participations supplémentaires versées volontairement par les employeurs, n’alimente pas le fonds pour le logement géré par Action Logement (c. constr. et hab. art. L.313-19-2).
Pourtant, et alors même qu’Action Logement qualifie elle-même la cotisation de « pénalité » (cf. supra), les sages de la rue de Montpensier ont, depuis, et sous un angle différent, validé la solution des juges du fond. Or, là aussi, le raisonnement emprunté peine tout autant à nous convaincre tant il tend à la pétition de principe.
Ainsi, selon le Conseil constitutionnel, la cotisation de 2% ne constituerait pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais simplement un impôt dans la mesure où :
- son fait générateur se situe au 31/12 de l’année suivant les versements ;
- et qu’elle possède son propre arsenal punitif : à savoir, qu’à défaut d’un versement spontané, la cotisation est passible des majorations applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires (Cons. const., 13 janv. 2011 , Décision n° 2010 – 84 QPC SNC Eiffage Construction Val de Seine).
Or, l’assiette des participations et de la cotisation sont strictement les mêmes, à savoir, les salaires versés en année N-1.
Et, pour un même fait juridique (le versement des salaires), la seule circonstance que le fait générateur d’une somme (la cotisation) soit, comme tout manquement justifiant l’exigibilité d’une sanction pour retard de paiement, le non-versement d’une autre somme (les participations) à l’expiration d’un délai initial confirme, au contraire, selon nous, la qualification de sanction de cette seconde somme.
Les participations et la cotisation étant toutes deux exigibles du fait de la loi (et au sein du même code depuis 2020), le fait qu’elles soient recouvrées par deux entités distinctes – à savoir Action Logement en tant que « subvention », puis l’administration fiscale en tant qu’ « impôt » – ne saurait justifier davantage la position adoptée par les juges (c. constr. et hab. art. L.313-4, substituant l’article 235 bis du CGI).
En effet, faut-il le rappeler, la qualification de « sanction » ne saurait être évitée par le seul fait qu’un Etat a a adopté un arsenal juridique « non pénal » pour sa répression.
Surtout, selon la jurisprudence elle-même, le propre d’une sanction est d’empêcher la réitération des agissements qu’elle vise et de ne pas avoir pour seul objectif la réparation d’un préjudice pécuniaire.
Or, le constat apparait ici sans appel :
- Si l’on paye au plus tard au 31 décembre : aucun supplément ;
- Si l’on paye, même spontanément, à compter du 1er janvier : mauvaise pioche au UNO, soit « x 4,44 » ;
- Et si l’on a la « mauvaise idée » de penser en toute bonne foi être « quitte » vis-à-vis du Trésor, notamment du fait d’avoir réceptionné un « reçu libératoire » d’Action Logement pour un paiement de la participation initiale légèrement en retard, et qu’on ne souscrit pas la déclaration spéciale avant le 1er avril : le malheur ne frappant jamais seul, soit +10% pour défaut de déclaration.
Peut-on raisonnablement affirmer que le préjudice de l’Etat (au sens large, dans le sens où l’obligation de versement à Action Logement ressort bien d’une exigence légale) lié au passage du nouvel an doit être réparé par l’application automatique et minimum d’un coefficient de plus de 4 ?
Et, le fait de se retrouver à payer le quadruple de la somme initiale n’a-t-il pas vocation à inciter le contribuable à être, à l’avenir, très vigilant dans la réalisation des investissements dus au titre de la PEEC ?
Mais, d’aucuns plus sachants soulignaient déjà bien avant nous l’équivoque de la position du Conseil constitutionnel entre les notions d’impôt incitatif et de « réelle » sanction : « lorsque le législateur édicte un impôt dans le but explicite de dissuader un comportement donné, […] la stigmatisation fiscale de certains actes a pour fonction d’empêcher la commission ou la réitération de certains actes, ce qui constitue précisément la définition de la sanction au sens du droit constitutionnel » (Daniel GUTMANN, « Sanctions fiscales et Constitution », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 33, Dossier : le Conseil constitutionnel et l’impôt, octobre 2011).
Au cas particulier de la PEEC, cette ambiguïté conduit à un résultat pour le moins contre-intuitif, notamment pour l’employeur qui aurait un doute sur la détermination de l’assiette des rémunérations assujetties : il est en fait préférable de payer plus d’abord – et sécuriser ainsi un taux de 0,45% – pour être sûr de ne pas payer beaucoup plus après – et ainsi éviter la quadruple peine du taux de 2%.
Or, même dans une telle hypothèse d’un surplus de participation, l’employeur voulant alors récupérer l’indu versé au taux de 0,45% se devra d’être vigilant. En effet, la jurisprudence considère que cette somme n’a pas la nature d’une « créance fiscale » et son remboursement ne peut donc être réclamé devant le juge de l’impôt (CAA Douai 23-10-2018 n° 17DA00662, SAS Sopres Interim ; CAA Lyon, 5e ch. – formation à 3, 9 juin 2022, n° 20LY00384).
De sorte que dans l’hypothèse d’un versement spontané mais tardif à Action Logement quelques jours après le 31 décembre, l’employeur se retrouvera dans une situation de :
- défaut de versement en année N ;
- et de trop versé en N+1 (versement tardif de l’année N en début d’année N+1 et versement dû pour l’année en cours) ;
- et sera, partant, passible d’une cotisation de 2% sur la totalité des salaires versés en N-1.
Et, l’administration fiscale au titre du contrôle de l’année N ne tiendra pas compte de ce trop versé qui ne pourra donc être compensé avec les rappels notifiés par cette dernière.
De sorte que force est, à nouveau, de constater que vigilance est de mise pour les employeurs dans la réalisation de leur obligation d’investissements. Mais, fort heureusement des moyens de contestation subsistent pour tenter de réduire, le cas échant, l’addition particulièrement salée pour les contribuables se retrouvant devoir acquitter cette « cotisation » majorée.
-

L’opérateur unique et les critères d’exclusivité : La CJUE affine les conditions de la procédure négociée sans publicité
Par Myriam GAL, Avocate collaboratrice
Le 31/01/2025
Dans cet arrêt, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté des précisions sur les conditions de recours à une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.
En 1992, le ministère des Finances tchèque, devenu depuis DGF, a signé un contrat avec IBM World Trade portant sur la création d’un système d’information pour l’administration fiscale.
En 2016, près de vingt ans plus tard, la DGF a attribué à IBM République tchèque un marché portant sur la maintenance de ce système via une procédure négociée sans publicité préalable. IBM République tchèque est une filiale dont l’associé unique est IBM World Trade.
La DGF a justifié le recours à cette procédure en s’appuyant sur l’article 31, point 1 sous b) de la directive 2004/18 qui prévoit :
« Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics en recourant à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché dans les cas suivants :
1) dans le cas des marchés publics de travaux, de fournitures et de services : […]
b) lorsque, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, le marché ne peut être confié qu’à un opérateur économique déterminé ; […] ».
Dans cette décision, ce choix a été justifié par des raisons tenant à la « continuité technique entre le système d’information en cause et sa maintenance post-garantie ainsi que par des raisons tenant à la protection des droits d’auteur exclusifs de IBM Česká republika […] sur le code source de ce système. En effet, conformément aux stipulations du contrat initial, cette société est le titulaire des droits de licence pour ledit système. » (Point 11 de la décision).
L’attribution du marché sans publicité ni mise en concurrence a été contestée par l’autorité de la concurrence tchèque qui reprochait à la DGF de ne pas avoir démontré :
- d’une part, que le marché ne pouvait être exécuté que par cet opérateur pour des raisons techniques et ;
- d’autre part, que la nécessité de protéger des droits exclusifs est en réalité une conséquence directe du comportement de la DGF.
De son côté, la DGF a fait valoir que la situation d’exclusivité résulte du fait qu’en 1992, IBM World Trade était le seul opérateur en capacité de fournir le service informatique.
Par ailleurs, la DGF précise « qu’elle aurait tenté de se libérer de sa « dépendance » à l’égard de IBM Česká republika, mais que cette dernière l’aurait informée de sa volonté de ne pas transférer les droits d’auteur patrimoniaux sur ce code source. À défaut d’opter pour la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, ledit système d’information aurait été inutilisable et l’administration fiscale n’aurait pas pu mener à bien sa mission. En outre, lancer une procédure de passation de marché public de fourniture d’un nouveau système d’information pour l’administration fiscale tchèque ne serait pas raisonnable sur le plan financier. » (Point 16 de la décision).
C’est donc dans ce contexte que la CJUE a été saisie d’une demande d’interprétation de l’article 31, point 1 sous b) de la directive 2004/18 (Cette directive a été abrogée. C’est désormais l’article 32 de la directive 2014/24 UE qui prévoit le recours à une procédure négociée sans publication préalable et l’article R.2122-3 du Code de la commande publique).
La CJUE a rappelé que le recours à une procédure négociée sans publicité préalable devait avoir un caractère exceptionnel. Pour rappel, ce recours est soumis à deux conditions cumulatives :
- L’existence de raisons techniques, artistique ou tenant à des droits d’exclusivités ;
- Ces raisons ne permettent de recourir qu’à un seul opérateur.
Sur cette seconde condition, il revient au pouvoir adjudicateur de prouver qu’il a mené des « recherches sérieuses » afin d’identifier d’autres opérateurs capables de réaliser les prestations (Point 30 de la décision).
Pour la CJUE « un pouvoir adjudicateur est tenu de faire tout ce qui est susceptible d’être raisonnablement attendu de lui pour éviter l’application » de cette procédure.
Elle précise qu’une interprétation trop large de l’article 31, point 1, sous b), pourrait compromettre les objectifs des règles de l’Union Européenne en matière de marchés publics, à savoir la libre circulation des produits et services ainsi que l’ouverture des marchés publics à la concurrence dans tous les États membres :
« tenir compte exclusivement de la différence des libellés de l’article 31, point 1, sous b), et de l’article 31, point 1, sous c), de la directive 2004/18 pourrait aboutir à méconnaître, d’une part, la nécessité d’interpréter strictement l’article 31 de cette directive et, d’autre part, l’objectif principal des règles de l’Union en matière de marchés publics, à savoir la libre circulation des produits et des services ainsi que l’ouverture des marchés publics à la concurrence dans tous les États membres » (Points 28 et 29 de la décision).
Selon les conclusions de l’avocat général, l’article 32 de la directive 2014/24 prévoit que le recours à un opérateur unique pour des raisons techniques ou de droits d’exclusivité ne doit pas résulter d’une restriction artificielle des paramètres du marché par le pouvoir adjudicateur.
Bien que l’article 31 de la directive 2004/18 soit silencieux sur l’imputabilité de la restriction de la concurrence au pouvoir adjudicateur, cela n’autorise pas ce dernier à « créer lui-même la situation d’exclusivité » (Point 40 des conclusions de l’avocat général).
A cet égard, la Cour indique que l’imputabilité « s’apprécie sur la base non seulement des circonstances de fait et de droit entourant la conclusion d’un contrat portant sur une première prestation, mais également de toutes celles qui caractérisent la période allant de la date de cette conclusion à celle à laquelle le pouvoir adjudicateur choisit la procédure à suivre pour la passation d’un marché public subséquent » (Point 39 de la décision).
En outre, l’avocat général constate qu’ « il ne ressort pas de la décision de renvoi que le pouvoir adjudicateur ait sérieusement tenté de trouver de nouveaux fournisseurs lui permettant de débloquer la situation de dépendance dans laquelle il se trouvait » (Point 64 des conclusions de l’avocat général).
Cette solution s’explique notamment par les objectifs suivants :
- Le caractère exceptionnel du recours à une procédure négociée sans publicité préalable, a pour finalité de garantir l’ouverture à la concurrence.
- Éviter que des pouvoirs adjudicateurs ne créent eux-mêmes des situations d’exclusivité, vidant ainsi de son sens l’exception prévue par la réglementation.
- Interpréter strictement les modalités de recours à cette procédure.
La CJUE conclue en indiquant que c’est à la juridiction de renvoi de vérifier si la DGF, disposait « de moyens réels et raisonnables du point de vue économique pour mettre fin à cette situation d’exclusivité au cours de ladite période avant de décider d’avoir recours à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché » (Point 38 de la décision).
En résumé, cette décision précise que, outre le respect des critères légaux, les restrictions ne doivent pas être attribuables au pouvoir adjudicateur.
Ainsi, pour recourir à une procédure négociée sans publicité préalable, un pouvoir adjudicateur doit démontrer l’existence de raisons techniques, artistiques ou d’exclusivité justifiant le recours à un opérateur déterminé, sans que ces raisons ne lui soient imputables.
-

Autorisation d’urbanisme : la procédure de participation du public désormais exigée pour les projets situés dans le périmètre de certaines installations Seveso
Par Emmeline BOITEL, Avocat collaborateur
Le 27/01/2025
Décret n° 2024-1256 du 30 décembre 2024 modifiant le code de l’urbanisme
Le décret n° 2024-1256 du 30 décembre 2024 a mis en conformité le code de l’urbanisme avec l’article 15 de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Ce décret complète le code de l’urbanisme d’un nouvel article R. 423-58-1 lequel soumet à l’organisation d’une procédure de participation du public les constructions, travaux, aménagements et installations soumis à permis de construire ou d’aménager situés dans le périmètre de certaines installations Seveso, et qui sont susceptibles, par leurs caractéristiques ou leur localisation, d’aggraver le risque ou les conséquences d’un accident majeur.
La participation du public est organisée préalablement à la délivrance des autorisations d’urbanisme par le maire ou le président de l’EPCI lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l’EPCI et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l’État, selon les modalités prévues au II de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement.
La soumission d’un projet à participation du public a pour effet de majorer d’un mois le délai d’instruction de droit commun des permis de construire et d’aménager qui est de trois mois (article R423-24 f) du code de l’urbanisme).
Les nouvelles dispositions de l’article R. 423-58-1 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.
L’objectif est de renforcer la transparence et l’implication des citoyens dans les décisions relatives aux projets présentant des risques environnementaux ou industriels.
-

Les conditions de la condamnation in solidum de coresponsables
Par Célia TESSIER, Avocate collaboratrice
Le 09/12/2024
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 octobre 2024, 23-15.152
Par un arrêt rendu le 3 octobre 2024, la Cour de cassation rappelle que la condamnation in solidum de deux coresponsables ne peut aller au-delà de la partie du préjudice à la réalisation duquel ils ont contribué de manière indissociable.
En l’espèce, des travaux de construction d’une maison ont été suspendus en raison de fissures apparues sur un mur.
Les acquéreurs ont, après expertise, assigné le constructeur, son assureur ainsi que l’assureur du vendeur en indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels.
Pour accueillir les demandes d’indemnisation des acquéreurs, les juges du fond ont retenu que : « les désordres provenaient d’une poussée importante à laquelle le mur ne pouvait pas résister et que cette contrainte résultait de la mise en place de remblais sur une hauteur de 2,40 mètres par le constructeur qui au lieu d’évacuer les gravats lors des travaux de terrassement et décaissement, les avait concassés et réutilisés sur place, sans réaliser le drainage prévu au contrat. »
En second lieu, les juges du fond ont retenu que le vendeur « avait eu connaissance des conclusions d’un expert judiciaire selon lesquelles le mur litigieux ne pouvait être utilisé en fonction de soutènement qu’avec une faible hauteur de remblais » et que ce dernier « n’avait pas transmis aux acquéreurs cette information substantielle au regard de la configuration du terrain et que cette omission avait privé ces derniers de ne pas acquérir le bien ou de l’acquérir à un prix moindre. »
La Cour d’appel de Montpellier a jugé que le constructeur et le vendeur avaient contribué à la réalisation de l’entier dommage subi par les acquéreurs de sorte que leurs assureurs respectifs étaient tenus in solidum de les indemniser du montant total de leurs préjudices matériels et immatériels.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt rappelant que la condamnation in solidum de deux responsables, dont l’un répond de l’entier préjudice et l’autre d’une perte de chance, ne peut être prononcée qu’à concurrence de la partie du préjudice de la victime à la réalisation duquel les coresponsables ont l’un et l’autre contribué de manière indissociable.
En vertu de l’ancien article 1147 du Code civil, devenu 1231-1 du Code civil, et des principes régissant l’obligation in solidum et la réparation intégrale du préjudice, il appartenait aux juges du fond de limiter la condamnation de l’assureur du vendeur, in solidum avec l’assureur du constructeur, à hauteur de la perte de chance.
-
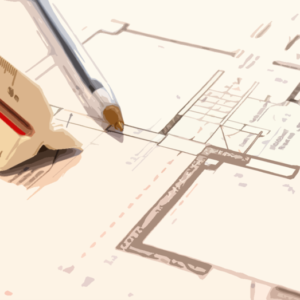
Quand la non-conformité aux plans engage la responsabilité de l’architecte
Par Margaux BEUREY, Avocate of counsel
Le 27/11/2024
Cass. Civ. 3ème du 7 novembre 2024, n°23/12315
Par un arrêt en date du 7 novembre 2024, la Cour de cassation est venue renforcer la responsabilité de l’architecte titulaire d’une mission de maitrise d’œuvre complète en matière de conformité de l’ouvrage.
En l’espèce, une SCCV avait confié à un architecte la maitrise d’œuvre complète de la construction d’un immeuble. Constatant un déficit de surface substantiel dans un lot vendu après achèvement entre la surface prévue dans les plans et l’ouvrage effectivement réalisé, le maitre d’ouvrage a assigné le maître d’œuvre en indemnisation de son préjudice.
La Cour d’appel de Bordeaux (1er décembre 2022) a rejeté la demande d’indemnisation de la SCCV au motif que le maitre d’œuvre n’avait reçu aucune mission complémentaire de mesurage des existants ou de calcul des superficies (loi Carrez), de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché un manquement dans l’exercice de ses missions.
Cependant, la Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l’article 1147 du Code civil (nouvellement 1231-1), considérant que, indépendamment d’une obligation de mesurage de l’ouvrage achevé, l’architecte en charge de la direction de l’exécution des contrats de travaux et d’assister le maître de l’ouvrage aux opérations de réception des travaux est tenu de s’assurer que la construction est conforme aux plans qu’il avait élaborés.
L’architecte est donc tenu d’une obligation essentielle de garantir la conformité de l’ouvrage aux plans contractuels. Cette responsabilité est indépendante de l’existence d’une mission complémentaire spécifique de mesurage et ne peut donc être atténuée ou réduite contractuellement de quelque manière que ce soit.
Dès lors, le manquement à cette obligation de conformité peut entraîner l’indemnisation d’une perte de chance, en particulier lorsque des éléments probants laissent à penser que la vente du bien aurait pu se réaliser à un prix supérieur, en l’absence de cette non-conformité.
En effet, selon la Cour de cassation le maître de l’ouvrage peut réclamer l’indemnisation d’un manque à gagner résultant de la non-conformité de l’ouvrage aux prévisions contractuelles si celle-ci est imputable à un locateur d’ouvrage. Nul besoin d’une certitude quant à l’ampleur exacte du préjudice pour que la réparation soit dûment envisagée.
Par cette décision, la Cour de cassation renforce donc le périmètre des obligations des architectes en matière de conformité contractuelle et consacre l’indemnisation en cas de perte de chance, même non établie de manière certaine.
Une aubaine pour les maitres d’ouvrage en cas de rédaction hasardeuse de leur contrat…
-

Délai de prescription en matière contractuelle : la Cour de cassation confirme le point de départ à la livraison des matériaux
Par Anne RENAUX, Avocate collaboratrice
Le 14/11/2024
Cass. 3e Civ. 3 octobre 2024, n°22-22.792
Par un arrêt rendu en date du 3 octobre 2024, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation a retenu que le délai de prescription de l’action contractuelle directe du maître d’ouvrage, fondée sur le manquement au devoir d’information et de conseil, court à compter de la livraison des matériaux à l’entrepreneur.
En l’espèce, deux SCI qui ont souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non-réalisateur, ont entrepris la construction d’un groupe d’immeubles, constitué de deux résidences à destination de logements, commerces et bureaux, à vendre en l’état futur d’achèvement.
Les constructeurs en charge du lot « charpente métallique » et du lot « serrurerie » étaient respectivement chargés de la fourniture et de la pose de lames brise-soleil et de garde-corps.
La réception de ces deux résidences a eu lieu les 5 juillet 2004 et 9 novembre 2005.
Se plaignant de l’apparition de dégradation et de pelage sur lesdits garde-corps et lames brise-soleil, le syndicat des copropriétaires de l’une des résidences a, par actes des 25 novembre 2013, 15 janvier, 3 et 4 mars 2014 assigné en référé-expertise le promoteur, et les constructeurs puis, par acte du 22 octobre 2014, l’assureur dommages-ouvrage.
Par actes des 20, 26 juin et 1er juillet 2014, l’assureur dommages-ouvrage a assigné au fond plusieurs locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, étant précisé que l’un de ces locateurs d’ouvrage a appelé en cause le fabricant de ces matériaux.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 novembre 2015.
Par conclusions régularisées le 11 août 2016, le syndicat des copropriétaires, intervenu volontairement à l’instance, a sollicité réparation de ses préjudices, et formulé des demandes à l’encontre du fabricant des matériaux litigieux en se fondant sur le manquement à son devoir de conseil.
Néanmoins, la Cour d’appel de Toulouse a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables pour prescription, considérant que l’action dirigée par le syndicat des copropriétaires contre le fabricant de matériaux avait expiré le 19 juin 2013, soit 5 ans après la date d’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi, aux termes duquel ce dernier a soutenu que le point de départ de son délai d’action, régi par l’article 2224 du Code civil, court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer une action à l’encontre du fabricant des matériaux litigieux. Le syndicat des copropriétaires n’a pas manqué de se prévaloir du fait que le rapport expertal a été déposé le 17 novembre 2015, lequel a permis de conclure à un défaut de fabrication des panneaux litigieux, se révélant sous l’effet du rayonnement solaire et des intempéries.
La Troisième Chambre Civile a rejeté ce moyen du pourvoi en rappelant tout d’abord que « le délai de prescription de l’action contractuelle directe du maître de l’ouvrage contre le fabricant, fondée sur le manquement au devoir d’information et de conseil, court à compter de la livraison des matériaux à l’entrepreneur (3e Civ, 7 janvier 2016, pourvoi n°14-17.033 publié) ».
La Troisième Chambre Civile a ensuite souligné que « le délai de prescription de dix ans, prévu à l’article L.110-4,I du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ayant été réduit, par celle-ci, de dix à cinq ans, la cour d’appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que les matériaux litigieux avaient été livrés à l’entrepreneur les 30 janvier 2004, 20 avril et 3 juin 2005, en a justement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et la prescription de dix ans, en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, étant régie par les dispositions transitoires de son article 26, II, que celle-ci expirait le 19 juin 2013 et que l’action des syndicats des copropriétaires engagée contre la société Prodema le 25 novembre 2013 était, par conséquent, prescrite ».
La Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel avait légalement justifié sa décision, en retenant que l’action du syndicat des copropriétaires courait à compter de l’entrée en vigueur de la loi précitée, soit le 19 juin 2008, et que cette action d’une durée quinquennale était prescrite au 19 juin 2013.
Manifestement, le syndicat des copropriétaires n’a pu que regretter que l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ait significativement réduit le délai de prescription de l’action de 10 à 5 ans, empêchant la sienne de prospérer, alors que les matériaux litigieux ont été livrés les 30 janvier 2004, 20 avril et 3 juin 2005.
Il convient de rappeler que la loi du 17 juin 2008 a pour objet de simplifier et de clarifier le régime des prescriptions civiles, une simplification et une clarification qui ne semblent pas si évidentes à l’aune de cet arrêt.
-

Un montage contractuel impliquant la conclusion d’une promesse d’achat et d’une convention de subvention en vue de la réalisation d’un ouvrage requalifié en marché de travaux
Par Rémi JABAKHANJI, Avocat collaborateur
Le 08/11/2024
CJUE, 17 octobre 2024, NFŠ a. s./République slovaque, Aff. n° C-28/23
La Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») a jugé qu’un ensemble contractuel liant un pouvoir adjudicateur à un opérateur économique, composé d’un contrat de subvention et d’une promesse d’achat pour la réalisation d’un stade de football, répondant aux besoins formulés par le pouvoir adjudicateur, constitue un marché public de travaux, compte tenu notamment de son caractère synallagmatique (critère de l’onérosité).
i. Caractéristiques et contestation de la régularité du montage contractuel
En vue de réaliser le projet de construction du stade national de football, le ministère de l’Éducation slovaque a conclu, sans mise en concurrence, avec la société Národný futbalový štadión (devenue « NFŠ »), une convention de subvention définissant les conditions d’octroi et les conditions de construction de l’ouvrage.
À l’appui de cette convention de subvention, le ministère de l’ Éducation s’est engagé à verser à la société NFŠ une subvention de 27 200 000 € tirée du budget de l’État en vue de procéder à la construction dudit stade. La société NFŠ s’est quant à elle engagée à financer au moins 60 % des coûts de la construction.
Trois ans plus tard, le ministère de l’Éducation a conclu (en tant que futur acquéreur), avec la société NFŠ (en tant que futur vendeur), une promesse d’achat fixant les conditions de la conclusion du contrat de cession du stade national de football slovaque. La CJUE relève que cette promesse d’achat comprenait, dans ses annexes, des spécifications techniques détaillées et les paramètres matériels de ce stade.
La Cour note par ailleurs qu’un avenant ultérieur à la convention de subvention a supprimé la possibilité prévue au profit du Slovenský futbalový zväz (Fédération slovaque de football), d’utiliser gratuitement certains locaux du même stade.
L’entrée en vigueur effective de la promesse d’achat était subordonnée au respect de certaines conditions suspensives, dont le constat, par la Commission, que la subvention et cette promesse constituent une aide d’État compatible avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
Dans une décision datant de 2017, la Commission européenne a constaté que tel était le cas^1 .
Cela étant, la convention de subvention et la promesse d’achat ont fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires. La société NFŠ a notamment introduit une demande visant à établir le contenu de la promesse d’achat en ce qui concerne la détermination du prix d’achat, afin d’exercer l’option, prévue en sa faveur par cette promesse, de vendre le bâtiment construit.
À cette occasion, la société NFŠ a fait valoir que la promesse d’achat est valable et ne constitue pas un marché public, car elle n’établit pas une obligation exécutoire de réaliser des travaux, dès lors qu’il ne constitue pas un contrat à titre onéreux.
Au contraire, le ministère de l’Éducation soutient que ce montage doit être qualifié de marché public, dès lors que :
- le contrat de subvention et la promesse d’achat constituent un ensemble complet de droits et d’obligations réciproques, qui vise intentionnellement, en raison de l’absence de mise en concurrence, à contourner la législation slovaque applicable en matière de marchés publics ;
- en particulier, la promesse d’achat aurait un caractère onéreux, manifesté par les modalités de détermination du prix d’achat qu’elle prévoit (eu égard aux conditions de fixation du prix d’achat de l’ouvrage) ;
- le ministère a exercé une influence déterminante sur le projet du stade national de football slovaque qui, en vertu du contrat de subvention, doit répondre :
o aux exigences de l’UEFA sur l’infrastructure des stades ;
o aux exigences supplémentaires fixées par l’intermédiaire de l’organe de direction suprême de ce projet, le comité de pilotage et de suivi pour la construction de ce stade, au sein duquel il était majoritairement représenté.
ii. L’examen de l’ensemble contractuel et la requalification en marché de travaux
Premièrement, la Cour confirme l’interprétation de la juridiction de renvoi selon laquelle le contrat de subvention et la promesse d’achat présentent un lien matériel et temporel (malgré les trois années séparant leur conclusion), et constituent un cadre d’obligations réciproques entre le ministère de l’Éducation et NFŠ. Il s’agit donc effectivement d’un ensemble contractuel.
En effet, le contrat de subvention comporte une obligation à la charge de l’État d’octroyer la subvention prévue ainsi qu’une obligation à la charge de NFŠ de construire le stade national de football slovaque conformément aux conditions spécifiées par le ministère de l’Éducation et de permettre à la Fédération slovaque de football d’en utiliser une partie.
La promesse d’achat établit quant à elle, au bénéfice de NFŠ, une option unilatérale de vente correspondant à une obligation pour l’État d’acheter le bâtiment construit.
Deuxièmement, de manière générale, on rappellera en synthèse que la requalification d’un contrat ou d’un ensemble contractuel en tant que marché public pourra être prononcée par la juridiction compétente si deux conditions cumulatives sont remplies :
- Le contrat (ou l’ensemble de contrats) a pour objet de répondre au besoin d’un (ou plusieurs) pouvoir(s) adjudicateur(s) : en matière de travaux, cette condition est qualifiée par l’existence d’une influence déterminante sur la nature ou la conception de 〖l^′ ouvrage〗^2 ;
- L’existence d’une contrepartie onéreuse à la réponse de ce besoin (caractère synallagmatique du contrat).
Troisièmement, la Cour de justice s’est livrée à l’analyse de ces deux conditions s’agissant de l’ensemble contractuel résultant de la promesse d’achat et de la convention de subvention.
D’abord, s’agissant du premier critère de l’influence déterminante : les juges soulèvent que l’ouvrage devait être construit selon les spécifications formulées par le ministère de l’Éducation, ce qui pourrait traduire, sous réserve de vérifications à opérer par la juridiction de renvoi, une influence déterminante de la personne publique sur le stade à construire.
Ensuite, s’agissant de la seconde condition de l’onérosité, la Cour rappelle dans l’affaire commentée que :
« 44 D’une part, selon la jurisprudence de la Cour, l’expression « à titre onéreux » désigne un contrat par lequel chacune des parties s’engage à réaliser une prestation en contrepartie d’une autre. Le caractère synallagmatique du contrat est ainsi une caractéristique essentielle d’un marché public, qui se traduit obligatoirement par la création d’obligations juridiquement contraignantes pour chacune des parties au contrat, dont l’exécution doit pouvoir être réclamée en justice (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2020, Tax-Fin-Lex, C‑367/19, EU:C:2020:685, points 25 et 26 ainsi que jurisprudence citée).
45 À cet égard, il convient de relever que, lorsqu’un contrat comporte une obligation d’achat par un pouvoir adjudicateur sans qu’une obligation de vente ne pèse sur son cocontractant, cette absence d’obligation de vente ne saurait nécessairement suffire pour exclure le caractère synallagmatique de ce contrat et, partant, l’existence d’un marché public, une telle conclusion ne pouvant être, le cas échéant, atteinte qu’à la suite de l’examen de l’ensemble des éléments pertinents. »
L’appréciation du caractère onéreux résulte donc d’une analyse casuistique à laquelle s’est livrée la CJUE.
A l’issue de cette étude, la Cour estime ainsi que l’ensemble contractuel présente un caractère synallagmatique, et qu’il est donc conclu à titre onéreux, dès lors que :
1° le ministère de l’Éducation s’est engagé à verser à son cocontractant une subvention en contrepartie de la réalisation de l’ouvrage.
2° L’intérêt économique de la personne publique est également caractérisé par le fait que le transfert de la propriété du stade à des tiers est subordonné au consentement préalable écrit de l’État, lui conférant, en substance, un droit de préemption sur l’ouvrage.
3° La promesse d’achat constitue une garantie contre les risques commerciaux pour la société NFŠ puisqu’« en s’engageant à acheter ce stade à la demande de NFŠ, le pouvoir adjudicateur a assumé l’intégralité des risques en cas d’échec économique de l’ouvrage ».
Partant, la Cour a qualifié la promesse d’achat et la convention de subvention en cause de marché public de travaux, dès lors que l’ensemble « crée des obligations réciproques entre cet État et cet opérateur économique, qui incluent l’obligation de construire ce stade conformément aux conditions spécifiées par ledit État ainsi qu’une option unilatérale au bénéfice dudit opérateur économique correspondant à une obligation pour le même État d’acheter ledit stade, et octroie au même opérateur économique une aide d’État reconnue par la Commission comme étant compatible avec le marché intérieur ».
〖^1〗 Décision SA.46530, du 24 mai 2017 (JO 2017, C 354, p. 1).
〖^2〗 CJCE, 25 mars 2010, Helmut Muller Gmbh, C-451/08, point 67.
-

Agrivoltaïsme : point sur les dernières décisions intervenues en la matière
Par Damia KACETE, Avocate collaboratrice
Le 29/10/2024
N.B. Ces décisions ont été rendues sous l’empire de la législation antérieure à la loi APER et au décret du 8 avril 2024. Elles portent sur des projets réputés agrivoltaïques (ombrières ou serres agrivoltaïques) mais qui ne répondent pas nécessairement à la définition des « projets agrivoltaïques » issue du code de l’énergie.
1. Zone agricole : les installations doivent être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole (TA Orléans, 23 mai 2024, n° 2303308).
Dans cette décision, le tribunal administratif d’Orléans met en lumière les caractéristiques permettant de considérer qu’un projet agrivoltaïque maintient de manière significative l’exercice d’une activité agricole sur le terrain où il est implanté.
Pour rappel, en application de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, les installations photovoltaïques en zone agricole doivent être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées.
Pour déterminer ce caractère compatible, il convient d’appliquer la jurisprudence constante du Conseil d’Etat en la matière selon laquelle le projet doit permettre l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, (i) au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, (ii) en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux (CE 8 février 2017, Photosol, req. n° 395464, publié au Recueil).
Dans cette décision, le tribunal administratif d’Orléans rappelle tout d’abord que les dispositions de l’article L. 151-11 n’imposent pas le maintien d’une activité agricole identique à celle existant avant la mise en œuvre du projet.
Il considère ensuite que doit être regardé comme permettant le maintien d’une activité agricole significative – et donc comme étant compatible avec l’exercice d’une activité agricole – le projet dans lequel :
- les panneaux photovoltaïques occupent 33% de l’emprise du site agricole ;
- les panneaux photovoltaïques occupent 33% de l’emprise du site agricole ;
- le reste des parcelles est dédié à une activité d’élevage s’inscrivant dans une filière locale existante, nonobstant le fait que l’exploitation ovine concernée n’était pas préexistante à l’implantation des panneaux ;
- une convention d’engagement a été signée entre l’exploitant de l’installation, le collectif d’agriculteurs, la chambre d’agriculture et un nouvel éleveur, attestant de l’installation, grâce à ce projet, de cet éleveur pour renforcer les exploitations agricoles de la commune.
2. Zone de montagne : les installations doivent être nécessaires à l’activité agricole au sens de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme (TA Lyon, 19 sept. 2024, n° 2311036)
Ici, la décision du tribunal administratif de Lyon illustre un cas dans lequel un projet d’ombrières agrivoltaïques est regardé comme nécessaire à l’activité agricole, au sens des dispositions de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme relatif aux zones de montagne.
Selon ces dispositions, de telles installations ne peuvent être autorisées que si elles sont assimilées à des « constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ».
Le tribunal reconnait ce caractère nécessaire au projet agrivoltaïque en cause, malgré un avis défavorable de la CDPENAF, compte-tenu de ce qu’il était établi, à la fois par l’étude d’impact et par des études portant sur d’autres projets agrivoltaïques :
- les effets bénéfiques de l’ombrage des panneaux solaires sur les pelouses et prairies destinées aux pâturages (en particulier, la réduction de la température lors d’épisodes de fortes chaleurs, améliorant ainsi le bien-être animal en limitant le stress physique et thermique ; une augmentation de la mise à l’herbe du troupeau, notamment lors des périodes de forts ensoleillements ; la protection des brebis à l’égard des prédateurs ; ou encore l’amélioration agronomique du sol) ;
- que le déplacement des bovins actuellement présents sur le terrain d ‘assiette du projet sur d’autres parcelles ne remettait pas en cause le maintien ou le développement de cette activité.
Le tribunal précise par ailleurs que sont sans incidence sur ce constat l’absence au dossier d’un projet de convention avec un organisme reconnu en matière de suivi agronomique, ou d’autorisations d’exploitation des agriculteurs.
3. Zone inondable : les installations situées en zone d’aléa résiduel, non soumise à des règles limitatives par le plan de prévention des risques d’inondation, ne peuvent être refusées sur le fondement d’un risque pour la sécurité publique (TA Nîmes, 18 juin 2024, n° 2302743)
Dans cette décision le tribunal administratif de Nîmes rappelle tout d’abord qu’un refus de permis motif pris d’un risque pour la sécurité publique (art. R. 111-2 du code de l’urbanisme) ne peut être opposé que s’il n’est pas légalement possible d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de l’installation aux dispositions de l’article R. 111-2.
Le tribunal constate ensuite que le projet de serre agrivoltaïque en cause est situé en zone d’aléa résiduel par le PPRI applicable et que le règlement de cette zone ne prévoit aucune règle limitative quant à la construction de serres.
Il conclut ainsi que « compte tenu de l’objet du projet et du risque d’inondation résiduel, il n’est pas établi que le projet en litige présenterait un risque à la sécurité publique ou encore une aggravation d’un éventuel risque d’inondation ».
4. Agrivoltaïsme et référé-liberté (TA Nîmes, 2 sept. 2024, n° 2403355)
Le tribunal administratif de Nîmes constate l’absence d’urgence extrême à suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA, les travaux d’implantation de persiennes agrivoltaïques jusqu’à ce que le préfet se prononce sur la demande de dérogation d’espèces protégées compte tenu, d’une part, de l’absence de caractérisation du caractère sensible de l’environnement dans lequel s’implante le projet et, d’autre part, de l’absence d’incidences fortes de celui-ci sur cet environnement.
5. QPC : Absence de caractère sérieux des griefs soulevés à l’encontre de la loi APER (CE 3 oct. 2024, n° 494941)
Dans cette décision, le Conseil d’Etat rejette la QPC soulevée à l’encontre de l’article 54 de loi n°2023-175 du 10 mars 2023, dite loi APER, à l’occasion du contentieux toujours en cours d’instruction portant sur le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers.
Plusieurs griefs étaient soulevés :
- l’absence de dispositions spécifiques destinées à éviter ou à limiter l’artificialisation des sols dans le cadre de l’implantation de parcs photovoltaïques sur des espaces naturels, agricoles ou forestiers ;
- l’absence de dispositions spécifiques destinées à prémunir les agriculteurs contre les effets néfastes des ondes électromagnétiques émises par les installations photovoltaïques qu’ils seraient amenés à implanter ;
- l’absence d’obligation générale de garanties financières ;
- l’absence de dispositions spécifiques de nature à limiter les atteintes à la biodiversité ;
- l’absence de mécanisme de prévention du risque d’incendie spécifique à l’implantation des installations agrivoltaïques.
Le Conseil d’Etat considère, au terme de cette décision, que l’ensemble de ces griefs tiré de la méconnaissance des 1er, 3 et 5 de la Charte de l’environnement ne revêt pas de caractère sérieux compte tenu, notamment, des dispositions suffisantes propres à cette loi assurant la réversibilité, le démantèlement et la remise en état aussi bien des installations agrivoltaïques que des installations « agricompatibles », et des autres dispositifs législatifs de droit commun.
-

Respect des servitudes aéronautiques : l’inertie de l’Etat et de l’exploitant est de nature à engager solidairement leur responsabilité
Par Baptiste JAFFRE, Avocat collaborateur
Le 07/10/2024
CAA Marseille, 3 juin 2024, consorts E, n°22MA02459
Un arrêt particulièrement intéressant a été rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille le 3 juin dernier sur la question du respect des servitudes aéronautiques et sur l’étendue des obligations à la charge de l’Etat et de l’opérateur en charge de l’exploitation d’un aéroport.
Pour rappel, il résulte des dispositions de l’article L.6351-1 du code des transports[1] que :
« Des servitudes spéciales, dites servitudes aéronautiques, sont créées afin d’assurer la sécurité de la circulation des aéronefs.
Ces servitudes comprennent :
1° Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l’interdiction de créer ou l’obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l’intérêt de la navigation aérienne ;
2° Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l’obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l’identification ou de supporter l’installation de ces dispositifs. »
En ce qui concerne en particulier les servitudes aéronautiques de dégagement, celles-ci se matérialisent visuellement par des figures géométriques décrivant, dans l’espace, les zones devant être libres d’obstacle pour permettre le décollage et l’atterrissage des avions en toute sécurité :
[Schéma extrait de « Aérodrome de Grenoble – Isère – servitudes aéronautiques – Note annexe – 03/2016 »]
Conformément aux dispositions de l’article R.6351-7 du code des transport l’approbation du plan de servitudes aéronautiques de dégagement est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d’Etat pour un aéroport d’intérêt national ou international, ou par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile pour les autres aérodromes, le cas échéant pris conjointement avec le ministre de la défense pour les aérodromes dont le ministère de la défense est le principal affectataire.
En pratique, il n’est pas rare que certains obstacles percent des servitudes aéronautiques de dégagement (arbres, installations d’éclairage urbain…). Dans cette hypothèse, l’article R.6351-15 du code des transports[2] dispose que :
« Lorsque les servitudes instituées par le plan de servitudes aéronautiques de dégagement impliquent, soit la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, soit une modification de l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, la mise en œuvre des mesures correspondantes est subordonnée dans chaque cas à une décision du ministre chargé de l’aviation civile pour les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l’aviation civile ou du ministre de la défense pour les aérodromes affectés à titre principal au ministère de la défense. »
Dans le cadre de l’affaire jugée par la Cour administrative de Marseille, un avion léger s’était écrasé le 27 mars 2010 à l’aéroport Napoléon Bonaparte d’Ajaccio lors de son atterrissage. L’enquête a permis d’établir qu’un groupe d’arbres était situé sur un terrain compris dans une zone de servitude aéronautique et que l’avion a percuté un arbre qui « n’aurait pas dû être là » et que cette collision constituait la « cause déterminante de l’accident » à l’exclusion de toute autre. En effet, l’instruction a permis d’écarter toute autre cause potentielle telle qu’un facteur météorologique, une défaillance mécanique ou une erreur de pilotage. Sur ce dernier point, il a d’ailleurs été considéré que même si la trajectoire adoptée par le pilote n’était pas conforme aux recommandations d’approche, cette circonstance était sans effet sur le lien de causalité entre la faute et le dommage dès lors qu’en tout état de cause l’arbre qui a été heurté n’aurait pas dû se trouver sur la trajectoire de l’avion compte tenu de l’existence d’une servitude aéronautique.
D’emblée, il convient de noter que si la responsabilité pénale de la CCI de Corse du Sud, en sa qualité d’exploitant de l’aéroport, a pendant un temps été recherchée pour homicide involontaire, une ordonnance de non-lieu a finalement été rendue par le TGI de Bastia le 22 juin 2020 confirmée par la Cour d’appel de Bastia le 14 avril 2021. Or, conformément à la notion d’autorité de la chose jugée des juridictions pénales, cette ordonnance est sans conséquence sur la possibilité de rechercher la responsabilité de l’exploitant et de l’Etat devant les juridictions administratives dès lors qu’elle ne constitue pas une décision ayant statué sur le fond de l’action publique.
Cela étant précisé, se posait ensuite la question de l’imputabilité de la faute.
Sur le fondement de l’article D.242-1 du code de l’aviation civile[3] applicable lors des faits, la Cour explicite la répartition des rôles entre l’Etat et l’exploitant d’aéroport au sujet des servitudes aéronautiques. Ainsi, s’il appartient à l’Etat d’imposer des travaux aux propriétaires de terrains concernés par des servitudes aéronautiques, elle déclare toutefois qu’il ne résulte pas des dispositions applicables qu’il reviendrait à l’Etat d’assurer l’entretien de ces servitudes.
En l’espèce, l’instruction a démontré que l’Etat avait effectivement notifié à la CCI de Corse du Sud le percement des servitudes aéronautiques par les arbres litigieux dès 2007, soit trois ans avant l’accident.
En ce qui concerne le rôle de la CCI de Corse du Sud en qualité d’exploitant, l’instruction a, de son côté, relevé qu’elle s’était limitée à adresser un simple courrier à la direction régionale des forêts, en novembre 2008 soit plus d’un an avant l’accident, qui avait alors indiqué qu’elle n’était pas compétente et qu’il appartenait à l’exploitant de contacter directement les propriétaires concernés.
Compte tenu des actions jugées plutôt limitées entreprises tant par l’Etat que par l’exploitant pour résoudre la question du percement de la servitude aéronautique, la Cour reprochait à l’Etat de ne pas s’être « assuré que ses signalements avaient été suivi d’effets » et considérait que l’exploitant « ne saurait se retrancher derrière la circonstance que les terrains en cause se trouvaient en dehors de la zone aéroportuaire dès lors que certains des arbres implantés sur ces terrains perçaient la servitude aéronautiques » et « qu’il lui appartenait de contacter les propriétaires des terrains sur lesquels ces arbres perçant la servitude étaient implantés ».
Au regard de ce qui précède, la Cour en a conclu que les appelants étaient « fondés à rechercher la responsabilité solidaire de l’Etat et de la chambre de commerce et d’industrie de Corse du Sud en raison de leur inertie à ne pas s’assurer que la servitude aéronautique était dégagée de tout obstacle ».
Cette conclusion appelle plusieurs commentaires.
Tout d’abord, sur la responsabilité solidaire de l’Etat et de l’exploitant, il est intéressant de noter que la Cour place sur le même plan la responsabilité de l’Etat et celle de l’exploitant, alors même que, dans le même temps, elle considère « qu’il n’appart[ient] qu’aux autorités publiques d’avertir les propriétaires des terrains sur lesquels se trouvent des arbres perçant les servitudes aéronautiques, de s’assurer qu’elles sont dégagées et au besoin de faire procéder au dégagement de ces servitudes »[4] tout en engageant la responsabilité de la CCI de Corse du Sud sur le motif que « en tant qu’exploitante de l’aéroport où a eu lieu l’accident ne saurait se retrancher derrière la circonstance que les terrains en cause se trouvaient en dehors de la zone aéroportuaire dès lors que certains des arbres implantés sur ces terrains perçaient la servitude aéronautique.»[5]. Dans ces conditions, il semble exister un doute quant à la motivation de la Cour et sur le rôle qu’elle a entendu donner aux parties et en particulier à l’exploitant dans le cadre du respect des servitudes aéronautiques. En effet, à en croire la Cour, l’exploitant ne saurait voir sa responsabilité dégagée du seul fait que les terrains litigieux se trouvent en dehors de l’emprise aéroportuaire tout en considérant qu’il n’appartient qu’aux autorités publiques de contacter les propriétaires concernés par des percements des servitudes aéronautiques (sous-entendu, le fait que l’exploitant ne le fasse pourrait, en adoptant une lecture stricte, ne pas constituer une faute), de s’assurer qu’elles sont dégagées et, le cas échéant, de faire procéder aux travaux de dégagement. Par conséquent, on est en droit de se demander si la Cour n’a pas estimé qu’il était opportun que l’exploitant se montre proactif sur cette problématique plutôt que seuls l’Etat et ses services aient la charge de cette question. Il conviendra de surveiller si un éventuel pourvoi devant le Conseil d’Etat permet de clarifier le raisonnement de la Cour et de préciser le rôle qu’elle a entendu conférer à l’exploitant.
Ensuite, la référence à l’ « inertie » de l’Etat et de la CCI de Corse du Sud, outre ce qui vient d’être développé, peut laisser penser que ces acteurs ne seraient pas soumis à une obligation de résultat lorsqu’il s’agit de faire respecter les servitudes aéronautiques mais que, au contraire, ils ne seraient débiteurs que d’une obligation de moyens, éventuellement renforcée.
En tout état de cause, cet arrêt semble marquer un resserrement dans le contrôle du respect des servitudes aéronautiques. En effet, si en pratique il n’est pas rare de constater des percements plus ou moins importants dans des servitudes aéronautiques, il est fort à parier que la vigilance de l’Etat et des exploitants risque de sensiblement s’accroitre sur cette problématique de manière à éviter de voir leur responsabilité engagée. Si cette décision participe indéniablement à renforcer la sécurité des vols, elle laisse toutefois présager l’hypothèse d’aménagements sensibles à prévoir notamment dans le fonctionnement de certains aéroports.
[1] Anciennement article R.241-1 du code de l’aviation civile
[2] Anciennement article D.242-11 du code de l’aviation civile
[3] Abrogé. Nouvelle codification : articles R.6351-15 et 16 du code des transports
[4] Cons. 17
[5] Cons. 15
-
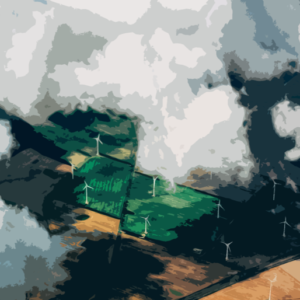
Composition du dossier de demande d’autorisation environnementale : date à laquelle est apprécié le document de conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur
Par Cléophée de Malatinszky, Avocate collaboratrice
Le 24/09/2024
Par un arrêt n° 472039 du 24 juillet 2024, le Conseil d’Etat a tranché la question de savoir comment interpréter l’obligation, au titre des dispositions du code de l’environnement portant sur les installations classées pour la protection de l’environnement, de produire un document « justifiant que le projet est conforme [au document d’urbanisme] en vigueur au moment de l’instruction » lorsque les règles d’urbanisme changent entre la date de dépôt de la demande et la délivrance de l’autorisation.
L’article L. 181-1 du code de l’environnement dispose que « l’autorisation environnementale (…) est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (…) 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 ».
L’article D. 181-15-2 précise que « lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. (…) Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) 12° Pour les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent : / a) (…) un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction ; ».
En pratique, ce document peut poser des difficultés pour le pétitionnaire puisque la procédure d’instruction de la demande d’autorisation environnementale peut être longue.
En effet, l’article L. 181-9 du code de l’environnement dispose que l’instruction se déroule en deux phases, une phase d’examen et de consultation et une phase de décision, avec un délai minimum de 6 mois (9 mois à l’époque des faits[1]). Cette instruction peut d’ailleurs être prolongée dans les hypothèses fixées aux articles R. 181-16 à D. 181-44-1 du code de l’environnement.
Certains pétitionnaires sont donc confrontés à un changement de règles en matière d’urbanisme applicables à leur projet pendant l’instruction de leur demande d’autorisation environnementale, ce qui fût le cas pour la société Plumieux Energies au cas d’espèce.
La société a en effet déposé un dossier de demande d’autorisation environnementale le 5 juin 2018 en vue de l’installation de l’exploitation de deux aérogénérateurs et un poste de livraison sur la commune de Plumieux.
Le document de conformité au plan d’urbanisme en vigueur au moment de l’instruction a été délivré sous l’empire du PLU approuvé le 5 septembre 2017.
Toutefois, un nouveau PLU avait été approuvé le 9 mars 2021 dans le délai entre le dépôt du dossier et le jour de la délivrance de l’autorisation préfectorale le 30 juin 2021.
La Commune de Plumieux a contesté l’arrêté préfectoral devant la Cour administrative d’appel de Nantes, notamment au motif que le dossier de demande ne comportait de document justifiant que le projet est conforme au plan local d’urbanisme en vigueur au moment de l’instruction, sous-entendu le PLU en vigueur au moment de l’autorisation. La Cour administrative d’appel a rejeté le recours et la Commune s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a tout d’abord précisé que la conformité du projet aux règles d’urbanisme tel qu’imposé par l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement s’appréciait au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date du dépôt de sa demande[2].
Néanmoins, le Conseil d’Etat a considéré que la Cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas recherché si le nouveau PLU « comportait des dispositions qui étaient de nature à avoir une incidence sur le projet de parc éolien justifiant qu’un complément soit apporté sur ce point au dossier de demande d’autorisation environnementale ».
Cette position du Conseil d’Etat est en droite lignée avec la jurisprudence déjà établie dès lors qu’il a précédemment jugé que les règles de forme et de procédure[3] (comprenant les obligations de composition du dossier) régissant la demande d’autorisation devaient être appréciées compte tenu des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation.
Ainsi, sans pour autant exiger du pétitionnaire de fournir automatiquement un nouveau document de conformité, le Conseil d’Etat impose néanmoins de vérifier si les évolutions des règles d’urbanisme ont eu un impact sur la conformité de son projet.
Le porteur de projet peut alors être confronté à deux hypothèses :
Soit les modifications des règles ne concernent pas celles applicables au projet : il n’y aurait dans ce cas pas de nécessité de compléter le dossier ;
Soit les modifications impactent la conformité du projet aux règles d’urbanisme : dans ce cas l’opérateur devra transmettre un document complémentaire portant sur la conformité du projet aux règles nouvellement modifiées.
[1] Le délai d’instruction des demandes d’autorisation environnementale a été raccourci par la loi n° 2023-973 relative à l’industrie verte.
[2] CE, 24 juillet 2024, n° 472039 : « 3. Il résulte des dispositions de l’article D. 181-15-2 qui viennent d’être citées que le dossier de demande d’autorisation environnementale pour une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent doit comprendre un document établi par le pétitionnaire justifiant de la conformité du projet de parc éolien aux documents d’urbanisme en vigueur à la date du dépôt de sa demande. Il appartient, le cas échéant, au pétitionnaire, dans le cas où, au cours de l’instruction de sa demande d’autorisation, les documents d’urbanisme applicables font l’objet d’évolutions qui sont de nature à avoir une incidence sur le projet, de compléter son dossier par la production d’un nouveau document justifiant de la conformité du projet aux nouvelles dispositions d’urbanisme, applicables à la date de la décision statuant sur sa demande ».
[3] CE, 11 mars 202, n° 423164 : « 3. En premier lieu, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées ».
Voir également CE, 22 septembre 2014, n° 367889 ; CE, 9 août 2023, n° 455196
-

De l’importance de la détermination du taux de TVA lors de la passation de marchés publics
Par Margaux Tripier, Avocate collaboratrice
Le 10/09/2024
Les difficultés liées à la détermination du taux de TVA applicable à une opération ne sont pas nouvelles mais bien récurrentes. La Directive européenne du 5 avril 2022 ayant vocation à simplifier et uniformiser les taux réduits de TVA applicables au sein des Etats-membres en est un exemple patent (Directive (UE) n° 2022/542).
Ces difficultés sont d’autant plus déterminantes dans le cadre d’opérations soumises à la procédure légale de passation des marchés publics.
En effet, dans ce domaine les décisions de jurisprudence relatant des errements sur le taux, ou plus généralement le régime, de TVA applicables à l’objet d’un marché public sont nombreuses et peuvent entrainer des conséquences multiples pour les parties prenantes à la procédure de passation.
Coté acheteur, le Conseil d’Etat a ainsi récemment affirmé que ne commet pas de modification irrégulière justifiant une annulation du marché, l’acheteur qui corrige une erreur de taux de TVA dans l’offre du candidat déclaré attributaire, après avoir dûment demandé à l’opérateur concerné de rectifier son offre (CE, 24 nov. 2023, n° 476301, Sté Guyot Environnement).
Côté candidat, réciproquement, l’erreur dans le choix du taux de TVA applicable à l’offre est, à défaut de demande de régularisation de l’acheteur, alors non-régularisable.
En effet, un acheteur n’est pas tenu d’inviter le candidat à régulariser son offre, entre autres, concernant le taux de TVA appliqué à celle-ci. Le cas échéant, l’erreur dans la détermination du taux de TVA ne constituant pas une simple erreur matérielle, le candidat évincé ne peut pas contester le rejet de son offre qualifiée alors d’irrégulière et, partant, ne peut utilement s’opposer à l’attribution du marché duquel il a été évincé (v. not. TA de Nîmes, 17 avril 2023, n° 2301120).
Des difficultés surviennent également lorsque l’erreur sur le taux de TVA applicable est imputable à l’acheteur. Ainsi, lorsque le pouvoir adjudicateur invite le candidat à régulariser son offre en l’invitant à appliquer un taux de TVA inférieur à celui présenté initialement dans l’offre, le candidat sera face à un dilemme « publico-fiscal ».
Une première solution consiste à maintenir le taux de TVA initialement proposé, dans la mesure où le candidat estime qu’il s’agit du seul taux légalement applicable à l’objet du marché : il encourt alors le risque d’être évincé de la procédure de passation.
En effet, le critère prix est souvent déterminant dans la pondération des offres, et l’outil de notation récemment mis à disposition par la DAJ invite ses utilisateurs à renseigner des montants « TTC » (cf. guide publié en mars 2024 par la Direction des Affaires juridiques du ministère de l’Économie et des Finances sur les méthodes de notation du critère prix dans les marchés publics).
Notons que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus public, et partant est libre de comparer les prix sur une base hors taxes ou TTC.
Cette liberté trouve toutefois sa limite dans le respect pour des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (article L.3 du Code de la commande publique).
Ainsi, la méthode de notation du critère du prix doit permettre d’attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas et la méthode choisit ne doit pas, par elle-même être de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et être alors, susceptible de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie (CAA Toulouse, 3e ch., 19 mars 2024, n° 22TL20276, pour une comparaison irrégulière sur une base TTC).
Aussi, en présence de disparité des taux de TVA proposés par les candidats, l’acheteur devra alors s’interroger sur la conformité d’une méthode de comparaison sur une base TTC aux principes de la commande publique, qui commanderaient alors plutôt de comparer les prix pour leurs montants hors taxes (v. TA de Paris, 9 novembre 2009, n° 0916859, pour une comparaison régulière sur une base HT en présence de disparité de taux de TVA des offres ; v. ég. CAA de BORDEAUX, 2ème ch., 15 novembre 2016, 15BX00253 ; TA de Melun, 23 janvier 2023, n° 2300113).
Sachant, par ailleurs, que côté candidat, une erreur sur le régime de TVA applicable conduisant à une appréciation inexacte du coût d’un achat par le pouvoir adjudicateur n’est pas, en elle-même, constitutive d’un vice du consentement, moyen d’ordre public invocable par les tiers tels que les concurrents évincés, pouvant justifier l’annulation d’un marché (CE, 9 nov. 2018, n° 420654, Sté Cerba).
Dès lors, en cas de doutes sur le taux de TVA applicable à la lecture des documents du marché, les candidats ont tout intérêt à éclaircir ce sujet, dès la phase de négociations ou, à défaut, au travers de questions formulées dans les conditions et délais prévues par dans la procédure.
Devant ce dilemme, et à défaut d’avoir obtenu de réponse satisfaisante du pouvoir adjudicateur lors des négociations, une seconde solution pour le candidat serait de s’aligner sur le taux de TVA suggéré par l’acheteur : il n’altère alors pas ses chances d’attribution du marché mais se met en risque pour l’avenir, cette fois, vis-à-vis de l’administration fiscale.
En effet, une fois les mailles de la procédure de passation passées, l’erreur sur le taux de TVA applicable peut toujours être relevée par l’administration fiscale lors d’un contrôle fiscal du candidat attributaire.
Dans ce cas, si l’administration considère qu’un taux de TVA supérieur à celui facturé par l’attributaire aurait dû être appliqué, les rappels de TVA notifiés seront calculés en dedans du prix effectivement encaissé auprès de l’acheteur (CE 14 décembre 1979, n° 11798, Comité de propagande de la banane) :
- Soit pour un prix encaissé de 132 € TTC facturé à un taux de 10% :120 € HT et 12 € de TVA ;
- Pour une opération que l’administration considère relever du taux normal de TVA de 20%, elle estime que les 132 € effectivement encaissés sont en fait répartis comme suit : 110 € HT et 22 € de TVA ;
- et notifie donc un rappel de 10 € : 22 € – les 12 € déjà déclarés.
Dans une telle hypothèse, l’attributaire, qui souhaiterait rétablir la rentabilité initiale de ce marché (et bénéficier ici d’une rémunération de 120€ HT et non de 110€), ne sera pas libre de répercuter la majoration du taux de TVA sur le pouvoir adjudicataire : il pourra seulement négocier celle-ci dans les documents contractuels du marché, dans la mesure où une telle hypothèse procédurale est ouverte.
En synthèse, vigilance fiscale est de mise pour toutes les parties intéressées à la passation de marchés publics ; l’économie des méandres liées à la détermination du taux de TVA applicable pouvant s’avérer risquée pour chacun d’eux.
-

« Un local affecté à un usage d’habitation au 1er janvier 1970 ne perd pas cet usage lorsqu’il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l’usage de ce dernier. »
Par Yossra ABASSI, Avocate collaboratrice
Le 08/07/2024
Cour de cassation, 3e Chambre civile , 13 juin 2024, n°23-11.053
La Ville de Paris a assigné en référé sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, le propriétaire d’un appartement issu de la réunion de deux lots d’un immeuble situé à Paris, afin de le voir condamner au paiement d’une amende civile, pour en avoir changé l’usage en le louant de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.
Par un arrêt rendu le 10 novembre 2022, la Cour d’appel de Paris a jugé que l’usage d’habitation à la date de référence du 1er janvier 1970 était établi pour un lot, mais non pour le second lot, de sorte que le local issu de la réunion de ces deux lots ne pouvait être considéré comme étant affecté dans son entièreté à l’usage d’habitation au 1er janvier 1970.
La Ville de Paris se pourvoit en cassation.
Par un arrêt du 13 juin 2024, la 3e civile de la Cour de cassation revient sur les notions de local à usage d’habitation et le cas du changement d’usage.
Aux termes des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.{…} »
Il en résulte que les locaux destinés à l’habitation sont soumis à une autorisation préalable en cas de changement d’usage du local. Celui-ci est réputé d’usage d’habitation s’il est affecté à cet usage à la date du 1er janvier 1970.
La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par l’article L.651-2 du CCH, qui prévoit une amende civile qui ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé.
En l’espèce, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en relevant que le local était, pour partie, composé d’un local affecté à l’usage d’habitation à la date de référence, de sorte que sa location pour de courtes durées constituait un changement d’usage qui devait être soumise à une autorisation pour le lot concerné.
En d’autres termes, un local affecté à un usage d’habitation au 1er janvier 1970 ne perd pas cet usage lorsqu’il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l’usage de ce dernier.
Ainsi, la location saisonnière du local réuni au local à usage d’habitation constitue au sens de cette décision un changement d’usage, soumis à une autorisation préalable du lot concerné.
Un rappel bienvenu en ce début de saison touristique !
-

Précision sur la notion d’agrandissement des constructions existantes en zone littorale
Par Emmeline BOITEL, Avocat collaborateur
Le 26/06/2024
Conseil d’État, avis n°490405 du 30 avril 2024
Saisi pour avis par le Tribunal administratif de Bastia à l’occasion d’un recours formé contre un refus de permis de construire modificatif, le Conseil d’Etat a répondu à la question de droit nouvelle tenant au fait de savoir si, dans les communes littorales, le projet d’agrandissement d’une construction existante doit être apprécié au regard de la construction existante résultant de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme initiale ou de la dernière autorisation accordée au pétitionnaire, en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Avant de répondre à cette question, le Conseil d’Etat s’attache tout d’abord à rappeler que l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme pose un principe selon lequel dans toutes les communes littorales, l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants.
Ensuite, et reprenant en substance les termes de sa décision n°419139 du 3 avril 2020, le Conseil d’Etat indique que par ces dispositions le législateur a entendu interdire toute opération de construction isolée dans les communes du littoral.
Toutefois, il précise que ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le simple agrandissement d’une construction existante, entendu comme une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la modification apportée.
Le Conseil d’Etat va plus loin que la définition de la notion d’extension d’une construction existante qu’il a eu l’occasion de venir préciser dans un arrêt du 9 novembre 2023, dans lequel il a jugé que cette notion doit « s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci. » (CE, 9 novembre 2023, req. n°469300)
Dans son avis du 30 avril dernier, le Conseil d’Etat ajoute que les caractéristiques de l’agrandissement doivent s’apprécier par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans prendre en compte les éventuels agrandissements intervenus ultérieurement.
Enfin, le Conseil d’Etat précise que pour les constructions antérieures à la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, les caractéristiques de l’agrandissement s’apprécient par comparaison avec l’état de la construction avant l’entrée en vigueur de la loi.
-

Réception Tacite des Travaux : la Cour de cassation durcit les conditions
Par Marie BLANDIN, Avocate collaboratrice
Le 13/06/2024
Civ. 3e, 23 mai 2024, n°22-22.938
En droit de la construction, la réception est définie comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves » selon les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil.
Cette réception est classiquement matérialisée par un procès-verbal. Toutefois, ce document n’est pas le seul moyen d’exprimer la volonté du maître de l’ouvrage !
Lorsque la réception écrite est absente ou impossible, les juges ont envisagé la réception tacite en s’appuyant sur un faisceau d’indices démontrant la volonté réelle et non équivoque du maître de l’ouvrage (Cass. civ. 3e, 18 nov. 1992 ; Cass. civ. 3e, 7 déc. 1988 ; Cass. civ. 3e, 24 juin 1992).
La réception tacite repose donc sur la volonté sous-entendue du maître de l’ouvrage. Cependant, cette présomption n’est pas absolue et doit être confirmée par d’autres éléments…
Parmi ces indices, la prise de possession de l’ouvrage, combinée avec le paiement total ou partiel du prix, laisse présumer une acceptation des travaux réalisés (Civ. 3e, 16 mars 1994 ; Civ. 3e, 10 juill. 1995).
Selon la jurisprudence ancrée, en l’absence de paiement intégral, il ne peut y avoir réception tacite (Civ. 3, 30 janvier 2019, n°18-10.197, 18-10.699), bien que le paiement d’une partie substantielle des travaux suffise si la prise de possession est constatée (Civ. 3, 15 juin 2022, nº 21-15.023).
Dans le cadre de travaux sur existants, une nouvelle décision de la Cour de cassation, en date du 23 mai 2024, a apporté des précisions importantes.
En effet, la Cour a statué qu’en cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession ne pouvait être présumée uniquement du fait que le maître de l’ouvrage occupait les lieux.
Selon la Haute Cour de justice, « le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux avant l’exécution des travaux », ce qui ne permettait pas de présumer une réception tacite !
De surcroît, la Cour a également relevé que « les travaux de finition n’avaient été ni exécutés ni payés, alors qu’ils faisaient partie d’une mission unique ».
Ainsi, même en présence d’un paiement partiel et de l’occupation des lieux, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir une réception tacite selon les juges du Quai de l’Horloge.
Cette décision illustre l’importance de la combinaison des indices pour établir la réception tacite, et confirme que l’occupation des lieux par le maître de l’ouvrage après les travaux, sans paiement complet et en l’absence de finition des travaux, ne suffit pas à présumer cette réception.
Les juges du fond ont ainsi souverainement conclu que la réception ne pouvait être divisée en tranches et que la volonté de réceptionner devait être clairement démontrée.
-
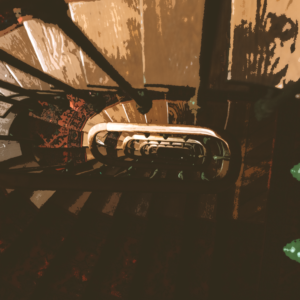
Perte de chance : la Cour de cassation rappelle que la réparation d’un préjudice doit être rigoureusement proportionnelle à la chance perdue
Par Anne Renaux, Avocate collaboratrice
Le 23/05/2024
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 février 2024, 22-23.082, Inédit
Dans un arrêt remarqué, rendu le 29 février 2024, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance, si elle s’était réalisée.
En l’espèce, un propriétaire bailleur, qui se plaignait de dégradations locatives, avait donné congé à son locataire. Dans le prolongement de la restitution des lieux par ce dernier, le propriétaire bailleur n’avait pas manqué de l’assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par un jugement en date du 28 mars 2022, le Juge des Contentieux de la Protection a condamné le locataire, au titre de l’ensemble des préjudices allégués par son ancien bailleur.
Cela étant, le Juge des Contentieux de la Protection s’est abstenu de comparer les états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement, en retenant que le montant du devis réparatoire fourni par le bailleur n’était pas excessif.
Plus curieusement encore, le Juge des Contentieux de la Protection a fait droit aux prétentions du propriétaire bailleur, qui soutenait avoir subi un préjudice tenant à la perte de chance de vendre son bien dès sa restitution, compte tenu de son état, et a condamné l’ancien locataire au paiement des cinq mois écoulés entre son congé et la vente du bien.
Celui-ci s’est pourvu en cassation, soutenant qu’en l’ayant condamné à payer la somme correspondant aux cinq mois écoulés entre le congé et la vente de l’appartement, soit l’ensemble des échéances de prêt que le bailleur avait contracté et dû régler jusqu’à la vente, le Juge des Contentieux de la Protection avait violé l’article 1231-2 du Code civil et les principes régissant la réparation de la perte de chance.
Suivant le raisonnement du demandeur au pourvoi, la Troisième Chambre Civile a cassé, et annulé en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Au visa de l’article 1231-2 du Code civil, la Haute Juridiction a rappelé le principe selon lequel la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue.
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation a considéré que le Juge des Contentieux de la Protection avait violé les dispositions de l’article 1231-2 du Code civil, « alors qu’en considération de l’aléa existant quant à la réalisation de la vente, la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ».
Manifestement, la Cour de cassation entend rappeler, une nouvelle fois, que la réparation de la perte de chance, qui est une catégorie de préjudice de création jurisprudentielle, ne doit pas correspondre à la totalité du gain espéré, mais qu’elle doit être ajustée en fonction de la probabilité de la survenance de la chance perdue (Cass. 1re Civ. 14 nov. 2019, n°18-23.915).
-

Agrivoltaïsme et photovoltaïque : les précisions du décret du 8 avril 2024 quant aux conditions d’implantation des installations
Par Damia KACETE, Avocate collaboratrice, et Benoît PERRINEAU, Avocat associé
Le 14/05/2024
Introduction
Le décret paru le 8 avril 2024 marque une étape importante dans la mise en œuvre de la planification énergétique dans son volet « énergie solaire ».
Il affine en cela les conditions d’implantation sur le territoire des installations agrivoltaïques et photovoltaïques et définit leur contrôle tout au long de leur exploitation.
Il intègre quatre volets de dispositions portant sur :
- Les modalités d’établissement du document-cadre ayant vocation à régir, pour l’avenir, les lieux d’implantation des installations photovoltaïques
- Les critères (très précis) de définition de l’installation agrivoltaïque
- Le régime des autorisations d’urbanisme associées
- La durée des autorisations, les conditions de démantèlement et de remise en état après exploitation des installations
Entrée en vigueur des dispositions :
- Pour les installations agrivoltaïques, elles s’appliquent aux demandes de permis ou aux déclarations préalables déposées à compter d’un mois après la date de publication du décret, soit à compter du 8 mai 2024.
- Pour les installations photovoltaïques, elles s’appliquent aux demandes de permis ou aux déclarations préalables déposées à compter d’un mois après la publication du document-cadre départemental relatif aux zones ouvertes à ces installations.
Installations photovoltaïques : précisions sur l’élaboration du document-cadre régissant leur implantation
Rappel : la définition
Pour rappel, ce document-cadre identifie certaines surfaces en dehors desquelles ne peut être implanté aucun ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, à l’exception des installations agrivoltaïques.
Ces surfaces, destinées à accueillir les installations photovoltaïques, sont celles dont les sols sont réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale.
Apports du décret : sur le contenu du document cadre
Dans ce contexte, le décret apporte des éléments d’information sur le contenu du document-cadre :
- en précisant ce qu’il convient d’entendre par « sol réputé inculte »,
- en fixant la durée minimale précitée à 10 ans,
- en fixant une liste de zones devant être incluses au sein du document-cadre (sites pollués, anciennes carrières, anciens aérodromes, etc.) assorties pour certaines d’exceptions, notamment si des prescriptions de remise en état agricole ou forestière ont été édictées,
- en fixant une liste de zones à l’inverse insusceptibles d’être incluses au sein du document-cadre (zones agricoles protégées au titre de l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ; périmètres dans lesquels a été ordonné la mise en œuvre d’un aménagement foncier agricole et forestier en application de l’article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime, etc.).
Apports du décret : sur la procédure d’élaboration du document-cadre
D’un point de vue procédural, le décret indique que la proposition de document-cadre émise par la chambre départementale d’agriculture est transmise pour avis aux représentants des organisations professionnelles agricoles intéressées, aux représentants des professionnels des énergies renouvelables, aux représentants des collectivités concernées et à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. A l’expiration d’un délai de deux mois à compter de leur saisine, leur avis est réputé favorable. (art. R. 111-61 du C. en)
Les chambres départementales d’agriculture disposent d’un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l’Etat dans le département leur proposition de document-cadre. (art. 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024)
Les apports du décret sur les critères de définition de l’installation agrivoltaïque
Pour rappel, L. 314-36 du code de l’énergie énumère l’ensemble des critères permettant de qualifier une installation d’agrivoltaïque.
La loi exige de l’installation d’être une installation dont les modules “sont situés sur une parcelle agricole”. (art. L. 314-36, I. du C. en) Le décret précise la notion de “parcelle agricole” sur laquelle doit se situer l’installation. La “parcelle agricole” est entendue non pas comme le périmètre délimité par les limites parcellaires mais comme “le périmètre présentant les mêmes caractéristiques agricoles, supportant un projet d’installation agrivoltaïque et déterminé par les limites physiques d’une implantation continue de panneaux photovoltaïques”. ( nouvel art. R. 314-108 du C. en) La loi exige de l’installation d’apporter « directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants (…) : / 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ; / 2° L’adaptation au changement climatique ; / 3° La protection contre les aléas ; 4° L’amélioration du bien‑être animal » (art. L. 314-36, II.) ; Le décret précise la nature des services que doit apporter l’installation Le service « d’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques » Il s’agit : – soit :
o d’une part, de l’amélioration des qualités agronomiques du sol
o et, d’autre part, de l’augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, du maintien de ce rendement ou au moins de la réduction de la baisse tendancielle du rendement qui est observée au niveau local.
– soit de la remise en activité agricole ou pastorale d’un terrain agricole inexploité depuis plus de cinq années (Art. R. 314-110)
Le service « d’adaptation au changement climatique » Il s’agit de la limitation des effets néfastes du changement climatique se traduisant par – une augmentation du rendement de la production agricole ;
– ou, à défaut, à la réduction, voire au maintien, du taux de la réduction tendancielle du rendement qui est observée au niveau local ;
– ou par une amélioration de la qualité de la production agricole.
Cette limitation s’apprécie notamment par l’observation de l’un des effets adaptatifs suivants :
– en termes d’impact thermique, par la fonction de régulation thermique de la structure en cas de canicule ou de gel précoce ou tardif ;
– en termes d’impact hydrique, par la limitation du stress hydrique des cultures ou des prairies, l’amélioration de l’efficience d’utilisation de l’eau par irrigation ou la diminution de l’évapotranspiration des plantes ou de l’évaporation des sols, et par un confort hydrique amélioré ;
– en termes d’impact radiatif, par la limitation des excès de rayonnement direct conduisant notamment à une protection contre les brûlures foliaires (art. R. 314-111)
Le service de « protection contre les aléas » Il s’agit de la protection apportée par les modules agrivoltaïques contre au moins une forme d’aléa météorologique, ponctuel et exogène à la conduite de l’exploitation et qui fait peser un risque sur la quantité ou la qualité de la production agricole, à l’exclusion des aléas strictement économiques et financiers (art. R. 314-112) Le service « d’amélioration du bien-être animal » Il s’agit de l’amélioration du confort thermique des animaux, démontrable par l’observation d’une diminution des températures dans les espaces accessibles aux animaux à l’abri des modules photovoltaïques et par l’apport de services ou de structures améliorant les conditions de vie des animaux (art. R. 314-113) La loi Exige de l’installation de garantir « à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime[1] une production agricole significative et un revenu durable » (art. L. 314-36, II.) Le décret précise la notion d’agriculteur « actif » auquel l’installation doit garantir une production agricole significative et un revenu durable l’agriculteur “actif” correspond à toute personne physique ou morale qui répond aux conditions de l’article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime ; en cas de changement d’exploitant agricole, la durée pendant laquelle l’exploitation de l’installation d’agrivoltaïsme se poursuit sans agriculteur actif, au sens de l’alinéa précédent, ne peut excéder 18 mois (art. R. 314-109) Précise la notion de production agricole « significative » que l’installation doit garantir à un agriculteur actif ou à des exploitations agricoles à vocation pédagogique Il s’agit d’une production dont la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle agricole au sens de l’article R. 314-108 est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office. La zone témoin, définie par ce même article, correspond à une zone équivalente en termes de conditions pédoclimatiques et de culture, située à proximité de l’installation agrivoltaïque, mais ne comportant ni installation équipée de modules photovoltaïques ni installation ou arbre apportant de l’ombre.
Dans certaines conditions, le préfet du département peut néanmoins réduire la proportion de rendement exigé et octroyer des dérogations à l’obligation de se référer à la zone témoin (art. R. 314-115). S’agissant des installations sur serre et des installations agrivoltaïques sur élevage, le caractère significatif de la production est apprécié au regard d’autres référentiels (art. R. 314-116 et R. 314-117).
Précise la notion de « revenu durable » que l’installation doit garantir à un agriculteur actif ou à des exploitations agricoles à vocation pédagogique Il s’agit de la moyenne des revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l’exploitation agricole après l’implantation de l’installation agrivoltaïque n’est pas inférieure à la moyenne des revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l’exploitation agricole avant l’implantation de l’installation agrivoltaïque, en tenant compte de l’évolution de la situation économique générale et de l’exploitation, selon des modalités définies par arrêté (art. R. 314-117) La loi Exige de l’installation de permettre à la production agricole « d’être l’activité principale de la parcelle agricole » (art. L. 314-36, IV.) ; le caractère principal de l’activité « peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol » (art. L. 314-36, V) Le décret précise les conditions permettant à la production agricole de constituer l’« activité principale » sur la parcelle où elle est installée Il convient que : – la superficie qui n’est plus exploitable du fait de l’installation agrivoltaïque n’excède pas 10 % de la superficie totale couverte par l’installation agrivoltaïque ;
– la hauteur de l’installation agrivoltaïque ainsi que l’espacement inter-rangées permettent une exploitation normale et assurent notamment la circulation, la sécurité physique et l’abri des animaux ainsi que, si les parcelles sont mécanisables, le passage des engins agricoles ;
– pour les installations de plus de 10 MW crête n’étant pas régies de l’installation agrivoltaïque n’excède pas 40 % (art. R. 314-118).
Le taux de couverture d’une installation agrivoltaïque est défini comme le rapport entre, d’une part la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques sur le périmètre mentionné à l’article R. 314-108 dans des conditions normales d’utilisation et, d’autre part, la surface de la parcelle agricole définie à l’article R. 314-108.
S’agissant des installations utilisant des technologies éprouvées, un arrêté à venir fixera la valeur maximale de taux de couverture pouvant permettre de garantir que la production agricole reste l’activité principale de la parcelle (art. R. 314-119).
Le régime des autorisations d’urbanisme
La compétence exclusive du préfet en matière d’agrivoltaïsme
Le décret pose le principe d’une compétence exclusive du préfet pour autoriser les installations agrivoltaïques y compris celles accessoires à une construction. (art. R. 422-2 et R. 422-2-1 du C. urb)
Le contenu des dossiers de demande de permis de construire ou de déclaration préalable
Le décret précise le contenu du dossier de demande de permis de construire ou de déclaration préalable relatif aux installations photovoltaïques et agrivoltaïques. A noter qu’en matière d’agrivoltaïsme, le dossier doit comporter des notes techniques permettant d’établir que l’installation respecte l’ensemble des conditions de l’article L. 314-36 du code de l’énergie permettant de la regarder comme une installation agrivoltaïque.
Il précise les modalités de constitution de garanties financières. (art. R. 431-27, R. 431-36 et art. R. 111-64 du C. urb)
La durée d’autorisation, le démantèlement et la remise en état après exploitation
Durée maximale d’autorisation de 40 ans
La durée maximale d’autorisation des installations photovoltaïques et agrivoltaïques est de 40 ans, avec une possibilité de prorogation de dix ans lorsque l’installation présente encore un rendement significatif.
1 an pour démanteler et remettre en état le site
Le décret précise la nature des opérations de démantèlement et de remise en état du site après exploitation, qui doivent être menées dans un délai d’un an à compter de la fin de l’exploitation de l’installation énergétique ou de la date d’échéance de son autorisation, avec une possibilité, sous conditions, qu’il soit étendu jusqu’à trois ans.
Un régime de contrôle précis pour chaque type d’installation
Le décret institue un régime de contrôle encadré :
- L’organisme de contrôle (art. R. 314-120 du C. en)
Le décret définit quel organisme est responsable des contrôles des installations.
Il peut être un organisme scientifique, un institut technique agricole, une chambre d’agriculture ou un expert foncier et agricole mentionné à l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime.
Un arrêté a vocation à déterminer les conditions de compétence et d’indépendance de l’organisme contrôleur.
- Les différents temps de contrôle
En matière d’agrivoltaïsme (art. R. 314-120 à R. 314-122 du C. en) :
Il intervient :
- préalablement à la mise en service, sur l’installation agrivoltaïque et la zone témoin,
- dans la 6ème année de la mise en service, pour vérifier le respect des conditions relatives au caractère agricole des parcelles, aux exploitants et aux services apportés par l’installation,
- à la fin de l’exploitation, en vue d’attester de la bonne fin des opérations de démantèlement et de remise en état, ainsi que du maintien des qualités agronomiques des sols.
En matière d’installations photovoltaïques au sol (art. R. 463-1 du C. urb) :
Il intervient :
- préalablement à la mise en service,
- six ans après l’achèvement des travaux, afin de s’assurer notamment que les fonctions écologiques du sol, ainsi que son potentiel agronomique ne sont pas durablement affectées par l’installation.
Ces contrôles donnent lieu à des rapports transmis à l’autorité compétente en matière d’urbanisme.
Un arrêté a vocation à intervenir.
En matière de serres, hangars et ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques (art. R. 463-4 du C. en) :
Ils bénéficient de leur propre régime de contrôle : le respect des conditions de compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière peut être contrôlé de manière inopinée, a priori jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux.
- Les sanctions
Un régime de sanction est par ailleurs institué.
En matière d’agrivoltaïsme (art. R. 314-120 et R.314-122 du C. en) :
En cas de méconnaissance des règles relatives au contrôle ou de l’absence de respect des conditions de légalité de l’installation, l’autorité compétente en matière d’urbanisme :
- met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine,
- peut imposer :
- une sanction pécuniaire et le cas échéant le retrait ou la suspension de l’autorisation d’exploiter ;
- dans le cas de l’absence de démantèlement ou de remise en état du site ou d’absence de transmission du rapport attestant de la bonne fin des contrôles et du maintien des qualités agronomiques des sols : outre les sanctions ci-avant rappelées, la réalisation d’office des travaux et la mise en œuvre des garanties financières, en faisant supporter au propriétaire du terrain d’assiette le coût du dépassement éventuel par ces travaux du montant de ces garanties financières.
En matière d’installations photovoltaïques au sol (art. R. 463-2 et R. 463-3 du C. urb) :
Quand il est constaté que les conditions de compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies, l’autorité compétente en matière d’urbanisme :
- met en demeure l’exploitant de se mettre en conformité ;
- à défaut, met en œuvre les procédures de sanctions prévues au titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme et peut également prescrire le démantèlement de l’installation dans un délai qu’elle détermine et, faute pour l’exploitant d’y procéder, peut y procéder d’office ; à cet égard, elle met en œuvre les garanties financières constituées et fait supporter au propriétaire du terrain d’assiette le coût du dépassement éventuel par ces travaux du montant de ces garanties financières.
En matière de serres, hangars et ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques (art. R. 463-4 du C. urb) :
Quand il est constaté que les conditions de compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies, l’autorité compétente en matière d’urbanisme :
- met en demeure l’exploitant de se mettre en conformité,
- a défaut, prescrit le démantèlement de l’installation.
[1] Ces dispositions concernent les exploitations agricoles à vocation pédagogique gérées par des établissements publics ou privés sous contrat de formation agricole.
-

Les bénéficiaires du FCTVA sécurisent leur récupération de la TVA à travers les règles de sectorisation d’activités
Par Margaux TRIPIER, Avocate collaboratrice
Le 18/04/2024
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20 février 2024, 22DA02555
La Cour administrative d’appel de Douai confirme l’éligibilité au Fonds de compensation de TVA des dépenses d’investissement affectées au service de collecte de déchets ménagers, financé par la taxe d’enlèvement d’ordure ménagères, nonobstant l’assujettissement à la TVA des activités de traitement et valorisation des déchets, constituant un secteur d’activité distinct au plan de la TVA.
Lorsqu’un même contribuable exerce différentes activités soumises à des dispositions variables en matière de TVA, celles-ci doivent être traitées séparément pour l’exercice du droit à déduction.
La création de secteurs distincts est dite de droit : elle s’impose aussi bien à l’administration fiscale qu’aux contribuables, soit lorsque la situation de chaque activité, au regard de la TVA, conduit à appliquer cette règle, soit lorsque les textes législatifs ou réglementaires prévoient sa mise en œuvre (CGI, Annexe II, Article 209, I).
La jurisprudence récente a surtout été l’illustration d’une opposition de ces règles aux contribuables.
On se souvient ainsi de la saga jurisprudentielle sur l’épineux sujet de la récupération de la TVA des EHPAD (CE 3e – 8e s.-s. 20-10-2014 n° 364715, Sté La Galicia ; et dernier état avec la décision CE 7-10-2020 n° 426661 Sté Résidence de la Forêt).
Pour autant, ces règles peuvent être opposées également à l’administration, et c’est ce que confirme la CAA de Douai par une application en miroir des règles d’éligibilité au Fonds de compensation de TVA (FCTVA).
Rappelons que des secteurs distincts d’activité doivent être constitués lorsque (CGI, ann. II art. 209, I.al. 2 ; BOFiP-TVA-DED-20-20-§ 20 à 100-25/10/2022) :
- le même assujetti exerce plusieurs activités, déterminées selon un ensemble de critères tenant à la fois à la nature économique de chaque activité et, surtout, à l’utilisation de moyens d’exploitation propres (investissements et personnels distincts) ;
- les différentes activités exercées obéissent à des règles différentes au regard de la TVA, en particulier au regard des règles de droit à déduction de la TVA.
Par ailleurs, en application de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, un certain nombre d’activités doivent être constituées en secteurs distincts d’activités pour l’exercice du droit à déduction, telles que :
- chaque immeuble ou ensemble d’immeubles ou fraction d’immeuble dont la livraison à soi-même est imposable (livraisons à soi-même de logements sociaux à usage locatif ou certains travaux de réhabilitation réalisés dans les mêmes logements) ou dans lequel sont réalisés des travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables (CGI art. 257, I.3 ; CGI art. 278 sexies II) ;
- les locations d’immeubles à usage professionnel soumises à la TVA sur option (CGI art. 260, 2° ; ann. II art. 193) ;
Enfin, concernant plus particulièrement les bénéficiaires du FCTVA, les collectivités locales sont tenues de sectoriser les activités qu’elles soumettent à la TVA sur option, comme : la fourniture de l’eau dans les communes de moins de 3 000 habitants, l’assainissement, ou l’enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus (CGCT art. L. 2333-76).
Au-delà des règles administratives (comptabilité et déclaration distinctes) qui peuvent en découler, l’obligation de sectorisation peut entraîner des conséquences financières dans la mesure où chaque secteur d’activité est considéré comme une entreprise distincte pour l’exercice du droit à déduction.
La Cour administrative d’appel de Douai limite toutefois ces conséquences en confirmant l’éligibilité au FCTVA des dépenses d’investissement affectées à un secteur d’activité hors du champ d’application de la TVA.
En effet, la Cour affirme que si les activités de collecte des déchets et celles de traitement et de valorisation sont complémentaires l’une de l’autre, elles peuvent être exercées par des opérateurs différents, avec un personnel, des équipements et des techniques propres à chacun d’eux. Ainsi, ces activités exercées au titre de personnel, équipements et techniques propres, répondent également à un cadre réglementaire et fiscal distinct. Elles doivent dès lors être regardées comme constituant des secteurs d’activité distincts et par suite, l’éligibilité au FCTVA de ses dépenses d’investissement doit également être examinée dans le cadre de chacun de ces secteurs d’activité.
En l’occurrence, les dépenses d’investissement litigieuses dont le syndicat s’est prévalu dans sa demande adressée en 2019 ont été exposées dans le seul intérêt du service de collecte des déchets ménagers qui est financé par la perception d’une taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et n’est donc pas assujetti à la TVA. Il s’ensuit que les investissements litigieux ne peuvent être regardés comme étant utilisés pour la réalisation d’opérations soumises, même partiellement, à la TVA et peuvent, toutes conditions remplies par ailleurs, ouvrir droit au bénéfice du FCTVA.
Si cette précision prétorienne renforce utilement la sécurité juridique des bénéficiaires du FCTVA, ces derniers restent néanmoins confrontés à de multiples incertitudes à la suite de la réforme d’automatisation du Fonds (article 251 de la loi n°2020-1721 de finances pour 2021).
Historiquement, six conditions cumulatives devaient être réunies pour qu’une dépense d’investissement puisse ouvrir droit à une attribution du FCTVA, à savoir :
- La dépense doit avoir été réalisée par un bénéficiaire du fonds ;
- Le bénéficiaire doit être compétent pour agir dans le domaine concerné ;
- Le bénéficiaire doit être propriétaire de l’équipement pour lequel cette dépense a été engagée ;
- La dépense doit être une dépense réelle d’investissement ;
- Une dépense grevée de TVA non exposée pour les besoins d’une activité assujettie à la TVA ;
- La dépense ne doit pas être relative à un bien cédé ou confié à un tiers non bénéficiaire du fonds.
Toutefois, l’automatisation progressive de la gestion du FCTVA à compter du 1er janvier 2021 s’appuie sur le recours à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement avec une dématérialisation de la procédure d’instruction, de contrôle et de versement.
Les impacts subséquents qu’ont pu avoir cette réforme sur les conditions juridiques du régime d’attribution du FCTVA ont fait l’objet d’éclaircissements récents par le biais des commentaires de l’administration fiscale ainsi qu’au cours des travaux parlementaires de la loi de finances pour 2023 qui mériteraient d’être confirmés, particulièrement au vue des disparités de pratiques de comptabilisation des participations versées au titre des opérations d’aménagement.
-

Insert de cheminée et garantie décennale : un revirement de jurisprudence inattendu
Par Margaux BEUREY, Avocate of counsel
Le 09/04/2024
Cour de cassation, 21 mars 2024, n°2218694
Par sa décision en date du 21 mars dernier[1], la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence inattendu concernant le régime applicable aux éléments d’équipement.
En l’espèce, deux époux ont fait réaliser des travaux d’installation d’un insert dans la cheminée de leur maison. Par la suite, un incendie est survenu au droit de la cheminée, occasionnant la destruction de la maison et de son mobilier.
Estimant que ce sinistre était imputable à l’installation de l’insert de cheminée, les époux et leur assureur ont assigné la société en charge de l’installation de l’insert et son assureur aux fins d’indemnisation.
En application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis 2017, la Cour d’appel de MONTPELLIER[2] a estimé que les travaux de pose d’un élément d’équipement tel un insert relevaient de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Elle a ainsi condamné la société et son assureur à indemniser les époux de leur entier préjudice sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
En effet, par une décision du 15 juin 2017[3], confirmée le 14 septembre 2017[4], la Cour de cassation avait opéré un revirement de jurisprudence sur le jeu de la garantie légale des constructeurs en cas de travaux sur existant, considérant que « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ».
Il s’agissait alors, d’une part, d’uniformiser les garanties, en appliquant la garantie décennale, dès lors que l’élément d’équipement rendait l’ouvrage impropre à sa destination, peu important qu’il soit d’origine ou installé sur l’existant.
D’autre part, il y avait une volonté de protéger les maîtres d’ouvrage, généralement profanes, réalisant des travaux de rénovation ou d’amélioration de leurs logements, la garantie décennale permettant de rallonger le délai de recours à l’encontre du constructeur et d’augmenter les chances d’indemnisation par l’assureur du constructeur même en cas d’insolvabilité de l’entrepreneur.
Il n’était donc pas nécessaire de démontrer la qualification d’ouvrage de l’installation d’un équipement. Il suffisait que les désordres affectant les éléments d’équipement rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Cependant, l’assureur condamné a interjeté appel de la décision rendue par la Cour d’appel de MONTPELLIER, permettant ainsi à la Cour de cassation de faire un rétropédalage inattendu par rapport à 2017.
En effet, elle considère désormais que, si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Aux termes de son arrêt du 21 mars 2024, la Cour de cassation a justifié sa décision, estimant que sa jurisprudence initiée en 2017 relative au régime des éléments d’équipement n’avait pas atteint les objectifs souhaités.
La Haute juridiction recentre donc le débat sur la qualification d’ouvrage en tant que tel, ce qu’elle avait initialement abandonné.
La garantie décennale ne sera susceptible de s’appliquer que pour les dommages de nature décennale affectant l’un des éléments d’équipement d’origine de l’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article 1792 du Code civil[5].
Il est à noter que cette jurisprudence s’applique aux affaires en cours, et ce, au préjudice des maîtres d’ouvrage ! L’objectif de 2017 est donc bel et bien délaissé par la Cour de cassation…
[1] Cour de cassation, 21 mars 2024, n°2218694
[2] Cour d’appel, Montpellier, 4e chambre civile, 20 avril 2022 – n° 19/04078
[3] Cass. 3e civ. 15 juin 2017, n° 16-19640
[4] Cass. 3e civ. 14 septembre 2017, n° 16-17323
[5] Article 1792 du Code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
-

Loi sur l’eau : travaux constituant une opération d’ensemble devant faire l’objet d’une demande unique
Par Emmeline BOITEL, Avocate collaboratrice
Le 04/04/2024
Conseil d’État, 8 mars 2024, req. n°460964
Par une décision du 8 mars 2024, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions dans lesquelles des travaux d’intervention relevant du régime des IOTA réalisés successivement doivent être regardés comme une même opération devant faire l’objet d’une demande unique.
On rappellera que l’article R. 214-42 du code de l’environnement dispose que :
« Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d’activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d’autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l’ensemble de ces installations.
Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive. (…) »
Ces dispositions encouragent le regroupement des démarches administratives en permettant de déposer une seule déclaration ou demande d’autorisation lorsque l’opération concerne différents ouvrages, travaux ou activités, envisagés par la même personne sur un même site.
Ainsi, la demande unique trouve à s’appliquer lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- Les travaux sont réalisés par une même personne, une même exploitation ou un même établissement ;
- Les travaux sont réalisés sur un même milieu aquatique ;
- L’ensemble des travaux cumulés dépasse le seuil de déclaration ou d’autorisation fixé par la nomenclature.
A ce titre, le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de juger que pour déterminer si les ouvrages, installations, travaux ou activités (IOTA) sont soumis à déclaration ou à autorisation au regard de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, l’administration est tenue d’inviter le pétitionnaire à former une demande unique pour le ou les projets formant ensemble une seule et même opération, dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique (CE, 30 mars 2015, n° 360174).
Dans sa décision du 8 mars 2024, le Conseil d’Etat va plus loin en apportant des précisions sur la manière dont s’apprécie une opération d’ensemble.
Dans cette affaire, la fédération de l’Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FYPPMA) a dans un premier temps réalisé des travaux de vidange complète d’un étang, en vue de son effacement ultérieur, étant précise que ces travaux n’étaient pas soumis à une procédure administrative au titre de la législation sur l’eau au motif qu’ils bénéficiaient du régime juridique applicable aux piscicultures prévu à l’article L. 431-7 du Code de l’environnement.
Or, ces travaux de vidange ont été complétés par des travaux de curage et de destruction de la digue de l’étang.
En outre, l’association requérante soutenait que ces différents travaux et interventions réalisés par la FYPPMA sur le site de l’étang constituaient une seule et même opération, réalisée par une personne unique sur un même milieu aquatique, de sorte que l’instruction par l’administration de ce projet aurait dû être réalisée sous forme d’une procédure unique au titre de la nomenclature IOTA, conformément aux dispositions de l’article R. 214-42 du code de l’environnement.
Ce moyen a été retenu par le Conseil d’Etat qui a jugé que :
« 4. Les dispositions de l’article R. 214-42 du code de l’environnement impliquent que le pétitionnaire saisisse l’administration d’une demande unique pour les projets qui forment ensemble une même opération lorsque cette dernière, prise dans son ensemble, dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration et dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique, y compris lorsqu’il est prévu de les réaliser successivement. Pour apprécier si des projets successifs doivent faire l’objet d’une demande unique, puis déterminer, en fonction des seuils applicables à ces opérations ou activités, s’ils doivent être soumis à déclaration ou autorisation au regard de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du même code, l’administration doit se fonder sur l’ensemble des caractéristiques des projets, en particulier la finalité des opérations envisagées et le calendrier prévu pour leur réalisation. »
Il en résulte que pour caractériser une opération d’ensemble devant faire l’objet d’une demande unique relevant de la législation sur l’eau, il doit être tenu compte des caractéristiques des projets, et plus spécifiquement de la finalité des travaux envisagés et du calendrier prévu pour leur réalisation.
Le Conseil d’Etat dégage donc deux nouveaux critères permettant d’identifier si plusieurs travaux réalisés successivement relevant de la loi sur l’eau doivent être regardés comme une seule opération soumise alors à une demande unique auprès de l’administration :
- La finalité des travaux envisagées ;
- Le calendrier prévu pour leur réalisation.
Faisant application de ces critères le Conseil d’Etat a donc considéré que les travaux réalisés sur le site qui avaient pour finalité la suppression de l’étang, devaient être regardés comme une même et unique opération portée par une même personne dans un même milieu aquatique et ayant la même finalité. Dans ces conditions, cette même et unique opération était soumise à la procédure unique en application en application de l’article R. 214-42 du code de l’environnement.
En cas de travaux multiples et successifs, les porteurs de projets devront donc s’interroger sur le fait de savoir si ces travaux sont susceptibles d’être regardés comme une opération unique, laquelle justifiera le dépôt d’une unique demande au titre de la loi sur l’eau, et ce quand bien même ces travaux pris individuellement sont en dessous des seuils prévus par la nomenclature.
-

Une transaction conclue par une personne publique constitue-t-elle une reconnaissance de responsabilité susceptible d’ouvrir droit à indemnisation au profit des tiers ?
Par Rémi JABAKHANJI, Avocat
Le 27/03/2024
Conseil d’État, Section, 22 mars 2024, n°455107, Publié au recueil Lebon (A)
La conclusion d’un protocole transactionnel entre la victime principale d’un dommage et une personne publique a-t-elle pour effet d’ouvrir droit à indemnisation au bénéfice des tiers, notamment lorsqu’il implique la reconnaissance d’une faute, malgré l’effet relatif de ce contrat ?
Dans l’affirmative, le juge administratif peut-il écarter l’application d’une telle transaction en raison du non-respect de règles d’ordre public, tel que le principe général d’interdiction des libéralités ?
Concernant ces problématiques, la Section du contentieux du Conseil d’État a jugé qu’un protocole transactionnel signé entre une collectivité publique et la victime d’un dommage pour mettre un terme à une procédure mettant en cause sa responsabilité ne bénéficie pas aux tiers dans leur propre démonstration d’une faute de la personne publique, en ce compris les entités subrogées dans les droits de la victime (c’est-à-dire les assureurs).
Les tiers doivent donc prouver l’existence d’une faute et d’un lien de causalité direct et certain indifféremment de l’existence d’un tel protocole transactionnel.
- Rappel liminaire de l’intérêt et des limites d’une transaction conclue par une personne publique
L’article 2044 du Code civil définit la transaction comme étant « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
Bien que cet instrument ait été empiriquement perçu comme un outil relevant principalement du droit privé, la jurisprudence administrative a reconnu, de longue date, la faculté de l’administration d’y recourir, sous réserve de la licéité de son objet et de son contenu[1].
Parallèlement, dans une logique de préservation et de bonne gestion des deniers et biens publics, le Conseil d’État a dégagé un principe d’ordre public portant interdiction pour les personnes publiques de consentir des libéralités au profit de tiers[2]&[3].
Ce principe d’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités représente « une limite posée à leur liberté contractuelle afin de protéger les deniers publics dont elles ne sauraient disposer librement »[4] et fait obstacle à ce qu’elles contractent des obligations sans contrepartie suffisante[5].
On rappellera ici que ces principes ont été appliqués par la juridiction administrative s’agissant spécifiquement des protocoles transactionnels conclus par des personnes publiques, et ce alors même que le principe et l’étendue d’une éventuelle responsabilité (permettant par ailleurs d’apprécier une éventuelle disproportion des concessions d’une transaction) ne peuvent pas nécessairement être appréhendés de manière certaine tant qu’une juridiction ne s’est pas prononcée[6].
Ceci précisé, sous réserve de respecter les conditions légales et notamment ce principe de prohibition des libéralités, le recours à la transaction dans le cadre de litige en responsabilité est susceptible de présenter de nombreux avantages devant être considérés au cas par cas par les deux parties.
En ce sens, il résulte notamment d’une circulaire du Premier ministre datée du 6 avril 2011 que les personnes publiques sont encouragées à recourir à la transaction, sous réserve de respecter les règles de régularité tenant notamment à l’existence de concessions réciproques équilibrées.
La circulaire met d’ailleurs en avant les bénéfices d’un traitement rapide du litige, ainsi que les avantages économiques et les garanties associées au recours à une transaction amiable[7] :
« La règle des concessions réciproques ne signifie pas que la personne publique doit exiger de son cocontractant qu’il renonce à une partie de l’indemnisation qui lui est due, si le montant du dommage n’est pas contesté, en particulier, mais pas seulement, lorsqu’il a été établi par une expertise (cf. point 1.3.3 ci-dessus).
Dans un tel cas, la personne publique trouve avantage à la conclusion d’une transaction, en obtenant, en échange du versement immédiat du montant non contesté de la réparation intégrale du préjudice, l’assurance que ne sera pas remise en cause ultérieurement l’indemnisation versée ainsi que la certitude de ne pas avoir à payer les frais et les délais d’un contentieux, économisant ainsi à tout le moins d’éventuels intérêts moratoires. »
Encore faut-il que la transaction soit rédigée de manière particulièrement claire et précise, afin de couvrir l’ensemble des conséquences financières /subies par les différentes entités concernées par le litige, pour garantir l’efficacité juridique de la transaction, solder le contentieux naissant et éviter la remise en cause ultérieure du montant d’indemnisation convenu.
- Faits et procédure de la décision commentée
Si l’intérêt de la conclusion d’un protocole transactionnel se révèle souvent dans le domaine contractuel, notamment dans le cadre d’exécution de marchés publics ou de concessions (notamment à l’occasion d’opérations de travaux impliquant une pluralité d’acteurs), la décision commentée s’inscrit dans le cadre d’une action en responsabilité sur un fondement extracontractuel.
Dans cette affaire, un enfant souffrant de la maladie de Charcot-Marie-Tooth (neuropathie entraînant une diminution de la force musculaire et de la sensibilité) a été victime d’un traumatisme direct du membre inférieur alors qu’il participait à une activité de « soccer » organisée par le centre de loisirs local.
Ce dernier a été hospitalisé, a fait l’objet de différentes interventions chirurgicales et a subi in fine différents préjudices résultant de cet incident, lesquels ont été précisément déterminés et chiffrés dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Reprochant à la commune d’avoir fait preuve de négligence en laissant son fils participer à l’activité sportive organisée par le centre de loisirs, un représentant légal de la victime a engagé une action en responsabilité contre la collectivité.
Cette action indemnitaire de la victime était suivie par la CPAM en sa qualité d’assureur, afin d’obtenir indemnisation des débours engagés au titre de la prise en charge médicale de l’enfant.
En première instance, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la commune et le représentant légal de la victime ont finalement conclu un protocole transactionnel, intervenu uniquement entre la victime et la commune, visant à indemniser les différents préjudices subis par la victime[8].
Malgré le désistement de la victime requérante à raison de la conclusion dudit protocole, le tribunal administratif a condamné la commune à verser à la CPAM, agissant en qualité d’assureur de la victime, une somme d’environ 50 000 € correspondant aux débours engagés, à une indemnité forfaitaire en raison des frais qu’elle a dû engager pour être remplie de ses droits et aux intérêts moratoires.
La Cour administrative d’appel de Lyon a infirmé ce jugement, sans tenir compte du protocole transactionnel signé entre la victime et la personne publique et en appréciant, de manière souveraine, l’absence de faute de la commune, dès lors que les parents n’avaient pas pris soin d’alerter suffisamment les équipes du centre de loisirs[9].
Le Conseil d’État a été saisi d’un pourvoi introduit par la CPAM, visant à recouvrer l’intégralité des sommes correspondantes aux dépenses susmentionnées et dont l’indemnisation a été écartée par la Cour administrative d’appel. Il s’agit de la décision commentée.
- Les apports du Conseil d’État quant aux effets juridiques d’une transaction vis-à-vis des tiers
La Section du contentieux du Conseil d’État s’est prononcée, en substance, sur les questions suivantes :
1°) La transaction conclue entre la victime principale d’un dommage et une collectivité publique fait-elle naître un droit à indemnisation dont l’assureur, subrogé dans les droits de son assuré, pourrait se prévaloir à l’encontre de cette même administration publique ?
2°) Dans l’affirmative, le juge administratif peut-il écarter l’application d’une telle transaction en raison du non-respect de règles d’ordre public, telles que l’interdiction des libéralités ?
3°) Dans l’hypothèse où une telle transaction a été conclue, et quelle que soit la réponse aux deux questions précédentes, comment doit s’opérer le calcul des sommes dues à l’assureur au versement préalable d’une somme à la victime dans le cadre de la transaction ?
À ces différentes questions, le Conseil d’État s’est prononcé, sous la forme d’une décision de principe, comme suit :
« 3. S’il est loisible aux personnes publiques de conclure une transaction pour mettre un terme à une procédure mettant en cause leur responsabilité, les tiers à ce contrat ne peuvent se prévaloir d’un droit à indemnisation résultant de sa signature. Les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, qui régissent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale, n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger à cette règle et de permettre à ces caisses, dans l’exercice de ce recours à l’encontre d’une personne publique, d’invoquer un droit à indemnisation tiré des termes du règlement amiable conclu entre cette personne publique et un de leurs assurés ou ses ayants droit lorsqu’elles ne sont pas parties à ce règlement. La reconnaissance d’un tel droit, qui pourrait au demeurant contrevenir au principe suivant lequel les personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas, ne résulte d’aucune autre disposition législative. Il appartient dès lors au juge, lorsqu’il est saisi d’un recours subrogatoire par une caisse de sécurité sociale, de se prononcer au vu de l’instruction, sur l’existence d’une faute de la collectivité publique ou de tout autre fait de nature à justifier la prise en charge du dommage ainsi que d’un lien de causalité direct et certain avec les débours exposés. »
En synthèse, il s’infère de cette décision que :
- S’il est loisible aux personnes publiques de conclure une transaction, que ce soit pour mettre un terme à une procédure en cours mettant en cause leur responsabilité ou en vue de prévenir une telle action, les tiers ne peuvent se prévaloir d’un droit à indemnisation résultant de sa signature;
- Les dispositions régissant le recours subrogatoire des CPAM en tant qu’assureur[10], n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger à ce principe général ou de leur permettre, dans l’exercice d’un tel recours à l’encontre d’une personne publique, d’invoquer un droit à indemnisation tiré des termes de la transaction conclue avec son assuré, dès lors que les assureurs ne sont pas parties à cette transaction et compte tenu de l’effet relatif du contrat ;
- De manière générale, la haute juridiction précise que la reconnaissance d’un tel droit à indemnisation pourrait contrevenir au principe suivant lequel les personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas (libéralités) ;
- Il appartient dès lors au juge, lorsqu’il est saisi par un tiers (notamment d’un recours subrogatoire par un assureur d’une victime) de se prononcer quant à l’existence d’une faute de la collectivité publique, indifféremment de l’intervention du protocole transactionnel.
Cette solution mérite d’être rapprochée d’un arrêt récent de la Cour de cassation, par lequel il a été jugé que dans l’éventualité où la victime transige avec le tiers responsable sans avoir invité la caisse de sécurité sociale à participer à l’accord, cette dernière peut se prévaloir d’un droit à indemnisation sur le fondement de la transaction, le cas échéant en imposant la production du document[11].
Dans ses conclusions, le rapporteur public énumère les diverses raisons de droit s’opposant à l’appropriation de cette solution par la jurisprudence administrative, en relevant notamment que, sur le fondement du principe d’interdiction des libéralités, « l’équilibre de la transaction, et même sa régularité, seraient remis en cause s’il devait être considéré que celle-ci s’est implicitement engagée à indemniser intégralement la caisse, alors qu’elle ignorait le montant de ses débours »[12].
En tout état de cause, la décision commentée rappelle l’importance du périmètre des transactions conclues par les différents acteurs, publics comme privés.
Leur pleine efficacité juridique est conditionnée par la définition précise du périmètre de la transaction, c’est-à-dire la couverture de l’ensemble des préjudices subis par l’ensemble des parties impliquées (sauf à considérer des raisons stratégiques propres à chaque affaire).
[1] CE, 22 juin 1883, Ministre de la Marine c./ Corbet, Rec. CE p. 589.
[2] CE, 17 mars 1893, Compagnie du Nord et de l’Est et autres c. Ministre de la Guerre ; En matière d’indemnisation : CE Sect., 19 mai 1971, Mergui, n°79962 ; ou de transaction : CE Ass., avis contentieux du 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal du district de l’Hay-les-Roses, n° 249153.
[3] Il s’agit également d’un principe à valeur constitutionnelle : Cons. const, Décision du 26 juin 1986 n° 86-207 DC ; V. également Cons. const., 17 déc. 2010, Région Centre et région Poitou-Charentes, Décision n°2010-67/86 QPC.
[4] Concl. G. PELLISSIER sous CE 9 décembre 2016, Société Foncière Europe, n°391840.
[5] Étant précisé que ce contrôle a été dernièrement resserré par la juridiction administrative ; voir en ce sens : « L’octroi d’une facilité de paiement par une personne publique est susceptible de caractériser un avantage constitutif d’une libéralité ».
[6] CAA de Versailles, 13 mai 2015, n°13VE03220.
[7] Circulaire n°PRMX1109903C du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits.
[8] Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1er octobre 2019, n° 1701654.
[9] CAA de Lyon, 1er juin 2021, 19LY04392.
[10] Articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale.
[11] Civ. 1re, 21 avril 2022, n° 20-17.185.
[12] Concl. Rapporteur public Florian Roussel sur CE, 22 mars 2024, n° 455107.
-

Transmission du mémoire en réclamation au maître d’œuvre : quels sont les apports de l’arrêt du 2 février 2024 ?
Par Célia Tessier, Avocate collaboratrice
Le 21/03/2024
CE, 2 février 2024, Société Valenti, n°471122
Par un arrêt rendu le 2 février 2024, le Conseil d’état acte le caractère impératif de la transmission du mémoire en réclamation au maître d’œuvre dans les délais fixés par le CCAG Travaux. (CE, 2 févr. 2024, n° 471122, Sté Valenti).
Dans la lignée des décisions rendues par les juges du fond, le Conseil d’état avait déjà constaté l’irrecevabilité d’une réclamation qui n’avait pas été portée à la connaissance de la maitrise d’œuvre.
Toutefois, ces décisions étant rendues au visa des dispositions du CCAG Travaux 1976 et des éclaircissements étaient donc attendus concernant les exigences fixées par le CCAG Travaux 2009.
Par l’arrêt commenté, la Haute juridiction rappelle que : « dans le cas d’un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délais de quarante-cinq jours compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d’œuvre dans le même délai ».
En l’espèce, pour respecter le délai de quarante-cinq jours fixé par le CCAG Travaux applicable à son marché, le titulaire avait jusqu’au 24 juin 2019 pour notifier son mémoire en réclamation.
Si cette notification au pouvoir adjudicateur a été faite dans les délais requis, le titulaire a néanmoins omis d’en adresser une copie au maitre d’œuvre, ce dernier n’ayant été rendu destinataire des réclamations du titulaire que le 25 juin 2019.
Faisant une stricte application des délais imposés par le CCAG TRAVAUX, la haute juridiction a considéré que la transmission du mémoire en réclamation par le titulaire était tardive et retenu que le décompte général était devenu définitif.
Outre le respect du formalisme prévu par les dispositions du CCAG, cette solution a le mérite d’assurer la bonne exécution de son devoir de conseil par le maitre d’œuvre, lequel doit assister la maîtrise de l’ouvrage lorsque celle-ci se voit notifier un mémoire en réclamation par le titulaire du marché.
A noter que les dispositions du CCAG 2021 actuellement en vigueur sont presque identiques et devront recevoir la même interprétation, étant précisé que le délai de quarante-cinq jours laissé au titulaire pour notifier ses réclamations est aujourd’hui de trente jours.
Les titulaires de marchés publics devront donc continuer de porter une attention particulière aux délais qui leur sont laissés pour faire valoir leurs réclamations et ne pas omettre de les porter à la connaissance de la maitrise d’œuvre.
-

Clarification de la motivation des certificats d’urbanisme opérationnel
Par Benoît PERRINEAU, Avocat associé, et Enagnon Virgile GBEMOUDJI
Le 21/03/2024
Commentaire de la décision CAA Lyon, 20 février 2024, req. n°22LY03400
Par cet arrêt du 20 février 2024, la Cour administrative d’appel de Lyon apporte des précisions sur la motivation des certificats d’urbanisme opérationnel opposant un sursis à statuer à une demande d’autorisation d’urbanisme.
Selon la Cour, un sursis à statuer doit indiquer les raisons qui justifient que le maire est susceptible de s’opposer à une demande de non-opposition à une déclaration préalable ou à un refus de permis de construire.
Il appartient ainsi aux maires de préciser « le cas de figure » qui pourrait impliquer une décision de sursis à statuer.
La Cour a ainsi jugé que le sursis à statuer opposé à une demande de CU opérationnel portant sur un lotissement de six lots d’habitation était insuffisamment motivé : l’état d’avancement du PLU permettait de savoir que le terrain était classé en zone agricole par le projet de PLU et de connaître les dispositions de ce document d’urbanisme susceptible de s’opposer au projet.
Il appartient ainsi aux collectivités de justifier suffisamment dans les certificats d’urbanisme opérationnels les raisons qui pourraient entraîner un sursis à statuer.
Les opérateurs pourront ainsi disposer de précisions, dans l’hypothèse où ils entendent mener un projet dans un contexte où le PLU est révisé ou nouvellement élaboré, sur les motifs de l’éventuel sursis à statuer qui pourrait leur être opposé.
-

Une réforme annoncée de la loi SRU
Par Sophie Imbault, Avocate associée
Le 06/03/2024
Conformément à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et sous réserve de certaines dérogations, les communes doivent en principe comprendre sur leur territoire, au moins 25 % de logements locatifs sociaux.
Ce dispositif dit « SRU » dont l’échéance initiale était fixée pour 2025, a été pérennisé par la loi du 21 février 2022 dite « 3DS ».
Aux termes de son discours de politique générale en date du 31 janvier 2024, le Premier ministre Gabriel Attal a fait part de la volonté de faire évoluer la loi SRU :
- « D’une part, les maires auront enfin la main pour la première attribution des logements sociaux dans leurs communes. »
- « D’autre part, les logements intermédiaires, accessibles à la classe moyenne seront désormais inclus dans le calcul de la part de logement social, dans le cadre de la loi SRU. »
(i) Sur le renforcement du rôle des maires dans l’attribution des logements sociaux, il peut être relevé qu’une proposition de loi a été adoptée par le Sénat en première lecture, déposée à l’Assemblée nationale le 10 octobre 2023.
Cette proposition vise notamment à modifier l’article L. 441-2 du CCH afin d’accorder la présidence des Commissions d’Attribution de Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements (Caleol) au maire en lieu et place, à droit constant, d’un représentant de l’organisme HLM.
Également, la voix prépondérante en cas de partage du maire deviendrait un droit de véto. Dans le cas d’une Caleol intercommunale, le représentant de l’EPCI en aurait la présidence.
Le Sénat a instauré par amendement un siège de représentant du conseil départemental à la Caleol.
Sur la base d’un amendement, encore, les organismes HLM devraient créer une commission de concertation chargée de suivre les programmes de constructions neuves jusqu’à leur date de livraison, qui serait présidée par le maire de la commune concernée.
Il ne ressort pas clairement du discours de politique générale que l’ambition annoncée se confonde nécessairement avec cette proposition de loi émanant de Mme Sophie Primas, sénatrice. A cet égard, il sera relevé que le discours de politique général mentionne la « première attribution » des logements, alors que la proposition de loi vise à un renforcement plus pérenne et systématique, dans le cadre des Caleol.
Les débats parlementaires à intervenir sur cette proposition et/ou le dépôt d’un éventuel projet de loi distinct du gouvernement devra donc faire l’objet d’un suivi attentif.
Cette réforme ne manquera pas d’interroger sur l’autonomie actuelle des organismes, via leurs Caleol.
Il semble par ailleurs qu’un axe de renforcement via les conventions de réservation dont les communes peuvent, sous certaines conditions, être bénéficiaires, n’ait pas été retenu dans le cadre des évolutions envisagées.
(ii) Sur la prise en compte des logements intermédiaires au titre du décompte SRU, il convient de rappeler que la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi ELAN prévoyait déjà l’intégration de nouvelles catégories de logements à l’inventaire SRU, « assimilés » à des logements locatifs sociaux :
- les logements en location-accession (PSLA) occupés ayant fait l’objet de la signature d’un contrat de postérieurement à la publication de la loi ELAN, et ce pour une durée de 5 ans suivant la levée d’option ;
- et, depuis le 1er janvier 2019, les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire (BRS).
S’agissant de ces dispositifs, si l’assimilation aux logements « locatifs » nécessite effectivement une exception, elle demeure cohérente eu égard à leur nature (logements « sociaux), dès lors qu’ils relèvent de la mission de service d’intérêt économique général (SIEG) des organismes d’HLM, définie à l’article L. 411-2 du CCH.
Tel n’est pas le cas des logements locatifs intermédiaires (LLI), hors-SIEG depuis le 1er janvier 2020, qui ne sont donc pas des logements « sociaux » et qui ne sont pas soumis, par ailleurs, à une attribution par les Caleol.
Ainsi, cette annonce n’a pas manqué de susciter de vives réactions. Les craintes exprimées sont notamment relatives à une substitution progressive des logements intermédiaires, au détriment des logements sociaux.
Ces craintes pourraient éventuellement être apaisée par encadrement des modalités d’intégration du logements intermédiaires (par exemple : limitation dans le temps de l’assimilation au titre du décompte SRU et/ou pourcentage maximal de LLI pris en compte à ce titre). En l’état, ces modalités ne sont pas annoncées.
Nous suivrons donc avec attention les évolutions envisagées, probablement dans le cadre d’un projet de loi à débattre courant 2024.
-

Objectif de souveraineté alimentaire et achats publics : quelles options pour les acheteurs ?
Par Baptiste JAFFRE, Avocat collaborateur
Le 15/02/2024
Alors que la prise de fonction du nouveau premier ministre, Gabriel Attal, était marquée par une forte contestation du monde agricole, son discours de politique générale était particulièrement attendu.
Parmi les différentes annonces, le Premier ministre a notamment indiqué qu’un objectif de souveraineté alimentaire serait inscrit dans la loi sans s’étendre davantage sur le sujet.
Selon le dictionnaire d’agroécologie, la « souveraineté alimentaire est un droit des populations à décider de leurs propres stratégies et politiques pour garantir leur sécurité alimentaire tout en considérant les effets sur les autres. Elle garantit, par le biais de choix d’alimentation mais aussi de politiques agricoles ou commerciales, l’accès à une alimentation saine et durable. Il s’agit d’un concept global où social, économie, politique et environnement sont étroitement mêlés, et qui suppose une capacité d’accès aux ressources (foncier, eau, semences…) nécessaires pour répondre aux besoins des populations » ^1 .
Aussi, on est en droit de s’interroger sur la portée de la déclaration du premier ministre et notamment sur ses implications en matière de commande publique et s’il faut y voir l’avènement d’une forme de préférence nationale davantage assumée.
Tout d’abord force est de rappeler qu’en matière de fourniture de denrées alimentaires les acheteurs publics sont soumis aux obligations prévues par les lois dites « EGALIM 1 » du 30 octobre 2018 et « climat et résilience » du 22 août 2021. A cet égard, l’article L.230-5-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit en particulier l’obligation pour les « repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge » d’inclure, au plus tard le 1er janvier 2022, une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits durables et de qualité (au moins 20% pour les produits biologiques) ; obligation portée à 60%, à compter du 1er janvier 2024, pour les viandes bovines, porcines, ovines et de volailles et les produits de la pêche (100% pour les restaurants collectifs gérés par l’Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales).
La recherche d’un objectif de souveraineté alimentaire doit nécessairement concilier, du moins en ce qui concerne la commande publique, d’une part, la promotion plus ou moins assumée d’une forme de localisme, et d’une seconde part, les principes de libre accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur.
Si au regard de la jurisprudence du juge administratif et du juge européen, il n’est évidemment pas permis d’envisager de favoriser certains produits en raison de leur origine, il serait faux de penser que l’arsenal juridique à la disposition des acheteurs publics ne permettrait pas de favoriser certaines bonnes pratiques en matière de fourniture de denrées alimentaires et les produits locaux.
D’une première part, aux termes des dispositions de l’article R.2152-7 du code de la commande publique, les acheteurs peuvent avoir recours à plusieurs critères portant sur la qualité des produits qui s’exprime notamment au travers des « conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ».
Ainsi, plusieurs sont les acheteurs qui, dans le but de privilégier indirectement l’achat local et les circuits courts, mettent notamment en œuvre des critères liés au temps de transport ou aux émissions de CO2.
Ensuite et comme le rappelle fréquemment le gouvernement notamment au travers de réponses ministérielles^2 , les critères de jugement ne sont pas les seuls outils pour permettre de favoriser l’achat local.
A ce titre, et si tant est que le rappel soit utile, il est ainsi recommandé aux acheteurs de définir précisément leurs besoins, d’allotir leurs marchés mais aussi d’avoir recours aux procédés de sourçage afin de favoriser l’accès et la participation de PME à la commande publique. Il est par ailleurs intéressant de souligner que dans le prolongement de l’entrée en vigueur de la loi EGALIM, l’Etat a mis à la disposition des acheteurs des guides pratiques afin de favoriser l’achat local tout en conciliant les impératifs liés au droit de la commande publique.
Cependant, et s’il existe manifestement une volonté politique de dynamiser l’achat responsable et local s’agissant des produits alimentaires, le chemin apparait encore long en témoignent les résultats du bilan statistique mentionné par l’article L.230-5-1 du code rural et de la pêche maritime qui, pour les données d’achat 2021, fait apparaitre que seuls 11,5% des déclarants, ne représentant eux même que 10% de la totalité des sites concernés, atteignent les obligations de l’article L.230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Dans ces conditions, on peut légitimement se demander en quoi pourra consister l’inscription d’un objectif de souveraineté alimentaire dans la loi tel que souhaité par Gabriel Attal et s’il ne pourrait pas être envisagé des exceptions en matière de commande publique, à l’image de ce qui existe par exemple pour les marchés dont le montant est inférieur aux seuils de publicité et de mise en concurrence, afin d’inciter davantage les acheteurs publics à se tourner vers un achat plus local et plus durable.
^1 Dictionnaire d’agroécologie, Elienay Dutra, Jean Blancheteau, Amélie Gonçalves, Frédéric Wallet, https://dicoagroecologie.fr/dictionnaire/souverainete-alimentaire/
^2 Rep. min. n°24584 : JOAN, 19 novembre 2019, p.10057, Potterie B.
Rep. min. n°5110 : JOAN, 31 janvier 2023, p. 791, Paulac P
Rep. min. n°09159 : JO Sénat, 28 février 2019, p. 1083, SOLLOGOUB N.
-

Les premières épreuves en perspective des JO ont d’abord lieu devant le juge : Syndicat étudiants vs CROUS de Paris
Par Yossra ABASSI, Avocate collaboratrice
Le 07/02/2024
CE, 29 décembre 2023, CROUS de Paris, n°488337
« 100 euros et deux places pour assister aux épreuves olympiques » : c’est la contrepartie promise par la ministre de l’enseignement supérieur, en octobre 2023 pour dédommager les étudiants au logement réquisitionné pour loger les agents publics mobilisés pour les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 !
C’est par courriel que les étudiants concernés ont appris la nouvelle.
Le CROUS de Paris a informé les étudiants occupants des résidences universitaires d’Ile-de-France que 7% des résidences franciliennes allaient être réquisitionnées pour accueillir le personnel mobilisé pour l’organisation et la bonne tenue des JO 2024.
Exceptionnellement, le droit d’occupation du logement des étudiants concernés et bénéficiant d’un renouvellement de logement prendra fin pour cette année, le 30 juin 2024.
Compte tenu des inquiétudes exprimées par les étudiants, le sénateur M. Pierre-Antoine LEVI s’est saisi du sujet pour adresser une question parlementaire, le 25 mai 2023[1] au gouvernement l’invitant à préciser les mesures envisagées pour minimiser les nuisances causées aux étudiants et garantir un relogement effectif sur la période considérée.
Le ministre délégué chargé de la ville et du logement a apporté une réponse en séance publique, le 2 juin 2023[2] en rappelant d’abord le contexte : « près de 30 % des étudiants résidant dans les logements des Crous quittent définitivement leur hébergement, de sorte que ces chambres peuvent être proposées à de nouveaux étudiants pour la rentrée suivante. En Île-de-France, plus de 7 000 hébergements Crous sont ainsi libérés chaque année entre les mois de juin et de septembre ».
Différents scenarios sont alors envisagés :
- Pour les résidents qui souhaiteraient continuer d’être hébergés pendant l’été, ceux-ci auraient la garantie de l’être pour le même loyer ;
- Pour les étudiants qui n’auraient pas l’usage d’un hébergement pendant l’été, ils ne seraient pas redevables des loyers estivaux et bénéficieraient exceptionnellement de la garantie de pouvoir récupérer un logement dès le 1er septembre ;
- Enfin, pour les nouveaux résidents, une mention spéciale serait visée sur le site de candidature à un logement CROUS.
Le ministre a également annoncé que des missions rémunérées, ainsi que des billets allaient être offerts pour les résidents contraints de libérer leur logement.
Le gouvernement a aussi pris officiellement l’engagement de ne pas « mettre en péril les étudiants et leurs études ».
Ces engagements n’ont toutefois pas suffi.
Par une requête du 15 août 2023, le syndicat Solidaires étudiant-e-s – syndicat de luttes, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, de suspendre l’exécution de la décision par courriel de réquisitionner et d’affecter les logements des résidences universitaires de Paris à l’accueil des volontaires et des partenaires des jeux olympiques pour la période courant du mois de juillet 2024 au mois de septembre 2024 et de consentir un droit d’occupation au bénéfice des étudiants pour l’année 2024 avec un terme au 30 juin 2024.
Le juge des référés a rendu une ordonnance de suspension le 31 août 2023[3] considérant que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision, du détournement de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation, étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Un pourvoi en cassation est formé devant le Conseil d’Etat par le CROUS de Paris.
Le Conseil d’administration du CROUS de Paris a adopté postérieurement au pourvoi, une délibération en date du 6 novembre 2023 pour fixer les modalités de mise à disposition des logements et de relogement des étudiants.
Ladite délibération devenant exécutoire, le pourvoi perdait, en tout état de cause, son objet et devenait donc irrecevable.
Dans ses conclusions[4], le rapporteur public, Monsieur Raphaël CHAMBON, invitait toutefois le juge, compte tenu des enjeux et du contexte, à surmotiver sa décision pour clarifier l’état du droit notamment dans une perspective d’anticipation d’éventuels recours contre ladite délibération.
Ainsi, de manière très pédagogique, la décision du Conseil d’Etat rappelle en premier lieu les missions du CROUS définies par le code de l’éducation[5] et la mission de service public dont sont investis les centres régionaux.
La question qui se posait en l’espèce, était donc de savoir si le CROUS pouvait limiter au 30 juin 2024 le droit d’occupation des résidents.
Les résidents sont liés par un « contrat de location »[6] tout à fait particulier, puisqu’ils s’acquittent d’une redevance d’occupation[7], précaire, à l’instar des autorisations d’occupation du domaine public.
Le Conseil d’Etat considère en l’espèce que « si, en vertu des dispositions de l’article L. 822-1 du code de l’éducation, le réseau des œuvres universitaires a pour mission de contribuer à assurer aux étudiants une qualité d’accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation, notamment en matière de logement, aucune disposition législative ne fait obstacle à ce qu’un centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévoie que la mise à disposition de logements étudiants, dont la durée de location ne peut excéder un an, prenne fin le 30 juin, ce qui correspond, en règle générale, à la fin de l’année de formation dispensée dans les établissements d’enseignement supérieur ».
En d’autres termes, aucune disposition ne fait obstacle au relogement des étudiants bénéficiant d’un logement universitaire, au sein d’une autre résidence.
En second lieu, l’article L.631-12-1 du CCH dispose que « par dérogation à l’article L. 631-12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois s’achevant au plus tard le 1er octobre de l’année suivante, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l’Etat au sens de l’article L. 441-1 ».
Ces dispositions constituent une base légale suffisante pour permettre au CROUS de Paris de louer les logements des résidences inoccupés pour la période des JO puisque la location visée par cet article n’est pas réservée aux seuls publics reconnus prioritaires[8].
Depuis lors, le CROUS de Paris a précisé les modalités de mise en œuvre de ces réquisitions, à retrouver sur son site internet[9] : sont concernés par ce dispositif 4 résidences[10] et 1251 logements !
[1] Question de M. Levi Pierre-Antoine, 25 mai 2023, page 3311
[2] Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, 2 juin 2023, page 4705
[3] TA de Paris, juge des référés, 31 août 2023, n° 2319295
[4] Conclusions du rapporteur public de la décision commentée, Monsieur Raphaël CHAMBON
[5] Articles L.822-1 ; R.822-1 ; R.822-2 ; R.822-9 du code de l’éducation
[6] CE, 1 mars 1995, Commune de Saint-Martin d’Hères, n°138473
[7] CAA Bordeaux, 16 mai 2017, n°15BX01592
[8] Article L.441-1 du CCH (personnes en situation de handicap, personnes mal logées, personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée, personnes exposées à des situations d’habitat indigne …)
[9] CROUS de Paris, Hébergement JO 2024 : accompagnement de nos résidents
[10] Résidence Francis de Croisset (18e arrondissement), 396 places – Résidence Poissonniers (18 e arrondissement), 283 places – Résidence Nicole Reine Lepaute (13 e arrondissement), 207 places – Résidence Jourdan (14 e arrondissement), 365 places.
-
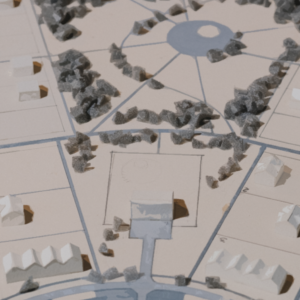
Demande d’autorisation d’urbanisme : le régime des modifications en cours d’instruction
Par Cléophée de MALATINSZKY
Le 01/02/2024
Par un arrêt n°448905 du 1er décembre 2023, le Conseil d’Etat a clarifié le régime et les incidences des modifications d’un projet en cours d’instruction d’une autorisation d’urbanisme.
Cet arrêt était particulièrement attendu dans la mesure où aucune disposition dans le code de l’urbanisme ne prévoit la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer son projet en cours d’instruction de sa demande d’autorisation.
Il s’agit pourtant d’une pratique fréquente de la part des pétitionnaires, qui peuvent souhaiter faire évoluer leur projet, par exemple du fait d’éventuels échanges avec les services instructeurs.
Le Conseil d’Etat vient ainsi entériner un tel usage, admis par les autres juridictions, autorisant à apporter des modifications mineures à un projet en cours d’instruction (CAA Nancy, 7 février 2019, n° 18NC01631) sans déclencher un nouveau délai d’instruction (TA Paris, 7 octobre 2010, n° 0814892 ; CAA Versailles, 28 janvier 2022, n° 20VE01270).
Premièrement, le Conseil d’Etat limite les modifications pouvant être apportées au projet avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite aux « modifications qui n’en changent pas la nature ». Dans ce cas, le pétitionnaire doit adresser une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié.
La notion de changement de nature du projet n’est pas nouvelle puisqu’elle est également utilisée pour déterminer si des modifications apportées à un projet après la délivrance d’une autorisation expresse ou tacite peuvent faire l’objet d’un permis modificatif (CE, 26 juillet 2022, n° 437765).
Le pétitionnaire pourra donc raisonner par analogie sur les décisions déjà rendues par le juge administratif au titre des demandes de permis modificatif pour déterminer si les modifications apportées à son projet en changent ou non sa nature.
Le Conseil d’Etat opère ainsi une harmonisation des régimes de modification des projets avant et après délivrance expresse ou tacite de l’autorisation d’urbanisme.
Deuxièmement, concernant les effets des modifications sur le délai d’instruction, le Conseil d’Etat considère que ces dernières sont en principe sans incidence sur la date de naissance d’un permis tacite.
Néanmoins, lorsque, du fait de l’objet, l’importance ou la date à laquelle les modifications sont présentées, leur examen ne peut pas être mené à bien dans le délai d’instruction initial, l’administration peut prescrire un nouveau délai aux termes duquel la demande modifiée sera réputée acceptée. L’administration doit toutefois informer le pétitionnaire « par tout moyen » de cette nouvelle date avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite. A défaut, une décision tacite sera réputée née.
Dans cette hypothèse dérogatoire (en cas d’évolution – a priori relativement importante du projet, l’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception des pièces nouvelles. Elle peut alors demander au pétitionnaire, dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, toute pièce manquante nécessaire à l’examen du projet modifié.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel au motif qu’elle n’a pas recherché si les modifications apportées au projet, par l’envoi de pièces nouvelles le 27 octobre et 25 novembre 2016, portant, d’une part, sur l’implantation d’un ouvrage d’art et, d’autre part, sur l’insertion paysagère du parking, n’étaient pas susceptibles d’influer sur la date de naissance du permis tacite fixée au 29 novembre 2016.
-

L’indemnisation du cocontractant d’une personne publique en cas de résiliation pour invalidité du contrat
Par Alizée GEBRE, Avocate collaboratrice
Le 22/01/2024
L’affaire commentée porte sur l’indemnisation du titulaire d’un marché public de location – en l’espèce d’un photocopieur – résilié par la personne publique cocontractante en raison de l’invalidité du contrat (CE, 13 octobre 2023, Société CM-CIC Leasing Solutions, req. n°461079). Le Conseil d’Etat était interrogé sur la possibilité pour le cocontractant d’être indemnisé de la part non amortie du photocopieur et de son coût d’achat au titre des dépenses utiles.
Cette décision permet à la Haute juridiction d’ancrer sa jurisprudence sur le régime général de l’indemnisation du cocontractant d’une personne publique en cas de résiliation pour invalidité du contrat (1.) et de préciser le périmètre de la notion de dépenses utiles en matière de marchés publics (2.).
1. L’indemnisation du cocontractant d’une personne publique dont le contrat a été résilié pour invalidité
Rappelons tout d’abord que la possibilité – exercée en l’espèce – pour une personne publique de résilier unilatéralement un contrat administratif au motif de son illégalité (cas spécifique de résiliation distinct de celui pour motif d’intérêt général) a été consacré par le Conseil d’Etat en 2020 (Conseil d’Etat, 10 juillet 2020, Société négoce équipements, req. n°430864). Cette jurisprudence a ensuite été circonscrite aux hypothèses où la personne publique ne peut pas faire usage de son pouvoir de modification unilatérale pour remédier à l’irrégularité (CE, 8 mars 2023, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC), req. n° 464619).
La création de ce cas spécifique de résiliation s’accompagne de la mise en place d’un régime spécifique également d’indemnisation du cocontractant de la personne publique. A cet égard et pour mémoire, le titulaire d’un marché public dont le contrat a été résilié pour invalidité peut ainsi prétendre :
- à être indemnisé sur le terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il été engagé (avant la prise d’effet de la résiliation les conséquences financières étant régies par l’application du contrat),
- à être indemnisé sur le terrain quasi-délictuel, dans le cas où l’irrégularité du contrat résulte d’une faute de l’administration, et sous réserve d’un partage de responsabilité, du dommage imputable à la faute de cette dernière.
Ce régime d’indemnisation n’est pas sans rappeler celui établi, de longue date, aux contrats administratifs entachés de nullité, pour lesquels le cocontractant de l’administration peut prétendre, sur le terrain quasi-contractuel, au remboursement des dépenses utiles (CE 19 avr. 1974, Sté entreprise Louis Segrette, Lebon T. 1052).
La jurisprudence susvisée relative à ce cas spécifique de résiliation, dont l’affaire commentée en est une nouvelle application, donne ainsi lieu à l’indemnisation du cocontractant sur les mêmes bases que celles liées à l’annulation du contrat
Dans ce cadre, la détermination des dépenses utiles à la personne publique dont le titulaire demande le remboursement revêt une importance déterminante.
2.Les contours de la notion de dépenses utiles en marché public
Le Conseil d’Etat reprenant le considérant de principe de la décision du 17 juin 2022 (CE, 17 juin 2022, société Lacroix City Saint-Herblain, req. n°454189) rappelle le périmètre des dépenses utiles dans le cadre des contrats de marché public :
- sont inclues, « à l’exclusion de toute marge bénéficiaire, les dépenses qui ont été directement engagées par le cocontractant pour la réalisation des fournitures, travaux ou prestations destinés à l’administration. Ne peut être prise en compte que la quote-part des frais généraux qui contribue à l’exécution du marché et est à ce titre utile à la personne publique » ;
- sont exclus, « les frais de communication ainsi que, dans le cas où le contrat en cause est un marché public et sauf s’il s’agit d’un marché de partenariat, les frais financiers engagés par le cocontractant ».
De manière générale, les contours de la notion de dépense utile avaient été dessinés par le Président Dacosta dans ses conclusions sur la décision de section Decaux : « la notion de dépenses utile (…) englobe non seulement les dépenses directes engagées au profit de l’administration, mais aussi les dépenses indirectes , charges diverses et frais généraux. L’indemnité à laquelle donne droit l’application du principe de l’enrichissement sans cause est limitée au profit que la collectivité a retiré des prestations accomplies, mais ce profit doit être calculé en intégrant l’ensemble des dépenses que la collectivité a ainsi évité d’engager »( concl. B. Dacosta sur CE, 10 avril 2008, société Decaux, req. n°244950 cité dans concl. M. Le Corre sur CE, 17 juin 2022, société Lacroix City Saint-Herblain, req. n°454189) .
La rapporteure publique Mirelle Le Corre, dans ses conclusions sur la décision du 17 juin 2022, plaidait à cet égard en faveur d’une appréciation de la notion de dépenses utiles « au cas par cas », « susceptible de dépendre du type de contrat ».
La présente affaire témoigne de l’approche différenciée de la notion de dépenses utiles selon le type de contrat en cause. Le Conseil d’Etat précise ainsi que le titulaire d’un marché public ne peut pas être indemnisé au titre des dépenses utiles de la valeur non amortie du bien qu’il loue – et qu’il a donc préalablement acquis à cette fin – mais dont il demeure propriétaire, au contraire de sa jurisprudence rendue en matière de concessions de service public.
Cette différence s’explique aisément. Certes en cas de résiliation d’un marché public de louage d’un bien, il est possible qu’au moment de la résiliation, le titulaire du marché n’ait pas amorti la valeur du bien, à l’instar d’un concessionnaire de service public. Néanmoins, dès lors qu’il demeure propriétaire du bien, le titulaire conserve la possibilité de continuer à exploiter et valoriser ce bien (par exemple en le louant à nouveau ou en le cédant). Aussi, il pourra in fine amortir son investissement initialement affecté au marché public résilié dans le cadre d’autre contrats.
A contrario, en matière de concession de service public, le concessionnaire doit être indemnisé de la valeur non amortie des biens de retour. En effet, les biens nécessaires au fonctionnement du service public qui constituent les biens de retour, même acquis ou réalisés par le concessionnaire, appartiennent à l’autorité concédante ab initio et lui font retour au terme – anticipé ou non – du contrat. Aussi, en cas de résiliation, le concessionnaire est susceptible de ne pas avoir amorti son investissement alors que l’autorité concédante pourra jouir du bien. La solution serait différente en cas de bien de reprise, ne revenant pas à l’autorité concédante à la fin normale ou anticipée de la concession
Le Conseil d’Etat précise également que le coût d’achat d’un bien ne relève pas de la catégorie des frais financiers contrairement à la qualification apportée par la Cour administrative d’appel, dès lors que pour être qualifié de frais financier, il aurait fallu démontrer que l’achat du matériel avait donné lieu à un emprunt. En tout état de cause, le requérant n’aurait pas eu plus de succès en demandant l’indemnisation de frais liés à un emprunt. Selon le même raisonnement exposé supra, les frais financiers permettant l’acquisition d’un bien restant la propriété du titulaire à l’issue normale ou anticipée du marché ne peuvent être considérés comme utiles à la personne publique.
-

Politique urbaine : l’importance des leviers fiscaux pour les acteurs publics
Par Margaux TRIPIER, Avocate collaboratrice & Valentine VERSPIEREN, Alternante
Le 21/12/2023
Dans la mise en œuvre de leur politique urbaine, les collectivités locales ont tout intérêt à exploiter pleinement les dispositifs fiscaux disponibles.
Parmi ceux-là, les dispositifs d’allégement de taxation des plus-values immobilières, encouragés par le législateur dans le cadre de la loi de finances pour 2024, apparaissent comme des leviers fiscaux déterminants d’incitation à la cession auprès des collectivités, à travers des ventes volontaires comme des acquisitions par voie de préemption.
Parmi les régimes de faveur concernant la taxation des cessions immobilières, ne doivent pas être négligés les mécanismes permanents d’exonération de la cession de la résidence principale et d’abattements pour durée de détention (CGI, art. 150 U, II-1° et 150 VC).
De même dans le cadre d’acquisitions par des collectivité locales, peut aussi être rappelée l’existence du dispositif d’exonération, sous condition de remploi des sommes, des plus-values résultant de cession de biens pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation (CGI, art. 150 U, II-4° et 5°).
Au-delà de ces dispositifs permanents, le législateur n’a de cesse de réitérer sa volonté d’incitation à la revalorisation urbaine à travers l’adoption de différents mécanismes par principe temporaires et, en pratique, régulièrement prorogés.
Ainsi, parmi les mécanismes susceptibles d’intéresser les collectivités locales dans la mise en œuvre de leurs projets urbains, relevons l’abattement exceptionnel de 60 % ou 85 %, instauré par la loi de finances pour 2021 et étendu dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, sur les plus-values sur les cessions réalisées dans le périmètre d’une opération de revitalisation du territoire (ORT), d’une grande opération d’urbanisme (GOU), ou désormais des opérations d’intérêt national (OIN) (CGI, art . 150 VE ; PLF 2024, article 3 sexies).
Un autre dispositif a retenu l’attention du législateur dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024 : l’exonération des plus-values des cessions conduisant à la production de logements sociaux.
En effet, les plus-values de cessions immobilières réalisées par les personnes physiques peuvent être exonérées lorsque les cessionnaires s’engagent à y construire des logements sociaux ou assimilés.
Cette exonération est soumise à certaines conditions, telles que :
- Le contribuable doit être une personne physique ou une société ou un groupement passible de l’IR ;
- Le bien cédé doit être un immeuble bâti ou non bâti, une partie d’immeuble ou un droit relatif à ces biens ;
- Le bien cédé ne doit pas être situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Pour les cessions réalisées au profit d’organismes en charge du logement social (organismes HLM, sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux, associations foncières logement notamment), l’exonération est totale lorsque la part de logement sociaux construits dépasse 80% de la surface totale des constructions. Le contribuable n’est alors redevable d’aucun d’impôt sur la plus-value réalisée, nonobstant l’usage ou la durée de détention du bien.
A défaut, et pour les cessions réalisées au profit des autres cessionnaires, l’exonération est accordée au prorata de la surface des logements sociaux à construire.
Ce dispositif d’exonération est également ouvert aux cessions réalisées au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou de certaines sociétés en vue de leur cession, dans le délai d’un an prorogeable, à un organisme en charge du logement social qui s’engage, lui, à construire lesdits logements sociaux.
Le législateur n’a de cesse d’encourager la mise en œuvre contrôlée de ce dispositif.
En effet, afin de réserver le bénéfice de celui-ci aux opérations qui aboutissent réellement à la construction de logements sociaux, de nouvelles obligations ont été mises à la charge des cessionnaires. Il a notamment été prévu que l’engagement devait être formalisé par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition (loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 14).
Dans le cadre d’un dossier suivi par le cabinet, il a pu être établi que cette formalité ne faisait pas, pour autant, obstacle à l’application de ce régime au cas d’une acquisition par voie de préemption.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2024, en cours de discussion, confirme la prorogation de ce dispositif aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2025, alors qu’il devait expiré à la fin de l’année 2023 (PLF 2024, article 3 sexies).
Ces quelques exemples attestent de l’importance des mesures fiscales mises en place pouvant s’avérer des leviers puissants pour les collectivités dans leur politique urbaine afin de dynamiser et revaloriser leurs territoires.
-

Dommages-intérêts alloués à la victime : il ne doit en résulter pour elle ni perte ni profit
Par Anne RENAUX, Avocate collaboratrice
Le 15/12/2023
Par un arrêt rendu en date du 28 septembre 2023, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation a retenu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (Cass. 3e Civ. 28 sept. 2023, n°22-19.475).
En l’espèce, une SCI a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, un programme de promotion immobilière concernant la construction d’un immeuble collectif de vingt et un logements.
Dans le cadre de la réalisation de cette opération de construction, le maître d’ouvrage a confié à un architecte la mission de maîtrise d’œuvre de conception, comprenant le dépôt de la demande de permis de construire, et la réalisation des plans d’exécution.
Cependant, le chantier a été interrompu pendant près de six mois, en raison de la plainte de riverains, alléguant que la hauteur de la construction menaçait d’excéder les spécifications du permis, ainsi que les règles du plan local d’urbanisme.
Dans ces conditions, une demande de permis de construire modificatif a été déposée, afin de réduire la hauteur des faîtages. Malgré son obtention, le maître d’ouvrage a assigné le maître d’œuvre en référé expertise, et sollicité l’indemnisation de ses préjudices financiers, étant précisé que ce dernier a formulé, à titre reconventionnel, une demande tendant au paiement du solde de ses honoraires, soit la somme de 18.000 euros TTC.
Par jugement contradictoire de première instance, le Tribunal a déclaré le maître d’œuvre entièrement responsable du préjudice subi par le maître d’ouvrage, du fait de l’erreur de conception affectant les plans de l’immeuble, et l’a condamné au paiement de la somme de 246.708 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice. De surcroît, le Tribunal a débouté le maître d’œuvre de sa demande reconventionnelle.
Partant, le maître d’œuvre a interjeté appel de ce jugement.
Se fondant sur les constats de l’expert judiciaire, la Cour d’appel a considéré que, de sa propre initiative, le maître d’œuvre avait modifié les plans d’exécution par rapport à ceux du permis de construire, afin de permettre l’accès aux garages, cette modification étant, pour les juges du fond, à l’origine du dépassement de la hauteur maximale du bâtiment imposée par le plan local d’urbanisme. Considérant qu’il était le seul responsable de l’erreur d’implantation, la Cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, jugeant, en outre, que le maître d’ouvrage était en droit d’opposer l’exception d’inexécution des obligations de son cocontractant.
Cela étant, le maître d’œuvre s’est pourvu en cassation, faisant notamment grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’avoir rejeté sa demande en paiement du solde de ses honoraires, alors qu’elle l’avait condamné à indemniser le préjudice du maître d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La Troisième Chambre civile de la Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement particulièrement détaillé et motivé des juges du fond : au visa de l’ancien article 1149 du Code civil (désormais article 1231-2), correspondant à l’un des fondements de la réparation du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle, la Cour de cassation a rappelé le principe de réparation intégrale du préjudice, qui implique que le responsable du dommage doit indemniser la victime de tout le dommage, sans qu’il en résulte pour elle ni appauvrissement, ni enrichissement.
Aux termes de cet arrêt, la Haute Juridiction a considéré que la Cour d’appel avait violé les dispositions et le principe susvisés, en retenant que le maître d’ouvrage était en droit d’opposer l’exception d’inexécution des obligations de son cocontractant pour refuser de payer le solde de ses honoraires.
Aussi, la Cour de cassation a souligné que le maître d’œuvre avait été condamné à indemniser le maître d’ouvrage des conséquences des fautes qu’il avait commises, de sorte qu’il avait intégralement réparé le préjudice subi par son cocontractant : selon la Haute Juridiction, la Cour d’appel ne devait pas, au surplus, faire bénéficier le maître d’ouvrage de l’absence de paiement du solde des honoraires du maître d’œuvre.
A cet égard, il convient d’observer que cet arrêt est particulièrement notable, dans la mesure où la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation, juge du droit, a rejeté l’appréciation in concreto des juges du fond, et modéré la réparation de la victime.
De longue date, la réparation du préjudice de la victime a pour dessein de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage en la replaçant dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu (Cass. 2e Civ. 28 oct. 1954, no 1767, Bull. civ. II, no 328). Il s’en évince que la réparation ne peut excéder le montant du dommage (Cass. 1re Civ. 25 mars 2003, n°00-21.114), ni le montant du préjudice (Cass. 1re Civ. 22 nov. 2007, n°06-14.174).
Dans cette veine, la Cour de cassation a dégagé le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime (Cass. 2e Civ. 23 janv. 2003, n°01-00.200 ; Cass. 2e Civ. 5 juill. 2001, n°99-18.712), que semble désormais appliquer la Troisième Chambre civile.
-

Obligation de notifier à compter du 1er janvier 2024 les recours formés contre les autorisations environnementales
Par Emmeline BOITEL, Avocate collaboratrice
Le 07/12/2023
On rappellera tout d’abord que l’article 23 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a modifié l’article L. 181-17 du code de l’environnement en introduisant une obligation de notification des recours contre des autorisations environnementales à l’auteur de la décision et au porteur de projet, sous peine d’irrecevabilité.
Inspirées du dispositif que l’on retrouve codifié à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ces nouvelles dispositions visent notamment à sécuriser les porteurs de projets.
L’article L. 181-17 du code de l’environnement indique que les contours de cette nouvelle obligation de notification doivent être précisés par un décret en Conseil d’Etat.
C’est désormais chose faite, avec la publication, au Journal Officiel du 29 novembre 2023, du décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales.
Les conditions d’application de cette obligation de notification sont définies aux articles R. 181-50 et R. 181-51 du code de l’environnement.
L’obligation de notification concerne les recours administratifs (gracieux ou hiérarchiques) et contentieux introduits à l’encontre de l’autorisation environnementale mais également des décisions suivantes :
- La décision de rejet de la demande d’autorisation environnementale au cours de la phase d’examen (L. 181-9 alinéa 4 du code de l’environnement) ;
- La demande de tierce-expertise (L. 181-13 du code de l’environnement) ;
- La décision par laquelle l’autorité administrative impose des prescriptions complémentaires
(L. 181-13 du code de l’environnement) ; - La nouvelle autorisation environnementale délivrée à la suite d’une modification substantielle du projet (L. 181-14 du code de l’environnement) ;
- La nouvelle autorisation environnementale délivrée dans le cadre d’une prolongation ou d’un renouvellement en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit ayant présidé à la délivrance de l’autorisation initiale (L. 181-15 du code de l’environnement) ;
- Le changement de bénéficiaire de l’autorisation environnementale (L. 181-15 du code de l’environnement) ;
- La décision de transfert partiel de l’autorisation environnementale (L. 181-15-1 du code de l’environnement) ;
- La décision refusant de retirer ou d’abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire (R. 181-51 du code de l’environnement).
Les sanctions attachées au non-respect de cette obligation sont, d’une part, la non-prorogation du délai de recours contentieux en cas de recours administratif, et d’autre part, l’irrecevabilité du recours contentieux.
A l’instar de ce que l’on retrouve en droit de l’urbanisme, la notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif.
Ce nouveau dispositif s’appliquera aux autorisations environnementales et arrêtés complémentaires pris à compter du 1er janvier 2024.
-

Le Conseil d’Etat précise les pouvoirs de régularisation du juge des ICPE
Par Cléophée de MALATINSZKY, Avocate collaboratrice
Le 28/11/2023
CE, 10 nov. 2023, n°474431
Dans un avis du 10 novembre 2023 (n°474431), le Conseil d’Etat a précisé dans quelles conditions les outils dont dispose le juge en vue de la régularisation des autorisations environnementales peuvent également s’appliquer dans le cas des installations soumises à enregistrement.
Pour mémoire, les installations classées pour la protection de l’environnement (ci-après « ICPE ») soumises à enregistrement sont celles qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement (à la différence des ICPE soumises à déclaration) qui peuvent néanmoins être prévenus par le respect de prescriptions générales (à la différence du régime d’autorisation).
Les sites relevant du régime d’enregistrement sont aujourd’hui les plus nombreux et seraient plus de 22 000^1.
Pour autant, alors que le juge des ICPE bénéficie de moyens de régularisation des autorisations environnementales afin de prescrire des injonctions moins contraignantes que l’annulation, de tels outils étaient jusqu’alors inapplicables dans le cas des ICPE soumises à enregistrement.
En effet, l’article L. 181-18 du code de l’environnement prévoit que le juge administratif doit, uniquement lorsqu’il est saisi de conclusions contre une autorisation environnementale, et après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés :
- soit sursoir à statuer pour permettre, si les vices sont régularisables, la régularisation de l’autorisation environnementale ;
- soit, lorsque le vice qu’il retient n’affecte qu’une partie de la décision ou une phase seulement de la procédure, limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce.
Par le présent avis, le Conseil d’Etat étant le champ d’application de l’article L. 181-18 au projet :
- faisant l’objet, en application du 7° du paragraphe I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement ;
- ou soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du même code.
Dans les autres cas, les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne sont pas applicables.
Néanmoins, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des ICPE (article L. 514-6 du code), le juge administratif peut :
- s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision.
- lorsque l’annulation n’affecte qu’une partie seulement de la décision, déterminer s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties non viciées de cette décision.
- lorsque l’annulation n’affecte qu’une partie seulement de la décision, au titre de son office de juge de plein contentieux, autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation de l’installation en cause, dans l’attente de la régularisation de sa situation par l’exploitant.
^1 Conclusions sous l’avis du 10 novembre 2023 n° 474431 : « 22.136 sites enregistrés contre 20.557 sites autorisés, selon les dernières données publiées par le ministère. Au total 526 arrêtés préfectoraux d’autorisation environnementale et 770 arrêtés préfectoraux d’enregistrement ont été pris en 2022 ».
-

Loi Climat et Résilience : le Conseil d’Etat annule un alinéa du décret sur l’artificialisation des sols
Par Damia KACETE, Avocate collaboratrice & Giulietta RANIERI, Alternante
Le 22/11/2023
CE, 4 oct. 2023 Associations des maires de France, n°465341
Par une décision du 4 octobre 2023, le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité du décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme.
Pour rappel, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, plus communément nommée « loi Climat et Résilience », a fixé un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols à atteindre à l’horizon 2050.
La réduction de l’artificialisation s’opère de façon progressive par une limitation de la transformation d’espaces agricoles, forestiers et naturels en espaces urbanisés.
Le nouvel article L. 102-2-1 du code de l’urbanisme introduit par cette loi a défini, dans leurs grandes lignes, les notions de surfaces artificialisées et de surfaces non artificialisées et a renvoyé à un décret en Conseil d’Etat le soin d’établir « une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme ».
C’est dans ce cadre que le décret attaqué n° 2022-763 du 29 avril 2022 a prévu, au sein d’un nouvel article R. 101-1 du code de l’urbanisme (2e alinéa du II) que « l’occupation effective est mesurée à l’échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence précisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme selon les standards du Conseil national de l’information géographique ».
Par cette décision du 4 octobre 2023, le Conseil d’État a annulé l’alinéa 2 du II de l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme en raison de l’imprécision du terme « polygones » employé dans la définition des zones artificialisées :
« En se référant à la simple notion de « polygone », et en renvoyant, pour la définition de la surface de ces derniers, à un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et aux standards du Conseil national de l’information géographique, lesquels ne font pas l’objet d’une définition par décret en Conseil d’Etat, les auteurs du décret attaqué ne peuvent être regardés comme ayant établi, comme il leur appartenait de le faire en application des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme ».
En effet, ce terme ne livre en réalité aucune indication sur l’échelle à laquelle l’artificialisation et la non-artificialisation doivent être concrètement appréciées.
De plus, le renvoi aux standards du Conseil national de l’information graphique ne permet pas d’encadrer suffisamment le pouvoir règlementaire dès lors, notamment, que ces derniers n’ont pas de caractère contraignant.
Aussi, une définition du terme « polygone » par décret en Conseil d’Etat s’avérait nécessaire.
Le Conseil d’Etat a ainsi estimé qu’en s’abstenant de le faire, les auteurs du décret attaqué n’ont pas respecté l’obligation qui leur incombait en application de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme précité. Il a donc, sur ce fondement, annulé l’alinéa 2 de l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme du décret attaqué.
Il convient de relever que deux nouveaux décrets de mise en œuvre du ZAN ont été annoncés par le Gouvernement, et d’ores-et-déjà soumis à consultation publique.
-

L’octroi d’une facilité de paiement par une personne publique est susceptible de caractériser un avantage constitutif d’une libéralité
Par Rémi JABAKHANJI, Avocat collaborateur
Le 10/11/2023
CAA de PARIS, Formation plénière, 22 septembre 2023, Commune de Bagnolet, n°22PA02509 (C+)
L’arrêt commenté constitue une nouvelle illustration du resserrement opéré par la jurisprudence s’agissant du contrôle des contreparties financières d’un contrat conclu par une personne publique (i).
Dans les circonstances propres à cette affaire, la Cour administrative de Paris a considéré que les stipulations prévoyant un paiement échelonné sans intérêt du prix de cession d’un bien immobilier étaient constitutive d’un avantage sans contrepartie (ii).
i. Rappel sur le principe d’interdiction pour les personnes publiques de consentir une libéralité
Dans une logique de préservation et de bonne gestion des deniers et biens publics, le Conseil d’État a consacré, de longue date, un principe d’ordre public portant interdiction pour les personnes publiques de consentir des libéralités au profit de tiers^(1&2) .
Ce principe d’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités représente « une limite posée à leur liberté contractuelle afin de protéger les deniers publics dont elles ne sauraient disposer librement^3 » et fait obstacle à ce qu’elles contractent des obligations sans contrepartie suffisante. L’absence de libéralité constitue une condition de validité des actes édictés ou conclus par une personne publique.
Sur le fondement de ce principe, le juge administratif contrôle notamment les concessions réciproques consenties par les parties dans le cadre du contrat faisant l’objet du litige et sanctionne les disproportions manifestement excessives lorsqu’elles sont au détriment de la personne publique.
Par une décision récente^4 , le Conseil d’État a d’ailleurs rehaussé l’exigence jurisprudentielle s’agissant du degré de contrôle sur l’interdiction pour une personne publique de consentir des libéralités, dans le cadre spécifique d’un litige portant sur la fixation d’une indemnité de résiliation d’un contrat (en l’occurrence un bail emphytéotique).
Le contrôle restreint à la disproportion manifeste est délaissé par le Conseil d’État au profit d’un contrôle entier du caractère excessif ou non de l’indemnité de résiliation au regard du préjudice subi par le cocontractant de l′administration^(5&6) .
Dans le cadre de ce contrôle, toute indemnisation supérieure (et non plus manifestement disproportionnée) au regard des obligations financières contractuellement prévues sera susceptible d’être sanctionnée par le juge administratif^7 .
Le risque qui résulte de la qualification d’une libéralité ne porte pas uniquement sur la régularité de l’acte ou de la clause en question : il existe également un risque de responsabilité personnelle des gestionnaires publics.
Dans certaines conditions et généralement dans les situations les plus graves, l’existence d’une libéralité peut également être constitutive d’une infraction financière et/ou pénale d’octroi d’un avantage injustifié (articles L. 131-12 du code des juridictions financières et 432-14 du code pénal).
Il peut par exemple s’agir :
- de la conclusion d’un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable^8 ou du recours injustifié à une procédure de passation inadaptée^9 ;
- d’un avenant modifiant substantiellement l’économie du marché^10 ou d’autres irrégularités de nature à traduire un manquement aux règles d′ égalité^11 ;
- voire même du versement d’une avance remboursable supérieure à ce que prévoyaient les documents contractuels d’un marché^12 .
ii. Le paiement échelonné et sans intérêt du prix de cession d’un bien constitutive d’une libéralité
Dans l’affaire commentée, le conseil municipal d’une commune a approuvé par délibération, d’une part, la résiliation d’un bail emphytéotique cultuel relatif à un terrain communal conclu avec une association cultuelle et, d’autre part, autorisé la cession du terrain ayant fait l’objet de ce bail au bénéfice de cette dernière.
Il ne sera pas développé dans le cadre du présent commentaire le régime spécifique des baux emphytéotiques cultuels et l’apport de l’arrêt s’agissant de l’articulation de ce régime avec le caractère dérogatoire à la loi du 9 décembre 1905 qui interdit toute aide à l’exercice d’un culte, ou encore de la possibilité de résilier un tel bail.
Il est cependant rappelé succinctement que les articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales permettent de recourir au bail emphytéotique « en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public » et que « ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif » ^13 .
Au cas d’espèce, la délibération litigieuse de la commune prévoyait la cession à l’association cultuelle du terrain ayant fait l’objet du bail emphytéotique administratif résilié, pour un prix fixé 950 000 € HT, conformément à l’avis du service des domaines.
Dans son arrêt, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement de premier ressort et l’annulation de ladite délibération, considérant l’existence de l’octroi d’un avantage sans contrepartie constitutif d’une libéralité résultant du paiement échelonné sur 4 ans du prix de la cession du terrain, sans perception d’intérêt par la commune :
« 12. Si la loi du 9 décembre 1905 ne fait pas obstacle à la résiliation anticipée d’un tel bail, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure son application en ce qui concerne les conditions financières dans lesquelles le bien objet de ce contrat est cédé. L’application de la loi du 9 décembre 1905 implique que cette cession soit effectuée dans des conditions qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide directe ou indirecte à un culte.
13. En l’espèce, le prix de cession du terrain d’assiette et la valeur de la renonciation de la commune au droit de devenir propriétaire de l’édifice cultuel en fin de bail ont été fixés par la commune de Bagnolet à la somme totale de 950 000 euros hors taxes, soit un montant identique à celui proposé par les services des domaines. Or la commune n’établit ni même ne soutient qu’elle aurait pris en compte dans son estimation l’avantage, pourtant indissociable du prix, consistant en un paiement échelonné sans intérêt de plus d’un quart du montant total de la somme due, selon quarante-huit mensualités. Ainsi, la commune doit être regardée comme ayant consenti un avantage, sans contrepartie, ayant pour effet de minorer le prix de cession du bien en deçà de sa valeur réelle et, par suite, comme ayant versé à l’association une subvention proscrite par les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905.»
Il résulte de l’arrêt précité que :
- De manière générale, l’octroi d’une facilité de paiement sans perception d’intérêt d’une somme due à une personne publique est susceptible d’être constitutif d’un avantage octroyé sans contrepartie, et donc, in fine, d’une libéralité ;
- Au cas d’espèce, le prix de vente du bien immobilier cédé doit tenir compte de l’avantage indissociable tenant à l’octroi d’un paiement échelonné sans intérêt ; à défaut l’octroi d’une modalité de paiement échelonné représentant « plus d’un quart du montant total de la somme due » a eu pour conséquence une minoration du prix de vente, caractérisant l’octroi d’un avantage sans contrepartie.
La Cour administrative d’appel en tire les conséquences en jugeant que cet avantage octroyé sans contrepartie est proscrit par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 et confirme l’annulation de la délibération.
Aucun principe ne paraît faire obstacle à la transposition de cette solution pour d’autres contrats que les baux emphytéotiques cultuels, dès lors que le principe d’ordre public de prohibition des libéralités est applicable de manière générale aux personnes publiques (l’arrêt évoque par ailleurs qu’une aide cultuelle directe ou indirecte est assimilable à une libéralité).
À ce titre, le gain généré par un paiement échelonné et sans intérêt d’une somme due à une personne publique au titre d’un contrat pourrait être assimilé à une libéralité, sous réserve d’un examen au cas par cas des conditions de l’acte et des principes dégagés par la jurisprudence administrative (par exemple, l’existence d’une contrepartie au bénéfice de la personne publique liée à l’existence d’un motif d’intérêt général^14 ).
^1 CE, 17 mars 1893, Compagnie du Nord et de l’Est et autres c. Ministre de la Guerre ; En matière d’indemnisation : CE Sect., 19 mai 1971, Mergui, n°79962 ; ou de transaction : CE Ass., avis contentieux du 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal du district de l’Hay-les-Roses, n° 249153.
^2 Il s’agit également d’un principe à valeur constitutionnelle : Cons. const, Décision du 26 juin 1986 n° 86-207 DC ; V. également Cons. const., 17 déc. 2010, Région Centre et région Poitou-Charentes, Décision n°2010-67/86 QPC.
^3 Concl. G. PELLISSIER sous CE 9 décembre 2016, Société Foncière Europe, n°391840.
^4 CE, 16 décembre 2022, Société Grasse-Vacances, n° 455186.
^5 Ibid.
^6 Concl. T. PEZ-LAVERGNE sur CE, 16 décembre 2022, Société Grasse-Vacances, n° 455186 : « Nous vous proposons de rehausser vos exigences et de les porter au niveau de celles du Conseil constitutionnel afin d’assurer le bon usage des deniers publics et d’envoyer un signal aux collectivités publiques parfois généreuses dans l’allocation amiable d’indemnités à leurs cocontractants. Si vous nous suivez, vous abandonnerez la référence à la « disproportion manifeste » et veillerez à ce que l’indemnité corresponde au préjudice et n’excède pas sa réparation ».
^7 Il ressort des conclusions du rapporteur public que le rehaussement du degré de contrôle vise à aligner la jurisprudence administrative avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel ».
^8 Cass. Crim. 25 juin 2008, n°07-88373.
^9 Cass. Crim, 17 octobre 2007, 06-87.472
^10 Cass. Crim, 22 janvier 2014, N° 13-80759
^11 Cour d’appel de Grenoble, 15 mars 2022.
^12 Cass., Crim., 9 sept. 2020, n° 19-85.374.
^13 Article L1311-2 du code général des collectivités territoriales
^14 Concl. G. Le Chatelier sur CE, ass., avis, 6 déc. 2002, Syndicat intercommunal du district de l’Hay-les-Roses, n° 249153 ; CAA de Bordeaux (formation plénière), 30 décembre 2019, Bordeaux Métropole, 19BX03235 ; CE, 14 octobre 2015, Cne Chatillon-sur-Seine, n° 375577.
-

Liquidation de l’entrepreneur principal : quelles conditions de l’exercice de l’action directe du sous-traitant ?
Par Célia TESSIER, Avocate collaboratrice
Le 02/11/2023
Par un arrêt rendu le 13 juillet 2023, la Cour de cassation reprécise les conditions d’exercice de l’action directe du sous-traitant à l’encontre de la maîtrise de l’ouvrage en cas de liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal. (Cass, 3ème civ, 13 juillet 2023, n°21-23.747, FS, Publié au bulletin).
Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. (Loi n°75-1334, 31 décembre 1975, article 12, alinéa 1 et 3).
En l’espèce, une société avait engagé, sous sa maîtrise d’ouvrage, des travaux de construction d’un immeuble à usage d’habitation dont une partie avait été sous-traitée par l’entrepreneur principal.
Par un jugement rendu le 12 juin 2014, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’entrepreneur principal sans que ce dernier n’ai réglé les sommes dues au titre du contrat de sous-traitance.
Le sous-traitant a alors adressé une lettre mettant en demeure l’entrepreneur principal de régler les sommes dues et notifié une copie de cette mise en demeure à la maîtrise de l’ouvrage.
Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 9 août 2021, les juges du fond ont considéré que le sous-traitant avait valablement exercé l’action directe prévue par la loi, retenant que la circonstance que l’entrepreneur principal était en liquidation judiciaire était indifférente, tout comme l’absence de déclaration de créance au passif de cette société.
Selon l’arrêt d’appel, la loi n’impose pas au sous-traitant d’adresser la copie de la mise en demeure dans un certain délais au maître de l’ouvrage. (CA Versailles, 9 août 2021, n°19/047811.
Cela étant, il avait déjà été précisé en jurisprudence que le sous-traitant devait, en cas de liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal, effectuer une déclaration de créance à la procédure collective, laquelle tenait lieu de mise en demeure dont une copie devait être notifiée à la maîtrise de l’ouvrage. (Cass, Com, 9 mai 1995, n°93-10.568, Publié au bulletin, Cass, Com, 12 mai 1992, 89-17.908, Publié au bulletin).
Par l’arrêt rendu le 13 juillet 2023, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et considère qu’en l’absence de mise en demeure préalable à la liquidation judiciaire, seule la déclaration de créance vaut mise en demeure de l’entrepreneur principal.
-

La prescription trentenaire n’est pas applicable à l’action en démolition d’un ouvrage public irrégulièrement implanté
Par Yossra ABASSI, Juriste
Le 25/10/2023
Que reste-t-il de l’adage « un ouvrage public même mal planté ne se détruit pas » ? En théorie, plus rien !
Depuis le revirement de jurisprudence opéré par le Conseil d’Etat dans sa décision Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes Maritimes c/ commune de Clans^1, du 29 janvier 2003, il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à la démolition d’un ouvrage public, de déterminer, eu égard à la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statut, s’il y a lieu de procéder ou non à la démolition de l’ouvrage au termes d’un bilan coûts-avantages.
Le 29 novembre 2019, les juges du Palais Royal, ont apporté une nouvelle pierre à cet édifice jurisprudentiel, dans l’affaire M.P^2 , en admettant que le juge du plein contentieux puisse être saisi directement d’une demande aux fins de démolition d’un ouvrage public irrégulièrement implanté.
À cette occasion, le rapporteur public M. Guillaume Odinet, abordait notamment l’opportunité d’introduire une prescription à l’action en démolition. Favorable, il concluait en ce sens « que le régime jurisprudentiel défini sur la base de {la} décision Commune de Clans ne peut être « bouclé » sans qu’y figure une règle de prescription du droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage public. Et, en l’absence de texte spécial, nous croyons qu’il vous revient, sinon de faire directement applicable des règles du code civil, du moins de vous référer aux principes dont elles s’inspirent – c’est-à-dire, en réalité, à un principe qui prévoit que le droit administratif s’en inspire en les transposant » ^3.
Certaines Cours administratives d’appel, notamment de Nantes^4, de Nancy^5, ou encore de Lyon^6, se sont ainsi référées à la prescription trentenaire pour apprécier l’action en démolition.
Le 27 septembre^7 dernier, saisi d’un différend portant sur l’implantation d’un pylône, le Conseil d’Etat a mis un coup d’arrêt à cet élan et précisé aux juges du fond les modalités de mise en œuvre de leur office.
Dans les faits de l’espèce de la décision commentée, Mme A. D. et Mme C. B. respectivement nue-propriétaire et usufruitière d’une propriété située dans la commune de Villers-en-Arthies, demandaient à la société Enedis de procéder à la dépose d’un pylône implanté sur leur terrain et de réparer les préjudices qu’elles invoquent.
Face au rejet opposé par la société Enedis, les intéressées ont fini par saisir le tribunal administratif compétent d’une demande en annulation de ladite décision.
Par un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté les demandes formulées par les requérantes.
Par un arrêt du 2 juin 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a enjoint à la société Enedis de procéder à la dépose du pylône et au déplacement ou à l’enfouissement de la ligne électrique dans un délai de six mois.
Enfin, un pourvoi en cassation a été formé par la société Enedis devant la haute juridiction administrative.
Après avoir rappelé le cadre juridique applicable aux actions en démolition d’un ouvrage public irrégulièrement implanté, le Conseil d’Etat répond à la question de savoir si la prescription trentenaire prévue à l’article 2227 du code civil est applicable aux actions en démolition des ouvrages publics implantés irrégulièrement.
En premier lieu, la décision rappelle les étapes du contrôle d’une demande en démolition de l’ouvrage public situé sur une propriété privée :
1° En premier lieu, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté,
2° Si tel est le cas, il recherche d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible,
3° Si la régularisation n’est pas possible, en tenant compte de l’écoulement du temps, le juge prend en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraine pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général et d’apprécier en rapprochas ces éléments, si la démolition n’entraine pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En second lieu, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé les dispositions de l’article 2227 du code civil relatives à la prescription trentenaire, se fonde sur les spécificités de l’action en démolition d’un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée, pour écarter la prescription civile jugée inopérante.
En effet, « ni ces dispositions, ni aucune autre disposition ni aucune principe prévoyant un délai de prescription ne sont applicables à une telle action ».
Les juges du Palais Royal rejoignent les conclusions de la rapporteure publique Mme Dorothée Pradines, qui proposait de retenir une solution plus adaptée au régime existant et d’amender « légèrement le considérant P… pour souligner ce qui était déjà sous-jacent à savoir l’écoulement du temps doit être pris en compte dans le contrôle du bilan. {…} L’écoulement du temps pourra, selon les cas, jouer pour ou contre le maintien de l’ouvrage » ^8.
En d’autres termes, nul besoin de se référer à la prescription trentenaire, l’écoulement du temps suffit pour permettre au juge d’apprécier le bien-fondé d’une demande en démolition.
En l’espèce, pour rejeter la demande des requérantes, le Conseil d’Etat a considéré, dans le cadre de son contrôle du bilan, qui intègre l’effet de l’écoulement du temps, « qu’en dépit de l’ancienneté de la présence de ces ouvrages, les intéressées n’ont pas sollicité de mesures tendant à leur déplacement avant que commune de Villers-en-Arthies ne décide de procéder à l’enfouissement de certaines lignes électriques par délibération du 7 mars 2014 de son conseil municipal sans intégrer la ligne litigieuse dans ce projet ».
L’argument du refus opposé au projet de construction de la piscine par la mairie en raison des risques liés au surplomb par la ligne électrique, est écarté, considérant que ce projet était de circonstance au regard de la chronologie des faits.
Aux termes du contrôle du bilan, il a été jugé qu’eu égard aux inconvénients causés aux intéressées, la présence de l’ouvrage sur leur propriété n’était pas de nature à justifier une démolition.
Le Conseil d’Etat rejette en conséquence la demande d’injonction tendant à la dépose du pylône et au déplacement ou à l’enfouissement de la ligne électrique, ainsi que les demandes en réparation des préjudices invoqués.
2003-2023, 20 ans plus tard, un contrôle du bilan achevé ?
^1 CE, Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes Maritimes c/ commune de Clans, 29 janvier 2003, n°245239
^2 CE, M.P, 29 novembre 2019, n°410689
Conclusions du rapporteur public, M. Guillaume Odinet, CE, M.P, 29 novembre 2019, n°410689
^3 CAA Nantes, 21 février 2020, n°17NT03861
^4 CAA Nancy, 16 mars 2021, n°20NC00531
^5 CAA Nancy, 16 mars 2021, n°20NC00531
^6 CAA Lyon, 28 juillet 2022, n°22LY00971
^7 CE, Mme A. D. et Mme C. B. c/ société Enedis, 27 septembre 2023, n°466321
^8 Conclusions de la rapporteure publique, Mme Dorothée Pradines, décision commentée
-

Sous-traitance de travaux : la dispense du maître d’ouvrage de vérifier la date d’octroi de la garantie de paiement au sous-traitant
Par Marie BLANDIN, Avocate collaboratrice
Le 19/10/2023
Dans un arrêt récent de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2023 (Civ. 3e, 6 juill. 2023, FS-B, n° 21-15.239), la question de la vérification de la date de remise de la garantie de paiement au sous-traitant par le maître d’ouvrage a été une nouvelle fois examinée, permettant de clarifier l’obligation du maître d’ouvrage en matière de sous-traitance.
La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 énonce l’obligation du maître d’ouvrage de vérifier certains aspects des contrats de sous-traitance. Cependant, selon l’arrêt commenté, cette obligation ne s’étend pas au contrôle de la date précise à laquelle la garantie de paiement a été délivrée, que ce soit avant ou simultanément à la signature du contrat de sous-traitance.
En effet, l’affaire traitée dans cet arrêt concerne un maître d’ouvrage, qui avait confié des marchés de construction à un entrepreneur principal, lequel avait ensuite sous-traité une partie des travaux.
Lorsque le sous-traitant a fait l’objet d’une procédure collective, il a invoqué la nullité des contrats de sous-traitance en raison de la délivrance tardive de la garantie de paiement, qui n’avait pas été remise avant ou conjointement à la conclusion du contrat de sous-traitance.
La question soulevée dans cette affaire était donc de savoir si le maître d’ouvrage devait s’assurer que la garantie de paiement avait été remise en temps utile, c’est-à-dire avant ou lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, conformément à l’article 14-1 de la loi de 1975.
En l’occurrence, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence établie, selon laquelle, dès lors que le maître d’ouvrage a connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier, il doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de présenter ses conditions de paiement et de fournir une caution personnelle et solidaire si nécessaire, conformément audit article 14-1 de la loi de 1975.
Aux termes de cet arrêt, la Cour souligne que tant que le maître d’ouvrage s’assure que la caution est remise au bénéfice du sous-traitant à la date à laquelle il constate l’existence du contrat de sous-traitance, il remplit ses obligations en vertu de l’article 14-1, et ce, quelle que soit la date précise de remise de la garantie de paiement.
Ainsi, l’argument de la nullité du contrat de sous-traitance en raison de la tardiveté de la garantie de paiement a été rejeté !
Cet arrêt de la Cour de cassation a donc une incidence importante sur la manière dont les maîtres d’ouvrage doivent gérer leurs obligations en matière de sous-traitance, en confirmant une approche restrictive de l’article 14-1 de la loi de 1975, et laissant aux maîtres d’ouvrage une certaine marge de manœuvre dans le processus de vérification de la sous-traitance, tout en maintenant la protection du sous-traitant.
-

Violences urbaines et commande publique : quels sont les apports de l’ordonnance n°2023-660 du 26 juillet 2023
Par Baptiste JAFFRE, Avocat collaborateur
Le 10/10/2023
Immédiatement après la promulgation de la loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 relative à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023, a été publiée, sur la base de son article 2, l’ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 portant diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique.
Si cette ordonnance brille sans conteste par son apparente simplicité, sa lecture attentive amène toutefois plusieurs questionnements.
A notre sens, la première interrogation qui se pose est d’ordre général quant à l’opportunité même de prévoir de telles dérogations au droit de la commande publique.
En effet, et si tant est qu’il soit besoin de le rappeler, le code de la commande publique prévoit d’ores et déjà des dispositifs permettant de déroger aux obligations de publicité et de mise en concurrence afin de faire face à des circonstances exceptionnelles.
Ainsi, l’article R.2122-1 du code de la commande publique dispose notamment que :
« L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu’une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et qu’il ne pouvait pas prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. »
Par ailleurs, et indépendamment de circonstances exceptionnelles, lorsque le besoin n’excède pas un certain seuil (40 000 euros pour les marchés de fournitures et de service et 100 000 euros pour les marchés de travaux), l’acheteur n’est pas tenu de mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence et peut conclure un marché de gré à gré.
Toutefois, il semble qu’aux yeux du Gouvernement ces dérogations n’étaient a priori pas suffisantes ou satisfaisantes pour permettre aux acheteurs de surmonter sereinement les difficultés nées des émeutes.
A ce titre, l’étude d’impact rendue sur le projet de loi considérait que les obligations de publicité et de mise en concurrence pouvaient « être perçues dans certaines circonstances comme des freins à l’efficacité de l’action publique » et qu’il était donc « nécessaire de prévoir un levier supplémentaire permettant d’accélérer et de simplifier les procédures de passation des marchés de travaux réfection et la reconstruction des bâtiments et équipements publics afin de rétablir dans les meilleurs délais la continuité et le fonctionnement normal des services publics. ». Les délais de publicité seraient ainsi trop longs et formeraient un obstacle à une reconstruction efficace ce dont on peut douter.
Ensuite, même si pour ce qui est du recours aux dispositions de l’article R.2122-1 précité l’appréciation de la condition d’urgence doit se faire au cas par cas, les nombreux dégâts provoqués par les émeutiers nous semblaient pouvoir aisément relever de ce dispositif. En procédant par voie d’exception, il est permis de se demander dans quelle mesure est-ce que le Gouvernement n’a pas découragé les acheteurs d’avoir recours à ces dispositions en donnant l’impression que les travaux de réparation nécessitaient une nouvelle procédure exceptionnelle.
S’agissant des apports de l’ordonnance du 26 juillet 2023, son article 1er dispose que :
« Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par des dégradations ou destructions liées aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 1 500 000 d’euros hors taxes.
Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 1 000 000 d’euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. »
L’ordonnance introduit ainsi une procédure inédite prévoyant une mise en concurrence mais sans publicité préalable ce qui amène à se poser plusieurs questions :
- Sur quelle base l’acheteur sélectionne-t-il les opérateurs qu’il entend mettre en concurrence ?
- Que faire si, d’initiative et sans qu’il y ait été invité, un opérateur souhaite participer à la mise en concurrence ?
- Un opérateur qui n’aurait pas été convié à participer à la procédure de mise en concurrence pourrait-il tout de même en tirer un intérêt lésé dans le cadre d’un référé précontractuel ou d’un recours au fond (alors même que les chances de succès de telles procédures sont limitées déjà en MAPA) ?
- Si, comme l’explique l’étude d’impact, les mesures de publicité sont perçues comme des freins par les acheteurs pour faire face aux dégradations liées aux émeutes, mais qu’en même temps la condition de l’urgence de l’article R.2122-1 du code de la commande n’est pas satisfaite puisque c’est cette hypothèse que l’ordonnance semble vouloir couvrir, n’aurait-il pas été préférable de maintenir l’obligation de publicité quitte, le cas échéant, à l’assouplir, pour autant que cela eut été pertinent, de manière à se prémunir contre les interrogations précédentes ?
La simple dérogation aux obligations de publicité nous parait avoir qu’un bénéfice limité sur les délais des procédures au regard des délais de publicité des marchés passés selon une procédure adaptée.
Ainsi, nous doutons que l’élan simplificateur proposé par l’ordonnance du 26 juillet 2023 le soit réellement et il est permis de se demander s’il n’aurait pas été plus opportun de simplement appliquer les dispositions existantes du code de la commande publique en instaurant, par exemple, une présomption d’urgence pour les bâtiments ayant souffert d’une dégradation importante les empêchant d’assurer leur mission de service public. Un tel dispositif aurait eu le mérite de rassurer les acheteurs, tout en assurant la sécurité des procédures et aurait véritablement permis de faire gagner du temps aux acheteurs dans la conclusion des contrats de réparation ou de reconstruction.
Ensuite, et outre la suppression des mesures de publicité, nous nous interrogeons sur le plafond prévu par l’ordonnance. En effet, quitte à prévoir des dérogations pour les marchés dont les besoins sont inférieurs aux seuils des procédures formalisées, on aurait pu s’attendre à ce que l’ordonnance aille jusqu’au bout de la démarche en se calant sur les seuils des procédures formalisées. Certains élus regrettent d’ailleurs un tel plafond qu’ils jugent trop bas à l’image par exemple de Benoit Jimenez, maire de Garges-lès-Gonnesse, qui plaidait auprès de la Première ministre pour une revalorisation de ce seuil à hauteur de 3 millions d’euros.
Dans sa tentative d’équilibriste pour chercher à concilier au mieux divers intérêts dans un contexte si particulier, l’ordonnance du 26 juillet 2023 donne l’image d’un dispositif de principe mais hésitant.
A l’inverse de ce qui précède, les exceptions apportées par les articles 2 et 3 de l’ordonnance au principe d’allotissement et facilitant le recours au marché de conception-réalisation sont on ne peut plus claires et n’appellent, de ce fait, pas de remarques particulières bien que l’on puisse craindre qu’elles ne soient pas particulièrement favorables aux PME/TPE.
-

Pour une reconstruction simplifiée des bâtiments dégradés après des violences urbaines de l’été 2023
Par Pierre-Eric SPITZ, Avocat of counsel & Giulietta RANIERI, Alternante
Le 03/10/2023
Prise en application de la loi n°2023-656 du 25 juillet 2023, l’ordonnance n°2023-870 du 13 septembre 2013 tendant à l’accélération de la délivrance et la mise en œuvre des autorisations d’urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 est venue déroger aux dispositions législatives et règlementaires du code de l’urbanisme.
Il est important de préciser que les règles posées par cette ordonnance sont temporaires car elles s’appliquent uniquement aux « demandes d’autorisations d’urbanisme déposées dans les dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur », à savoir jusqu’au 14 mars 2025.
Force est de constater que les règles posées par cette ordonnance facilitent grandement la reconstruction des bâtiments. En effet, le propriétaire d’un bien détruit lors des violences urbaines a la possibilité de le reconstruire à l’identique, sous réserve qu’il ait été régulièrement édifié, même si le plan local d’urbanisme (PLU) ou la carte communale s’y oppose.
Bien qu’il soit impossible de modifier la destination initiale du bâtiment, des adaptations et des améliorations sont envisageables dans la limite des 5% de son gabarit initial. Il peut être dérogé à ce seuil si les modifications sont justifiées par un objectif d’amélioration de la performance énergique, d’accessibilité ou de sécurité.
En somme, le propriétaire dispose d’une marge de manœuvre particulière dans la reconstruction de son bâtiment et d’une assez grande flexibilité.
En ce qui concerne les délais des procédures habituelles en matière d’autorisation d’urbanisme, cette ordonnance les raccourcit considérablement. Les opérations et les travaux de démolition, de terrassement et de fondation pourront être engagés dès le dépôt de la demande ou de la déclaration préalable c’est-à-dire sans attendre l’autorisation d’urbanisme.
C’est dans ce cadre, que le maire procède dans « les meilleurs délais » à l’affichage en mairie ou à la publication par voie électronique sur le site de la commune d’un avis de dépôt de demande de permis de construire ou de déclaration préalable, témoignant à nouveau d’une volonté de ne pas perdre de temps.
Toujours à propos des délais, ceux prévus habituellement par le code de l’urbanisme sont raccourcis :
- Le délai dont dispose l’autorité compétente pour notifier les pièces manquantes au demandeur passe de 1 mois à compter de la réception du dossier à 5 jours.
- Le délai d’instruction pour les demandes de permis de construire, d’aménager, ou de démolir limité à 3 mois ou 2 mois pour les maisons individuelles est réduit à 1 mois.
- Le délai d’instruction pour les déclarations préalables est réduit à 15 jours, se substituant alors au délai habituel d’un 1 mois.
Enfin, l’autorité compétente a 5 jours pour transmettre à l’organisme ou à l’autorité administrative le dossier nécessitant son avis, accord ou autorisation préalable. Ces autorités ont alors 15 jours pour se prononcer, leurs silences valant acceptation de la reconstruction ou avis favorable.
En cas de majoration du délai d’instruction, celle-ci ne pourra dépasser les 15 jours à compter de la réception du dossier par l’organisme ou l’autorité administrative, ce délai passant à 45 jours si la reconstruction nécessite une participation du public.
En résumé, la facilitation de la reconstruction passe donc aussi par la diminution des délais de droit commun, accélérant ainsi la délivrance et la mise en œuvre des autorisations d’urbanisme.
Pour finir, l’ordonnance autorise une dérogation à la procédure de participation du public prévue par le Code de l’environnement, en favorisant celle-ci par voie électronique en lieu et place de l’enquête publique. Par cette modification, l’ordonnance n°2023-870 octroie aux collectivités territoriales la possibilité d’accélérer et de simplifier l’application du principe de participation.
En somme, les procédures habituelles relatives à la construction et à la reconstruction sont fortement allégées par cette ordonnance du 13 septembre 2023, permettant ainsi une délivrance simplifiée des autorisations d’urbanisme dans le but de reconstruire le plus rapidement possible les bâtiments dégradés lors des violences urbaines.
-

Participations au capital de sociétés d’HLM : des confirmations rassurantes pour les collectivités
Par Sophie IMBAULT, Avocate associée
Le 18/09/2023
L’acquisition de parts sociales ou actions au capital de sociétés d’HLM par les communes ne sont pas au nombre des compétences qui, en matière de politique locale de l’habitat, ont été transférées : des confirmations rassurantes.
Aux termes d’un jugement en date du 8 juin 2023 (TA de Melun, 8 juin 2023, n° 2010226), le tribunal administratif de Melun a confirmé, s’il en était besoin, que les communes membres d’un établissement public de territoire (EPT) compétent en matière de politique locale de l’habitat, demeurent compétentes pour acquérir des parts sociales ou actions au capital de sociétés d’HLM, conformément à l’article L. 431-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH).
En effet, depuis le 1er janvier 2017, un certain nombre des anciennes compétences communales en matière, en particulier, de politique locale de l’habitat, a été transféré par les articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à la métropole du Grand Paris et aux EPT.
Pour autant, l’article L. 431-4 3° du CCH dispose toujours que les « communes » peuvent souscrire ou acquérir des actions de sociétés d’HLM, dans la limite de deux-tiers du capital social. Comme le relève le tribunal administratif de Melun, cette disposition n’a pas été modifiée par les lois successives qui ont restructuré l’environnement des organismes de logement social.
Saisi d’un moyen relatif à l’incompétence d’une commune pour acquérir deux-tiers des parts sociales d’une SCIC d’HLM, le tribunal administratif de Melun clarifie donc l’interprétation combinée des dispositions du CGCT relatives au transfert de compétences en matière de politique locale de l’habitat, et aux dispositions spécifiques du CCH permettant à une commune d’être actionnaire majoritaire d’une société d’HLM.
En dehors du territoire de la métropole du Grand Paris, une position comparable avait été retenue, peu de temps avant, par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble (TA Grenoble, 22 mai 2023, n° 2302222). Dans cette affaire il était considéré, notamment sur le fondement des dispositions spécifiques de l’article L. 431-4 du CCH, qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité des délibérations relatives à une opération permettant à une ville de demeurer titulaire d’une action à l’issue de la transformation en SA d’HLM d’une ancienne SEM agréée, nonobstant le transfert de la compétence habitat à Grenoble-Alpes Métropole.
Ces solutions sont cohérentes et peuvent être complétées à plusieurs égards.
Une société d’HLM n’est pas une société d’économie mixte (SEM). Or, l’article L. 1525-3 1° du CGCT exclut expressément, par renvoi à l’article L. 431-4 du CCH, l’applicabilité du régime des SEM aux participations des collectivités au capital des sociétés d’HLM. Ceci exclut notamment l’applicabilité des articles L. 1521-1 et L. 1522-1 3° du CGCT, propre aux SEM, aux termes desquels les collectivités ne peuvent participer au capital d’une SEM que dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi et dès lors que la réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités actionnaires.
Les sociétés d’HLM sont donc régies par des dispositions spéciales du CCH qui priment sur des dispositions générales du CGCT (specialia generalibus derogant).
Aussi, il peut être observé que dans le cadre de deux rapports de contrôle, l’agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) a eu à connaitre d’opérations ayant conduit à une prise de participation à hauteur de deux-tiers du capital d’une SCIC HLM par une commune. La régularité juridique de ces opérations, intervenues postérieurement au transfert de compétence en matière de politique locale de l’habitat, n’a aucunement été remise en cause à cette occasion (ANCOLS, rapport de contrôle n° 2018-087 relatif à la Coopérative HLM Boucle de Seine ; rapport de contrôle n° 2018-086 relatif à l’OPH de Gennevilliers).
Il résulte de tout ce qui précède qu’une commune demeure compétente pour souscrire ou acquérir jusqu’à deux-tiers des parts sociales ou action d’une société d’HLM, conformément à l’article L. 431-4 3° du CCH, nonobstant le transfert de compétence intervenu à l’issue des lois dites « NOTRe » et « MAPTAM ».
Cette confirmation rassurera certainement nombre de collectivités et organismes eu égard aux opérations récentes ou en cours dans le secteur HLM.
-

La prescription des actions en garantie du constructeur : le revirement de jurisprudence confirmé par la Cour de cassation
Par Marie BLANDIN, Avocate collaboratrice
Le 29/06/2023
Désormais, plus de doute, l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître d’ouvrage aux constructeurs ne sera plus source d’appels en garantie innombrables et précautionneux !
En effet, tandis que la Cour de cassation avait opéré un revirement de jurisprudence très attendue aux termes d’un arrêt rendu le 14 décembre 2022 (Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2022, 21-21.305, Publié au bulletin), la Haute Cour de justice confirme sa position aux termes d’un arrêt rendu le 11 mai dernier (Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2023, 21-24.967, Inédit).
En application des dispositions de l’article 2224 du Code Civil, le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, la mise en application de ces dispositions a longtemps conduit les praticiens du droit, à la lumière de la jurisprudence, à considérer que le point de départ du délai de recours d’un constructeur contre un autre constructeur, ou son sous-traitant, était la date à laquelle l’entrepreneur principal avait été assigné en référé-expertise par le maître de l’ouvrage (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié ; Civ. 3e, 1 oct. 2020, n° 19-21.502).
Dès lors, même lorsque les constructeurs avaient interrompu les délais de prescription en formant une demande d’expertise contre les autres intervenants, leur délai d’action (de cinq ans qui recommence à courir à compter du jour où la mesure d’expertise a été exécutée) pouvait avoir expiré avant le délai de dix ans courant à compter de la désignation de l’Expert, pendant lequel le maître d’ouvrage pouvait lui encore agir en réparation de ses préjudices.
En d’autres termes, alors que le maître d’ouvrage continuait de bénéficier de la garantie décennale, à compter de l’ordonnance désignant l’expert judiciaire, soit un délai de dix ans pour agir au fond, le constructeur ou le sous-traitant quant à lui se trouvait obligé d’agir en garantie dans les cinq ans de l’assignation en référé-expertise délivrée par ledit maître de l’ouvrage.
Cette superposition maladroite des délais conduisait les constructeurs, à titre conservatoire et préventif, à assigner sur le fondement présupposé d’une action indemnitaire engagée, dans une instance distincte, par le maître de l’ouvrage.
Toutes ces précautions ont causé la multiplication des recours exercés par anticipation entre constructeurs causant la perte, d’une part d’une bonne administration de la justice, et d’autre part de la sécurité juridique des constructeurs.
C’est dans ces circonstances que la 3ème chambre de la Haute Cour de justice a revu sa position historique, opérant un revirement de jurisprudence peu espéré mais très attendu par les praticiens, en décembre 2022 (Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2022, 21-21.305, Publié au bulletin).
Ce revirement de jurisprudence ne fait désormais plus de doute, cette position ayant été très récemment confirmée par la Cour de cassation, considérant que le délai d’action en garantie des constructeurs ne commence à courir qu’en cas d’une demande de reconnaissance d’un droit (Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2023, 21-24.967, Inédit).
En effet, la troisième chambre de la Cour de cassation cite expressément la position adoptée aux termes de l’arrêt rendu le 14 décembre 2022, et confirme sans équivoque qu’une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à un entrepreneur, non assortie d’une demande de reconnaissance d’un droit, fût- ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l’action en garantie de ce constructeur contre d’autres intervenants à l’acte de construire.
En d’autres termes, soyez vigilants, si l’assignation en référé-expertise comporte également une demande de provision, celle-ci fait valablement courir la prescription quinquennale !
-

Fonds de commerce exploité sur le domaine public : conséquences indemnitaires en cas de non-renouvellement et de résiliation anticipée de l’autorisation
Par Rémi JABAKHANJI, Avocat collaborateur
Le 22/06/2023
Il est fréquent que les autorisations d’occupation privatives du domaine public – qu’elles prennent la forme d’une convention d’occupation temporaire (COT) ou d’une autorisation unilatérale – autorisent l’exploitation d’une activité économique sur l’emplacement faisant l’objet de la mise à disposition.
L’article L. 2124-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (créé par la loi PINEL n°2014-626 du 18 juin 2014) a consacré la possibilité d’exploiter un fonds de commerce sur un emplacement relevant du domaine public au bénéfice des occupants^1.
Pourtant, les conséquences de la perte d’un fonds de commerce spécifiquement en matière indemnitaire n’apparaissent que depuis peu en jurisprudence. Cela s’explique par les conditions d’application dans le temps de ces dispositions : les autorisations d’occupation délivrées avant l’entrée en vigueur de la loi PINEL demeurent tenues à l’interdiction de constitution d’un fonds de commerce sur le domaine public, conformément aux règles en vigueur lors de leur délivrance^2.
La reconnaissance d’un fonds de commerce situé sur un emplacement relevant du domaine public est susceptible d’emporter des conséquences financières non négligeables, qu’il convient d’anticiper, tant du point de vue de l’occupant que de l’autorité administrative propriétaire.
(i) Compatibilité entre exploitation d’un fonds de commerce et domanialité publique
Les dispositions de l’article L.2124-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) résultent de la volonté du législateur de garantir le droit de propriété des exploitants situés sur le domaine public ainsi que d’apporter une sécurité juridique s’agissant notamment des conditions de valorisation du fonds de commerce (notamment dans le cadre de cessions).
La reconnaissance de l’existence d’un fonds de commerce entraînera diverses conséquences concrètes, telles que :
- la possibilité, pour l’occupant, de valoriser, de nantir ou de céder le fonds de commerce à des tiers (dans des conditions définies par le CG3P et sous réserve de l’autorisation de l’autorité administrative) ;
- et surtout, en ce qui nous intéresse au cas présent, la possibilité de solliciter une indemnité auprès de l’autorité administrative, en cas de perte du fonds imputable à ce dernier (cf. infra).
Il est précisé que cette possible reconnaissance du fonds de commerce ne remet nullement en cause l’incompatibilité du régime des baux commerciaux – dont l’une des principales caractéristiques droit au renouvellement du bail – avec les principes applicables aux autorisations d’occupation du domaine public, lesquels présentent un caractère précaire, révocable et temporaire^3.
(ii) Reconnaissance du fonds de commerce : la condition liée à l’existence d’une clientèle propre
La reconnaissance d’un fonds de commerce est conditionnée à l’existence d’une clientèle propre ou personnelle à l’occupant, distincte de celle attachée à la situation des lieux. De manière générale, il incombe ainsi à l’occupant de démontrer qu’il dispose d’une clientèle propre à son activité spécifique et pouvant être différenciée des usagers de la dépendance domaniale et du public de passage^4.
Ce critère implique nécessairement de procéder à une analyse casuistique visant à rechercher l’intention de la clientèle : s’agit-il d’une clientèle de passage fréquentant le lieu dominant (ex : aéroport, gare) ou s’agit-il d’une clientèle souhaitant spécifiquement bénéficier des prestations de l’exploitant situé sur l’emplacement ?
Différents facteurs sont appréciés pour déterminer l’existence d’une clientèle propre, tels que :
- l’existence d’une autonomie économique et de gestion du commerçant (ex : accès autonome à l’emplacement, horaires d’ouvertures non imposés par l’autorité administrative) ;
- la situation plus ou moins enclavée de l’emplacement ;
- la démonstration d’une fidélisation particulière de clients à l’établissement, notamment du fait de l’attractivité de l’exploitation, de sa renommée, de son savoir-faire, etc.^5
Cela étant, il n’est pas nécessaire que la part de clientèle propre du commerçant représente une part prépondérante de sa clientèle globale : il suffit que cette clientèle propre et autonome existe^6.
En application de ce faisceau d’indices, la Cour de cassation a refusé de reconnaître l’existence d’un fonds de commerce à l’exploitant des petits voiliers du jardin du Luxembourg, faute pour ce dernier d’avoir pu démontrer l’existence d’une clientèle indépendante de la fréquentation attachée au lieu^7.
À l’inverse, l’existence d’un fonds de commerce a été admise s’agissant :
- d’un restaurant-bar situé dans un aérodrome^8;
- d’un kiosque à journaux situé sur le domaine public, libre d’accès à tous, qui bénéficie en conséquence d’un emplacement privilégié et qui attire une clientèle de passage sans lien avec une quelconque activité développée par la personne gestionnaire du domaine public^9;
- d’un fonds de commerce de location de véhicules au sein d’un aéroport^10;
- d’un fonds de commerce de vente de fleurs, d’articles de presse et de restauration dans l’enceinte d’un centre hospitalier^11.
Par ailleurs, il est intéressant de relever que le tribunal administratif de Poitiers a récemment retenu qu’une association exerçant une activité à but non lucratif sur le domaine public n’est pas fondée à revendiquer l’existence d’un fonds de commerce^12.
(iii) Conséquences indemnitaires en cas de non-renouvellement de l’autorisation d’occupation
Pour rappel, et contrairement au régime des baux commerciaux (ayant pour caractéristique l’existence d’un droit au renouvellement du bail et le versement d’une indemnité d’éviction en cas de non-renouvellement^13), les titres d’occupation du domaine public présentent un caractère précaire et révocable^14révocable ayant pour incidence l’absence de droit à indemnisation en cas de non-renouvellement.
La jurisprudence considère donc par principe que le non-renouvellement de l’autorisation d’occupation ne crée aucun droit à réparation au profit de l’occupant (sauf cas particulier de non-renouvellement fautif^15). En ce sens, un jugement du Tribunal administratif de Lyon a indiqué spécifiquement que le refus de renouvellement du droit d’occupation à son terme n’ouvre pas droit à indemnisation de l’occupant, quand bien même l’existence d’un fonds de commerce serait admise^16.
Ainsi, à l’échéance normale d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public et en l’absence de reconduction, l’éventuelle perte d’éléments constitutifs d’un fonds de commerce n’ouvre droit à aucune indemnisation.
(iv) Conséquences indemnitaires en cas de résiliation anticipée de l’autorisation d’occupation
Plus épineuse est la question de l’indemnisation du fonds de commerce en cas de résiliation anticipée.
L’article L. 2122-9 du CG3P prévoit que l’occupant a droit à l’indemnisation des préjudices présentant un caractère direct, matériel et certain né d’un retrait anticipé de l’autorisation ne résultant pas d’une faute de l’occupant.
Ainsi, dans le silence du titre d’occupation et en l’absence d’aménagement conventionnel des conditions d’indemnisation, l’exploitant pourra être indemnisé de la perte d’éléments constitutifs du fonds de commerce résultant de la résiliation anticipée prononcée par l’autorité administrative^17.
Cette indemnisation pourra s’avérer particulièrement lourde, dès lors que « le fonds de commerce est composé d’un ensemble de biens meubles corporels et incorporels affectés à l’exploitation de l’activité commerciale, comprenant notamment l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel, l’outillage, les autorisations d’exploitation et les droits de propriété intellectuelle” »” ^18,
De plus, le chiffrage de certains éléments constitutifs du fonds, tel que les autorisations d’exploitation en possession de l’occupant pour l’exercice de son activité (ex : licences de débits de boissons, autorisation d’exploitation d’une officine de pharmacie^19, etc.), pourra s’avérer particulièrement conflictuel et se prêter à la mise en œuvre d’une expertise.
À ces difficultés, s’ajoutent la prise en compte du caractère temporaire de l’autorisation (absence de droit au bail) et le caractère évolutif de la valeur du fonds, laquelle diminue à mesure que l’échéance normale de l’autorisation se rapproche^20.
(v) Éventualité d’un aménagement contractuel de l’indemnisation liée à la perte du fonds
Se pose enfin la question de la possibilité d’aménager contractuellement le montant de l’indemnité liée à la perte d’un fonds de commerce consécutif à une décision de résiliation anticipée de l’autorisation.
Une actualité doit être relevée à ce sujet : le Conseil d’État a considéré qu’une clause insérée dans une COT ayant pour effet d’exclure la constitution d’un fonds de commerce sur le domaine public ne constituait pas un vice d’une gravité telle qu’elle entraînait l’annulation du titre d′ occupation^21. Il a pu être déduit de cette décision qu’une telle clause interdisant la création d’un fonds de commerce n’était pas illégale, faute d’annulation de la convention litigieuse.
La Haute juridiction se veut plus nuancée : l’absence d’annulation du contrat s’inscrit dans le cadre particulier de cette affaire, s’agissant d’un recours ayant pour objet la contestation de la validité du contrat par les parties^22, dans le cadre duquel le juge ne prononce l’annulation du contrat qu’en présence de vices d’une particulière gravité.
Pour autant, il résulte des conclusions du rapporteur public qu’une clause prohibant la reconnaissance d’un fonds de commerce est illégale^23 et pourrait donc être contestée, par exemple dans le cadre d’un litige en responsabilité ou à l’occasion d’un recours en contestation d’une mesure de résiliation^24 afin de rechercher une augmentation de l’indemnité consécutive à la résiliation due à l’occupant.
Ainsi, l’insertion d’une clause excluant toute possibilité de constituer un fonds de commerce ne traite pas efficacement l’éventualité d’une perte du fonds : d’une part, elle contrarie indûment la possibilité reconnue à l’occupant de constituer un fonds, et donc notamment de le céder ou le nantir conformément aux dispositions CG3P et, d’autre part, elle ne sécurise financièrement pas l’autorité administrative en cas de résiliation anticipée de l’autorisation.
Une alternative viable réside plus vraisemblablement dans l’insertion d’une clause ayant strictement pour objet un aménagement contractuel des conséquences indemnitaires en cas de résiliation.
En effet, sous réserve de confirmation par la jurisprudence, aucun principe ne paraît faire obstacle à un traitement contractuel particulier de l’indemnisation liée à la perte du fonds, dans la continuité d’une jurisprudence classique selon laquelle l’indemnité en cas de résiliation anticipée peut être modulée, voire complètement supprimée, en application des stipulations d’une COT^25.
En pratique, une démarche de sécurisation financière consisterait à définir contractuellement la méthodologie de calcul de l’indemnité liée à la perte du fonds, voire de fixer un plafonnement d’indemnisation, afin de rendre le plus prévisible le montant d’une indemnité éventuelle.
^1 Art. L. 2124-32-1 du CG3P : « Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre ».
^2 CE, 24 novembre 2014, Société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais, n° 352402 ; V. également CAA Marseille, 9 avril 2021, n° 18MA03151.
^3 CE, 24 novembre 2014, n° 352402 préc. ; CAA Paris, 20 mai 2020, n°19PA02821.
^4.Cass. com., 28 mai 2013, n° 12-14.049.
^5 Cass. 3e civ, 5 avril 2018, n°17-10.466.
^6 Cass. 3e civ., 19 mars 2003, Cne Orcières : JCP E n° 30, 24 juillet 2003, p.1245.
^7 Cass. 3e civ, 5 avril 2018, n°17-10.466 préc.
^8Cass. Com. 10 janvier 2006, n° 03-20733.
^9 CA Lyon, 26 octobre 2017, n° 15/05737.
^10 Cass. Com. 17 mars 2009, n° 07-19780.
^11 Cass. Civ. 1re, 4 novembre 2010, n° 09-70284.
^12 TA Poitiers, 11 avril 2023, n°2100805.
^13 Art. L. 145-14 du Code de commerce.
^14 Art. L. 2122-3 du CG3P.
^15 CE, 1er avril 1992, Mme X., n° 80105 ; CE, 20 mars 1996, M. Y., n°121601 ; CAA Paris, 31 mars 2011, M. A., n° 09PA06560.
^16 TA Lyon, 8 juin 2020, SAS Pharese, n° 1809013, C+.
^17 Voir exemple Caen, 24 octobre 2019, n° 18/00623.
^18 CA Lyon, 26 octobre 2017, n° 15/05737.
^19 Article L. 5125-21 du Code de la santé publique : une telle autorisation est attachée au fonds de commerce.
^20 TA Lyon, 8 juin 2020, SAS Pharese, n° 1809013, C+ : « si l’existence d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public permettant d’exploiter une terrasse augmente la valeur du fonds de commerce auquel est attachée la clientèle utilisant cette terrasse, cette valorisation du fonds de commerce est nécessairement limitée à la valeur de l’avantage commercial offert par la disposition de cette autorisation pour la seule durée de celle-ci »
^21 CE, 11 mars 2022, M. G. et M. H., n°453440.
^21 CE, 11 mars 2022, M. G. et M. H., n°453440.
^22 CE Ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, publiée au Recueil.
^23 Concl. R. Victor sous CE, 11 mars 2022, M. G. et M. H., n°453440.
^24 CE, 3 mars 2017, Société Leasecom, n° 392446 ; V. également Rép. Min. QE n° 22466 JO Sénat du 22/04/2021 – p. 2603.
^25 CE, 31 juillet 2009, Société Jonathan Loisirs, n° 316534 ; V. également par exemple CA Lyon, 26 octobre 2017, n° 15/05737.
-

Climat et Environnement, pierre d’achoppement entre l’Exécutif et le judiciaire
Par Pierre-Eric SPITZ, Avocat of counsel
Le 06/06/2023
En 2011, le Président Sarkozy déclarait : ‘‘L’environnement, ça commence à bien faire.’’ En 2023, le Président Macron déclarait lors de son discours sur la réindustrialisation qu’il « faut faire une pause sur les réglementations environnementales’’ ». Certes, les propos du Président Macron avaient peut-être été mal interprétés puisque l’Elysée précisait qu’Emmanuel Macron ne parlait pas de suspension mais « d’exécuter les décisions déjà prises avant de faire de nouveaux changements ».
Deux décisions très récentes du Conseil d’Etat viennent montrer à l’Exécutif que la justice s’opposerait à toute méconnaissance des décisions déjà prises au niveau européen relatives au Climat et à l’environnement.
Par une décision du 3 mai 2023 (n°450155), le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté des ministres de l’agriculture et de la transition écologique autorisant provisoirement l’emploi de produits phytopharmaceutiques contenant des substances des néo-nicotinoïdes. Les ministres avaient cru pouvoir se fonder sur l’article 53 du règlement CE n°110/2009 du Parlement Européen et du Conseil permettant de déroger à l’interdiction de ces produits « en raison d’un danger qui ne peut être maitrisé par d’autres moyens raisonnables ». Mais la Cour de justice de l’Union avait interprété cette disposition dérogatoire en un sens restrictif estimant que dès lors que des règlements d’exécution avaient été pris par la Commission européenne pour interdire expressément ces substances, il ne pouvait y être dérogé. Or tel avait été le cas en 2018. Par conséquent, le Gouvernement français ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 53 précité pour autoriser temporairement ces produits (Gaucho et Cruiser) commercialisés par les sociétés Bayer et Syngenta.
Et par une décision du 10 mai 2023 (n°467982), le même Conseil d’Etat a poursuivi la saga ouverte par sa décision du 1er juillet 2021 annulant à la demande de la Commune de Grande Synthe le refus du Président de la République et du Premier ministre de prendre toutes mesures permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Il avait jugé qu’un tel refus était contraire aux objectifs de réduction fixés par le code de l’Energie et le Règlement UE 2018/842 contraignants pour les Etats membres signataires de l’accord de Paris. Il avait dès lors enjoint au Premier ministre de prendre les mesures respectant leurs engagements d’ici au 31 mars 2022. En effet, le règlement européen obligeait la France à réduire de 37% les GES à horizon 2030 par rapport à 2005, objectif renforcé à 40% par le code de l’énergie pour atteindre la neutralité carbone en 2050.
Le 10 mai 2023, le Conseil d’Etat statuant en tant que juge de l’exécution de ses décisions devait déterminer si les mesures prises depuis son arrêt de 2021 permettaient d’atteindre les objectifs fixés. Ce qui est particulièrement intéressant dans cet arrêt du 10 mai est la méthode mise en œuvre par le Conseil pour juger de l’atteinte des objectifs lorsqu’il se demande 1/ si les objectifs intermédiaires ont été atteints lorsque le juge statue 2/ si les mesures adoptées et annoncées par le Gouvernement vont dans le sens de la réduction ou de l’augmentation des GES 3/ si les mesures prises ou à prendre sont efficaces et plus généralement si les politiques publiques expertisées notamment par le Haut conseil pour le climat (HCC) vont dans le sens de la réalisation des objectifs fixés 4/ enfin si l’ensemble des mesures prises ou à prendre rendent crédibles la réalisation des objectifs ? Le Conseil d’Etat juge que si tel est le cas, il pourrait clore le contentieux de l’exécution de sa décision de 2021.
En l’espèce, aux termes d’une analyse très technique qui passe en revue les mesures prises dans le secteur des transports, du bâtiment, du secteur agricole, de l’Energie, des déchets, et l’analyse des avis des experts comme le Haut conseil pour le Climat, la Haute juridiction enjoint à la Première Ministre de prendre des mesures supplémentaires d’ici à décembre 2023 et au plus tard au 30 juin 2024 pour assurer la cohérence du rythme de la diminution des GES avec les objectifs de la stratégie bas carbone.
C’est dans le secteur du développement trop lent de la voiture électrique ou hybride, dans le secteur du bâtiment et de la mise en œuvre trop lente de l’éradication des passoires énergétiques, du secteur de l’énergie et des mesures insuffisantes de sobriété et de trop faible déploiement des investissements pour les énergies renouvelables que le Conseil d’Etat souligne l’inadéquation des mesures prises avec les objectifs fixés.
Le Conseil d’Etat ne prononce pas encore d’astreinte à l’encontre de l’Etat mais on peut supposer que tel sera le cas, la prochaine fois qu’il aura à se prononcer sur les mesures supplémentaires mises en œuvre d’ici 2024 si elles sont encore insuffisantes.
Ces deux décisions du 3 et du 10 mai montrent clairement que l’Exécutif est sous la pression des associations, des organisations non gouvernementales et des collectivités locales pour mettre en œuvre effectivement les engagements qu’il a pris comme membre de la Convention Climat et de l’Union européenne. Elles révèlent comme jamais peut être que l’Exécutif doit compter avec les juridictions nationales et européennes pour faire de l’enjeu climat une politique publique effective.
Enfin, on constate que depuis le temps où on apprenait que le juge administratif ne pouvait se transformer en administrateur, les choses ont bien changé. Il indique aujourd’hui quelle politique publique doit être renforcée en matière de transports ! Quels et combien d’investissements doivent être réalisés dans l’énergie ! Quelle politique publique doit être suivie dans le secteur de la rénovation des bâtiments. Il ne se contente plus de sanctionner en aval les décisions prises ou non, il contrôle en amont les décisions qui doivent être prises pour respecter une trajectoire !
Il n’est pas sûr que le temps de la pause en matière environnementale soit venue ! Les juges ne prennent pas de repos !
-

« La TVA, un impôt à recentrer sur son objectif de rendement pour les finances publiques »
Par Margaux TRIPIER, Avocate collaboratrice & Valentine VERSPIEREN, Stagiaire
Le 01/06/2023
Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), organisme consultatif rattaché à la Cour des Comptes, a mené une étude sur la TVA en France face aux modifications de son cadre budgétaire et juridique, ainsi qu’aux préoccupations croissantes du changement climatique.
Le Conseil estime qu’il est impératif de préserver le rendement de cette taxe, qui doit servir en priorité à financer les services publics.
Le Conseil s’inquiète de la diminution progressive de la part des recettes de TVA destinée à l’État. Cette baisse est principalement due à des affectations de recettes au profit d’autres organismes publics tels que les organismes de protection sociale et les collectivités territoriales.
Le Conseil s’interroge sur la soutenabilité des finances publiques face à cette tendance de transfert de recettes visant notamment à compenser la suppression d’autres recettes fiscales (taxe d’habitation et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises).
Le Conseil souligne la tendance généralisée dans les dernières réformes fiscales à puiser dans les recettes de TVA de l’État en compensation, et recommande ainsi d’éviter, à l’avenir, les affectations de TVA en dehors du champ des organismes de protection sociale et des collectivités territoriales.
Le rendement de la TVA est par ailleurs menacé par la fraude mais aussi par la multiplication des taux réduits de TVA, qui sont souvent difficiles à remettre en question malgré leur efficacité limitée.
On estime que la fraude à la TVA pourrait atteindre les 26 milliards d’euros.
Afin de lutter contre ce phénomène, le Conseil propose d’approfondir des dispositifs mis récemment en place, tels que le paquet TVA “e-commerce” et la facturation électronique obligatoire. Une réorganisation des services d’enquête fiscale, l’adoption de nouveaux instruments juridiques devraient également favoriser une baisse des droits de TVA rappelés.
Le Conseil rappelle également que l’efficacité limitée des taux réduits de TVA qui représentent pourtant un manque à gagner important de recettes publiques. Le Conseil recommande ainsi d’éviter l’adoption de nouveaux taux réduits de TVA et de privilégier d’autres outils plus ciblés afin de concilier les objectifs économiques et de politique publique.
Le Conseil souligne également l’efficacité limitée de la TVA comme réponse aux crises actuelles économiques et géopolitiques actuelles, même si certains États membres ont pris le parti de baisser la TVA sur certains produits afin de tenter de stimuler leur économie.
Pour répondre à l’augmentation des prix de l’énergie, la France a préféré recourir à d’autres instruments tels que le “bouclier tarifaire” et le chèque énergie, qui se sont avérés plus efficaces pour protéger les ménages vulnérables tout en étant moins coûteux pour les finances publiques.
Le Conseil suggère également de privilégier d’autres instruments pour relever les défis environnementaux et de santé publique, tels que les transferts ciblés, les accises, le système européen d’échange de quotas d’émissions, les investissements ou encore la réglementation ; ces mesures étant notamment plus efficaces pour soutenir des secteurs économiques dits « sobres » tels que le transport ferroviaire et l’économie circulaire.
-

Dans le cadre d’un marché à forfait, la notification du décompte définitif à l’entreprise vaut acceptation tacite des travaux supplémentaires qui y sont mentionnés
Aux termes d’un arrêt en date du 11 mai 2023, publié au bulletin, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, abstraction faite d’une référence inopérante mais surabondante au silence gardé par le maître de l’ouvrage durant le délai lui étant imparti, à compter de la réception du mémoire de l’entreprise, pour notifier à celle-ci, après vérification, le décompte définitif, en application de la norme NF P 03.001, retient que la notification par le maître de l’ouvrage des décomptes définitifs à l’entreprise, incluant le coût de certains travaux supplémentaires est sans équivoque, faisant ainsi ressortir que celle-ci valait acceptation expresse et non équivoque desdits travaux, réalisés hors forfait (Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2023, 21-24.884 21-25.619).
En l’espèce, dans le cadre de la réalisation de la construction d’un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes, le Maître d’ouvrage a confié à la société A***, selon deux marchés à forfait, les lots revêtements souples et peinture.
Le délai d’exécution des marchés était prévu, selon le calendrier d’exécution notifié à l’entreprise, du 23 décembre 2013 au 6 juin 2014. La réception a eu lieu le 8 septembre 2015. La société A*** a notifié au Maître d’ouvrage ses mémoires définitifs pour les deux lots, incluant le coût de certains travaux supplémentaires et des dépenses résultant du prolongement du délai d’exécution.
Après rectification des mémoires par le maître d’œuvre, le Maître d’ouvrage a notifié les décomptes définitifs à l’entreprise.
Contestant ces derniers, la société A*** a assigné le Maître d’ouvrage en paiement de diverses sommes. Ce dernier a sollicité reconventionnellement le paiement d’une somme au titre des pénalités de retard.
Statuant sur l’appel interjeté par le Maître d’ouvrage du jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS en date du 3 novembre 2017 (n°2017032588), la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 4 – chambre 5, 1er septembre 2021, n° 18/02067) a jugé que :
« (…) la société A*** ne conteste pas que les devis de travaux supplémentaires dont elle se prévaut n’ont pas été signés par le maître d’ouvrage, ni qu’ils n’ont pas donné lieu à des ordres de service.
Il résulte néanmoins de la jurisprudence prise pour l’application des dispositions de l’article 1793 du code civil que, en cas de travaux supplémentaires exécutés sans son accord préalable écrit, le maître d’ouvrage est tenu d’en payer le prix dès lors qu’il les a ratifiés, postérieurement à leur exécution, par une acceptation non équivoque. Le fait de ne pas contester la réalisation des travaux supplémentaires et de ne pas les refuser ne suffit pas, contrairement à ce que soutient la société A***, à établir que le maître de l’ouvrage les a acceptés sans équivoque après leur réalisation.
En revanche en l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré comme ayant été acceptés sans équivoque par le maître d’ouvrage les seuls travaux supplémentaires retenus par le maître d’œuvre dans le cadre de la vérification des mémoires définitifs opérée par ses soins et non contestés par le maître d’ouvrage lors de sa transmission des décomptes définitifs ou réputés acceptés par suite de son silence en application de l’article 19.6.2 de la norme NF P 03.001 à laquelle se réfèrent expressément les ordre de service du 19 décembre 2012. »
Dans le cadre de son pourvoi en cassation, le Maître d’ouvrage a fait valoir notamment, d’une part, que le maître d’œuvre n’avait pas mandat de représenter le maître d’ouvrage auprès des constructeurs aux fins d’approuver des travaux supplémentaires et, d’autre part, que les règles établies par la norme Afnor ne pouvaient prévaloir sur les dispositions légales et qu’il contestait avoir commandé des travaux supplémentaires.
Or, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel admettant ainsi la ratification tacite par le Maitre d’ouvrage, a posteriori, des travaux supplémentaires réalisés par l’entreprise.
En principe, la Cour de cassation a une approche restrictive de la ratification tacite des travaux supplémentaires réalisés par l’entreprise dans le cadre d’un marché à forfait, sans commande préalable et écrite.
En effet, les dispositions de l’article 1793 du Code civil encadrent de manière précise la commande de travaux supplémentaires dans le cadre d’un marché à forfait :
« Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
Dès lors, le paiement des travaux supplémentaires nécessite que ces derniers soient effectivement commandés par le Maître d’ouvrage et que celui-ci ait émis un ordre de service préalable et écrit portant tant sur le principe de réalisation desdits travaux que sur le prix.
Cette autorisation du maître d’ouvrage doit être donnée par lui-même ou son représentant dûment mandaté par écrit (Cass. 3e civ., 24 mai 2006, n° 02-10.840).
En application de ce principe, toute commande de travaux supplémentaires passée par l’architecte n’engage pas le maître d’ouvrage, sauf justification d’un mandat exprès qui aurait été confié à l’architecte pour commander de tels travaux (Cass. 3e civ., 17 févr. 1999, n° 95-21.412 ; Cass. 3e civ., 22 oct. 2002, n° 00-13.862 ; Cass. 3e civ., 2 juin 2016, n° 15-16.673).
Cela étant, la jurisprudence a apporté un tempérament à ce principe considérant que la ratification expresse par le Maître d’ouvrage des travaux supplémentaires peut intervenir par écrit, postérieurement à leur réalisation (Cass. 3e civ., 25 octobre 2005, n°04-14995).
Concernant la ratification tacite, la jurisprudence est plus restrictive dans la mesure où, à titre d’exemple, il a été jugé que la seule connaissance par le maître d’ouvrage des travaux supplémentaires et son absence de réaction à réception des factures de l’entrepreneur ne permettait pas de caractériser un accord exprès et non équivoque du maître d’ouvrage sur la ratification desdits travaux (Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 16-25.262). De même, aux termes d’un arrêt en date du 18 mars 2021 (Cass. 3e civ., 18 mars 2021, n°20-12596), la Cour de cassation avait jugé que « les réclamations, autres que celles portant sur des travaux supplémentaires non autorisés ni régularisés par le maître de l’ouvrage, lorsqu’elles sont mentionnées dans le mémoire définitif et n’ont pas été contestées conformément à la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties, sont, en l’absence de contestation du mémoire définitif, réputées acceptées tacitement par le maître de l’ouvrage ».
Cela étant, par cet arrêt du 11 mai 2023, la Troisième chambre civile semble assouplir sa position, considérant qu’il y a ratification tacite des travaux supplémentaires, non autorisés ni régularisés par écrit par le Maître d’ouvrage, dès lors que ce dernier a validé et notifié les décomptes définitifs en y faisant apparaitre des travaux supplémentaires qu’il n’a pas notifiés !
Aussi, il appartient plus que jamais aux Maîtres d’ouvrage de vérifier les amendements et ratifications faits par la maîtrise d’œuvre sur les projets de décomptes définitifs avant toute notification aux entreprises, dans la mesure où ils resteront seuls débiteurs des sommes validées, sauf à se retourner ultérieurement en garantie contre le maître d’œuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute.
-

La loi EnR facilite l’implantation des projets photovoltaïques dans les zones des PPRI exposées aux risques
Par Emmeline BOITEL, Avocate collaboratrice
Le 02/05/2023
La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite ENR) prévoit des mesures qui vont permettre aux porteurs de projets photovoltaïques de mobiliser de nouveaux fonciers jusqu’alors inconstructibles, parmi lesquels on retrouve les terrains situés en zone à risques des plans de prévention des risques inondation (PPRI).
Face au défi de l’accélération des énergies renouvelables et à l’émergence de nombreuses demandes de projets photovoltaïques situés en zone inondable, il est apparu indispensable au législateur de prévoir des mesures destinées à permettre l’implantation de ces projets, sous réserve du respect de certaines conditions.
C’est en ce sens que l’article 47 de la loi prévoit des dispositions favorables au développements des projets ENR dans les zones à risques des plans de prévention des risques.
Désormais, les plans de prévention des risques pour ont pour objet de définir dans les zones exposées aux risques, des exceptions aux interdictions ou prescriptions afin de ne pas s’opposer à l’implantation d’installations de production d’énergie solaire dès lors qu’il n’en résulte pas une aggravation des risques.
Lorsque le plan de prévention des risques ne définit pas de telles exceptions, le préfet, après avis de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, peut accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées dans les PPRI afin d’autoriser les infrastructures de production d’énergie solaire.
On précisera que les PPRI en cours d’élaboration ou de révision pourront intégrer ces mesures, dès lors que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté à la date de promulgation du texte.
D’un point de vue opérationnel, ces nouvelles dispositions impliquent aux porteurs de projets d’être attentifs aux évolutions des PPRI, et le cas échéant, de formuler toute observation (notamment dans le cadre de l’enquête publique), afin que les plans prévoient de telles exceptions.
-

Les darkstores prenant place au rez-de-chaussée donnant sur rue d’anciens locaux commerciaux interdits à Paris
Par Damia KACETE, Avocate collaboratrice
Le 05/04/2023
Dans cette affaire, la ville de Paris avait mis en demeure la société Frichti et la société Gorillas Technologies France de restituer dans leur état d’origine les locaux, initialement commerciaux, qu’ils occupaient pour la réception et le stockage ponctuel de marchandises, au motif, d’une part, qu’elles avaient opéré un changement de destination non déclaré et, d’autre part, que ce changement de destination n’était pas autorisé à Paris, le règlement du PLU interdisant la transformation en entrepôt de locaux existants en rez-de-chaussée sur rue.
Par une ordonnance n°2219412/4 du 5 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, saisi d’un référé-suspension par les deux sociétés, avait suspendu les décisions de la ville de Paris au motif notamment que les locaux concernés constituaient des espaces « de logistique urbaine » ce qui leur conférait la qualité de « CINASPIC » autorisée par le règlement du PLU.
Par cette décision n°468360 du 23 mars 2023, publié au Recueil, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance précitée et rejette les demandes de suspensions présentées par les sociétés requérantes pour absence de doutes sérieux quant à la légalité des actes.
Le Conseil d’Etat rappelle d’abord que le maire peut parfaitement adresser une mise en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de remettre en état un bien ayant fait l’objet d’un changement de destination non déclaré, nonobstant l’absence de travaux.
Il rappelle ensuite que l’existence ou non d’un changement de destination s’apprécie au regard des dispositions du code de l’urbanisme, en l’occurrence au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code tels que précisés par un arrêté du 10 novembre 2016, énumérant les différentes destinations et sous-destinations des constructions.
Enfin, le Conseil d’Etat juge qu’en l’espèce l’occupation des locaux par les sociétés Frichti et Gorillas :
- constituait un changement de destination nécessitant une déclaration préalable dès lors que les locaux ne correspondaient plus à la sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvrant les activités « destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle » au sens des articles précités du code de l’urbanisme mais correspondaient à la sous-destination « entrepôt » recouvrant les activités « destinées au stockage des biens ou à la logistique » ;
- était contraire à la règlementation du PLU de Paris dans la mesure où, contrairement à ce qu’avait jugé le TA de Paris, elle ne correspondait pas à une logique de logistique urbaine qui, en application des dispositions du PLU aurait pu la faire entrer dans la catégorie autorisée des « CINASPIC » ; il considère en effet que l’activité en cause avait pour objet de permettre « l’entreposage et le reconditionnement de produits non destinés à la vente aux particuliers dans ces locaux », qu’elle relevait donc de la destination « Entrepôt » au sens du PLU et qu’elle ne pouvait prendre place par transformation de locaux existants en rez-de-chaussée sur rue.
A noter la parution d’un décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 « portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu » créant dans la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire » une nouvelle sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » distincte de la sous-destination « entrepôt ».
-

Un usufruitier peut-il agir sur le fondement de la garantie décennale ?
Par Célia Tessier, Avocate collaboratrice
Le 29/03/2023
« L’usufruitier, quoique titulaire du droit de jouir de la chose comme le propriétaire, n’en est pas le propriétaire et ne peut donc exercer, en sa seule qualité d’usufruitier, l’action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance.
Il en résulte que l’usufruitier qui n’a pas qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale, peut néanmoins agir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en réparation des dommages qui lui cause la mauvaise exécution des contrats qu’il a conclus pour la construction de l’ouvrage, y compris les dommages affectant l’ouvrage. » ^1
Tels sont les termes de la décision rendue le 16 novembre 2022 par les juges de la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
En l’espèce, une société usufruitière avait confié à un entrepreneur la réalisation de travaux de réalisation d’une charpente et de revêtement d’un bâtiment à usage commercial. Des désordres ont été constatés par l’usufruitière qui a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer le solde du prix du marché et formé des demandes reconventionnelles aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Les juges du fond ont rejeté l’ensemble des demandes de l’usufruitière fondées aussi bien sur la responsabilité décennale que sur la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur. L’usufruitière a alors formé un pourvoi en cassation, se prévalant de son statut d’usufruitier, de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Concernant la garantie décennale, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme le raisonnement de la Cour d’appel qui « après avoir relevé que la société reconnaissait être usufruitière de l’ouvrage et ne pas avoir été mandaté par le nu-propriétaire, a retenu que cette société ne pouvait agir contre le constructeur et l’assureur sur le fondement de la garantie décennale. »
La Cour de cassation rappelle la lettre de l’article 578 du Code civil, qui pour mémoire dispose que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété et ce, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. ».
Il convient également de rappeler les termes de l’article 597 du Code civil en vertu duquel l’usufruitier « jouit de servitudes, de passage, et généralement de tous les droits dont un propriétaire peut jouir » et qui rappelle de nouveau que l’usufruitier « en jouit comme le propriétaire lui-même ».
De fait, la Cour de cassation, si elle rappelle les prérogatives conférées à l’usufruitier qui doit pouvoir jouir des choses comme le propriétaire lui-même, prive ce dernier de l’action en garantie décennale au motif qu’il n’est pas propriétaire de l’ouvrage.
Cette décision est difficilement compréhensible, d’une part car l’usufruitier doit pouvoir exercer ses droits tel un propriétaire, et d’autre part car les seules limites dans l’exercice de ses droits résident dans la conservation de la chose.
Or, si la conservation de la chose s’analyse comme une restriction aux droits de l’usufruitier qui, à titre d’exemple, doit s’abstenir d’en disposer sous peine de nullité relative ^2, cette obligation de conservation doit aussi s’analyser comme imposant à l’usufruitier d’adopter une attitude active tendant à la conservation de la chose.
En tout état de cause, conférer le droit d’action en garantie décennale à l’usufruitier lui aurait légitimement permis de remplir ses obligations de conservation puisque par essence, cette action vise à obtenir la réparation des dommages survenus sur l’ouvrage.
Si cette solution ne semble pas opportune au regard des droits et obligations de l’usufruitier, elle assimile en outre l’usufruitier au preneur à bail alors même que leur statut et prérogatives respectives ne sont pas semblables.
De fait, les termes de l’espèce sont manifestement similaires à ceux utilisés par la troisième chambre civile qui avait refusé d’attribuer l’action en garantie décennale au preneur.
Pour mémoire, la Cour de cassation avait affirmé « En sa qualité de locataire, la société n’était titulaire que d’un simple droit de jouissance sur l’ouvrage dont elle n’avait pas la propriété, ce qui ne lui permettait pas de se prévaloir de la qualité du maitre de l’ouvrage et qu’elle ne disposait donc pas de l’action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage, et non à sa jouissance » ^3.
La décision de l’espèce rappelle d’ailleurs en tout point la jurisprudence applicable au preneur, notamment en ce qu’elle justifie l’absence de qualité à agir de l’usufruitier par l’absence de mandat conféré par le nu-propriétaire ^4.
Cette transposition est néanmoins discutable. : si le bail et l’usufruit portent sur la jouissance de la chose, la loi attribue de plus amples prérogatives à l’usufruitier, la durée de la convention en étant d’ailleurs un premier indice. Tandis que l’usufruit est généralement viager, le bail est le plus souvent, à temps.
L’atteinte aux droits du propriétaire constitue un second indice de la distinction qui aurait pu être opérée par la Cour de cassation. Alors qu’aux termes d’une convention de bail, le propriétaire s’oblige personnellement à procurer la jouissance de son bien au locataire, l’attribution de l’usufruit démembre la propriété et porte réellement atteinte au droit du propriétaire qui perd l’usage et la jouissance de son bien.
La Cour de cassation laisse néanmoins à l’usufruitier la possibilité d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard de l’entrepreneur et censure le raisonnement des juges du fonds qui avaient retenu que « les demandes reconventionnelles présentées par cette société, sous couvert d’être fondée sur la responsabilité contractuelle de la société de travaux, s’avèrent être la conséquence des désordres allégués pour lesquels, sur le fondement de l’article 1792, est recherchée la garantie décennale du constructeur ».
La Cour de cassation considère que la Cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.
1 Cass, 3ème civ, 16 novembre 2022, n°21-23.505
2 Civ. 3e, 23 mai 2002, no 00-17.604 P: D. 2003. Somm. 2050, obs. Mallet-Bricout; Defrénois 2002. 1311, obs. Atias; CCC 2002, no 136, note Leveneur
3 Cass, 3ème civ, 1er juillet 2009, n°08-14.714, Cass, 3ème civ, 2 février 2005, n°03-18.251, Cass 3ème civ, 23 octobre 2012, n°11-18.850).
4 Cass. 3e civ., 16 mai 2001, n° 99-19.085 : JurisData n° 2001-009652 ; RD imm.2001, p. 390, note Ph. Malinvaud. – Cass.3e civ., 26 mars 2003, n° 01-15.321 : JurisData n° 2003-018559 ; RD imm.2003, p. 356, note Ph. Malinvaud. – Cass.3e civ., 5 déc. 2007, n° 07-10.806 : JurisData n° 2007-041810 ; RD imm. 2008, p. 49, note Ph. Malinvaud. – Cass.3e civ., 16 mars 2011, n° 10-30.189 : JurisData n° 2011-003912. – Cass.3e civ., 19 déc. 2012, n° 11-27.593 : JurisData n° 2012-030314
-

Les modalités de dérogation aux règles de hauteur définies dans le PLU
Par Cléophée de MALATINSKZY, Avocate collaboratrice
Le 22/03/2023
Le décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 et l’arrêté pris le même jour précisent le nouveau cadre juridique permettant aux constructions faisant preuve d’une exemplarité environnementale de déroger aux règles de hauteur définies dans le Plan Local d’Urbanisme (ci-après le « PLU »).
Pour rappel, l’article L. 152-5-2 du code de l’urbanisme, créé par la loi Climat et Résilience, dispose que :
« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction ».
Les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction devaient être précisées par décret en Conseil d’Etat. C’est désormais chose faite.
L’article 1 du nouveau décret, créant l’article R. 152-5-2 du code de l’urbanisme, permet aux opérateurs immobiliers ayant un projet faisant preuve d’exemplarité environnementale de déroger aux règles du PLU en termes de hauteur selon les modalités suivantes :
- dans la limite d’un dépassement de 25 centimètres par niveau ;
- et d’un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme ;
- sans permettre l’ajout d’un étage par rapport à un autre mode de construction.
Concrètement, dans le cadre d’un PLU limitant la hauteur des bâtiments à 15 mètres, l’opérateur qui démontre que l’exemplarité environnementale de sa construction entraîne des contraintes d’ordre technique qui nécessitent une dérogation aux règles de hauteur du PLU pourra construire jusqu’à 17,5 mètres de haut.
Cette dérogation amène à se demander ce qu’il faut entendre par construction faisant preuve d’exemplarité environnementale.
Le décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 définit cette notion, en modifiant l’article R.171-3 du code de la construction : il énonce que fait preuve d’exemplarité environnementale une construction qui « atteint des résultats minimaux en termes d’impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment » ^1, ces seuils étant définis par arrêté ministériel.
Par ailleurs, pour bénéficier de la dérogation aux règles, le pétitionnaire devra joindre à la demande de permis de construire un « document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les critères de performance environnementale requis » ^2.
La possibilité de déroger aux règles de hauteur afin que la construction soit exemplaire d’un point de vue environnemental est donc strictement encadrée, et devra dûment être justifiée dans le dossier de demande de permis de construire.
-

Energie : Le PPA (Power Purchase Agreement) débarque en France
Par Benjamin ROOR, Avocat collaborateur
Le 16/03/2023
Les PPA sont des contrats, généralement de long terme^2, par lesquels le producteur s’engage à vendre tout ou partie de la production d’énergie de son installation à un consommateur qui s’engage à l’acquérir, sur toute la durée du contrat. Ce faisant, le producteur bénéficie d’une visibilité sur le prix de vente et d’une diminution du coût du capital liée au volume garanti de vente. Le consommateur se prémunit quant à lui du risque de fluctuation des prix sur les marchés de l’énergie.
Les PPA constituent ainsi un nouvel outil en faveur du développement des énergies renouvelables sans exposition supplémentaire du budget de l’Etat. Ils coexisteront ainsi en parallèle des mécanismes de soutien public déjà en place. Aussi, le législateur a prévu que pour une même installation, un producteur puisse vendre une partie de sa production dans le cadre d’un PPA et bénéficier des mécanismes de soutien public pour le reste de sa production^3.
Le producteur d’une installation de production d’électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone souhaitant vendre sa production directement à un consommateur final dans le cadre d’un PPA devra personnellement détenir l’autorisation administrative nécessaire à l’exercice de l’activité d’achat pour revente visée aux articles L. 333-1 et L. 446-1 du code de l’énergie. A défaut pour le producteur de disposer personnellement de cette autorisation, le PPA pourra désigner un producteur ou un fournisseur tiers titulaire de cette autorisation. Il s’agit de s’assurer qu’une personne, autre que le consommateur final ayant conclu le PPA, assume les obligations qui incombent aux fournisseurs d’électricité et de gaz, notamment en matière de sécurité d’approvisionnement. Nous précisons que cette obligation trouvera à s’appliquer dans le cadre des opérations d’autoconsommation collective^4, s’agissant des contrats conclus entre les producteurs et les consommateurs participant à ces opérations.
Par ailleurs, le législateur a expressément prévu la possibilité pour les acheteurs soumis au code de la commande publique de recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables^5 ou en gaz renouvelable (dont le biogaz et le gaz bas-carbone)^6 dans le cadre d’un PPA, mais également dans celui d’une opération d’autoconsommation individuelle^7 ou d’une opération d’autoconsommation collective^8.
Le législateur a souhaité sécuriser les acheteurs quant à la durée du contrat qu’ils pourront conclure, au regard des exigences de périodicité et de remise en concurrence posées par le code de la commande publique. En ce sens, les nouveaux articles L. 331-5 et L. 441-6 du code de l’énergie disposent que « la durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations ».
Si certaines interrogations relatives à la passation de ces contrats, en particulier les marges de manœuvre dont disposeront les acheteurs dans la détermination de leurs besoins^9 en matière d’achat d’énergie^10, ont été discutées lors de l’examen du texte, certaines demeurent en suspens.
A cet égard, ont été rejetés au motif qu’ils constituaient une entorse au droit européen et au droit de la commande publique plusieurs amendements qui tendaient à inscrire dans la loi qu’un acheteur pouvait contracter de gré à gré avec les producteurs participant à une opération d’autoconsommation collective lorsqu’il n’existe qu’une seule opération dans son périmètre^11. A tout le moins pouvons nous en déduire qu’un acheteur ne peut privilégier, en qualité de consommateur d’énergie, une participation à une opération d’autoconsommation collective au détriment de la conclusion d’un PPA pour lequel l’éloignement des sites de production et de consommation est indifférent.
En revanche, les acheteurs devront-ils mettre en concurrence, au travers d’une même procédure de passation portant sur l’achat d’énergie, d’une part, des producteurs susceptibles de participer à une opération d’autoconsommation collective ou à un PPA avec, d’autre part, des fournisseurs d’énergie classiques ? Car si les contrats susceptibles d’être passés avec ces différents acteurs répondent à un besoin commun, l’achat d’énergie, leur structure est susceptible de différer sensiblement. En effet, les PPA reposent sur la passation de contrats de longue durée, alors que les contrats conclus avec des fournisseurs d’énergie sont soumis à l’exigence de remise en concurrence périodique.
1 Précisons également que le législateur a également modifié plusieurs dispositions du code général des impôts afin de faire bénéficier les PPA – uniquement ceux portant sur la vente d’électricité, à l’exclusion de ceux portant sur la vente de gaz – d’un régime fiscal avantageux.
2 Principalement lorsque le PPA repose sur la réalisation d’une installation de production nouvelle. La conclusion d’un PPA, de plus courte durée, est notamment envisageable s’agissant de la vente de la production d’énergie d’une installation existante (par exemple, au sortir du bénéfice des mécanismes de soutien public).
3 V. notamment les modifications apportées aux articles L. 311-12, L. 314-4, L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 du code de l’énergie.
4 Une opération d’autoconsommation collective nécessite la conclusion de contrats de vente de l’énergie entre les producteurs et les consommateurs participant à l’opération ; v. également le sous-amendement n° 3192 déposé en première lecture devant l’Assemblée Nationale.
5 Code de l’énergie, article L. 331-5 (nouveau).
6 Code de l’énergie, article L. 441-6 (nouveau).
7 Uniquement en matière d’électricité.
8 Précisons que l’article 100 de la loi n° 2023-175 instaure un dispositif d’autoconsommation collective étendue en gaz renouvelable, similaire à celui existant déjà pour l’autoconsommation collective étendue en électricité, en créant les articles L. 448-1 et suivants dans le code de l’énergie.
9 V. notamment CE, 28 janvier 2013, Département du Rhône, req. n° 356670.
10 Notamment lorsque l’acheteur n’acquerra pas l’installation de production et que le contrat portera uniquement sur l’achat d’énergie.
11 V. par exemple l’amendement n° 1066 déposé en première lecture devant l’Assemblée Nationale et Assemblée Nationale, première séance publique du jeudi 15 décembre 2022 ; v. dans le même sens l’amendement n° 729 déposé en première lecture devant l’Assemblée Nationale et Assemblée Nationale, deuxième séance publique du jeudi 15 décembre.
-

La consigne des bouteilles en plastique ou la synthèse du paradoxe de notre époque
Par Baptiste JAFFRE, Avocat collaborateur
Le 28/02/2023
La consigne signe-t-elle son retour ? Voici un peu la question que chacun des acteurs de la filière du recyclage peut se poser. En effet, et depuis l’introduction en force par le gouvernement, au passage contre l’avis des associations d’élus et des promesses formulées par le premier ministre de l’époque Edouard Philippe, des dispositions figurant à l’article 66 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite aussi loi « anti gaspi », la consigne plane au-dessus de la filière du recyclage et en particulier, pour ce qui nous concerne directement, de l’économie des centres de tri.
Pour rappel, la France s’est fixé l’objectif ambitieux d’atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77% en 2025 et 90% en 2029. Ainsi, le nouvel article L.541-10-11 du code de l’environnement dispose notamment que :
« Au vu de ces bilans annuels et si les performances cibles ne sont pas atteintes, le Gouvernement définit après la publication du bilan réalisé en 2023, après évaluation des impacts économiques et environnementaux et concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités en charge du service public des déchets, les modalités de mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. Ce bilan environnemental est rendu public. »
Brandie par certains comme la solution à l’éternelle problématique de la captation du gisement, la consigne consiste à ajouter au prix payé par le consommateur une certaine somme qui lui est ensuite restituée lorsqu’il rapporte le contenant du bien consommé. Classiquement on distingue deux types de consigne : la consigne pour réemploi et la consigne pour recyclage en fonction du degré de réutilisation du contenant (le verre une fois lavé peut être réutilisé ce qui n’est pas systématiquement le cas pour les contenants en plastique). Il est intéressant de relever que la mise en place de la consigne est d’un côté fortement plébiscitée par plusieurs grands groupes industriels de la boisson et à l’inverse largement décriée par les élus locaux.
Pour ne citer que lui, on pourra rappeler l’avis du Cercle National du Recyclage de février 2021 dans le cadre des travaux menés par l’ADEME sur la consigne pour réemploi et recyclage des bouteilles de boissons :
« En premier lieu, le Cercle National du Recyclage souhaite rappeler son opposition totale sur les dispositifs de consigne des bouteilles de boisson en plastique ».
Des mots forts qui témoignent de la crainte des élus qui voient dans la consigne un risque majeur pour l’économie des centres de tri eu égard à l’importance du PET (polytéréphtalate éthylène) dans l’équilibre économique du service public du tri des déchets a fortiori dans un contexte de pénurie des matières premières. Il est permis de se demander s’il n’y aurait pas comme un anachronisme dans la mesure où les élus locaux qui ont été poussés tout au long de ces dernières années à investir massivement pour optimiser le tri de leurs déchets. A l’heure de l’extension des consignes de tri, la consigne viendrait pénaliser sévèrement les collectivités et en particulier celles qui ont le plus investi pour la modernisation de leur centre de tri, en les privant d’une partie sensible d’un gisement particulièrement rentable.
Mais les grands perdants ne seraient pas les collectivités mais bien les contribuables locaux. Mécaniquement, la perte des recettes liées au traitement des bouteilles en plastique entrainant une modification des conditions économiques d’exploitation du service public du tri des déchets va devoir être compensée par un accroissement de la fiscalité locale.
Les contours des conséquences économiques réelles pour les collectivités demeurent encore assez flous. A cet égard, notons que du côté du gouvernement l’analyse des effets de la mise en place de la consigne se veut plus rassurante. En témoigne notamment la réponse au Sénat du Secrétariat d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire qui, sur la base du « rapport Vernier » ^1, soutient que « le modèle économique du service public de gestion des déchets n’était pas affecté par la mise en place de la consigne, les soutiens financiers de CITEO restant inchangés » ^2.
Pour les défenseurs de la consigne, l’incitation financière des consommateurs est visiblement l’une des clefs de la réussite de la consigne. Dès lors, plutôt que de favoriser le consommateur au détriment du contribuable la question qui se pose est en réalité celle de la mise en place d’une tarification incitative pour améliorer la proportion de tri des déchets.
Enfin, et plus largement, le débat autour de la consigne ne devrait pas faire perdre de vue l’enjeu autour de la diminution du recours aux emballages plastiques. Or en monétisant dans l’esprit du consommateur le geste de tri, on peut s’interroger sur la pertinence de la consigne et sur le risque de voir se pérenniser l’utilisation du plastique devenu dans l’imaginaire collectif subitement, mais artificiellement, plus « vert ».
^1 Pré-rapport sur la consigne – Jacques VERNIER, 11 septembre 2019
^2 Réponse du Secrétariat d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 05/12/2019 – page 6044
-

Marché public : l’intangibilité du décompte général fait échec à la conclusion d’une transaction
Par Alizée GEBRE, Avocate collaboratrice
Le 21/02/2023
Le caractère intangible du décompte général limite les possibilités pour les parties de conclure une transaction sans contrevenir au principe d’interdiction des personnes publiques de consentir des libéralités.
Récemment, la CAA de Marseille a jugé que constituait une libéralité la conclusion d’une transaction relative aux difficultés d’exécution d’un marché public de travaux alors que le décompte général était devenu définitif (CAA de Marseille, 9 janvier 2023, req. n°21MA02813).
Pour rappel, le décompte général et définitif clôt l’exécution juridique et financière du marché (principe régulièrement rappelé par la jurisprudence, voir par exemple : CE, 5 décembre 1984, req. n°28469 ; CE, 6 novembre 2013, région Auvergne, req. n°361837). En conséquence, les Parties ne sont plus fondées à émettre de réclamations liées à l’exécution du marché une fois le décompte général devenu définitif.
Le juge administratif avait déjà écarté la possibilité pour le titulaire d’un marché d’émettre une réclamation après que le décompte soit devenu définitif au motif que la renonciation de la personne publique à se prévaloir de l’intangibilité du décompte n’était pas caractérisée (CAA de Lyon, 4 juillet 2013, req. n°12LY02389). Cet arrêt semblait laisser la porte ouverte à une possible renonciation par les parties au caractère intangible du décompte postérieurement à l’intervention du décompte général et définitif.
La CAA de Marseille ne va pas dans le sens d’une telle interprétation et rejette cette possibilité sur le fondement de l’interdiction des personnes publiques de consentir une libéralité.
Cela s’explique. L’indemnisation du préjudice par la personne publique de son cocontractant, alors que le caractère intangible du décompte général privait ce dernier de tout fondement juridique pour émettre une réclamation, ne pouvait que constituer une libéralité.
Cela étant, le caractère intangible du décompte général connaît certaines limites en fonction du contenu du décompte :
- le décompte général n’est définitif qu’en ce qui concerne les éléments qui n’ont pas fait l’objet de réserves (CE, 28 mars 2022, Commune de Sainte-Flaive-des-Loups, req. n°450477) ;
- le maître d’ouvrage peut appeler en garantie le titulaire du marché après l’intervention du décompte général et définitif ; sauf si le litige pouvait avoir été anticipé au moment de l’élaboration du décompte et faire l’objet d’une réserve (CE, 13 novembre 2019, société Denu et Paradon Architectes, req. n°422924 ; CE, 6 mai 2019, Société Icade Production, req. n° 420765).
Ainsi, les aspects du marché public de travaux n’ayant pas été réglés de manière définitive par le décompte général devraient encore pouvoir faire l’objet d’une transaction, sans entraîner automatiquement la caractérisation d’une libéralité.
Quelques précautions à suivre pour conclure une transaction relative au décompte général
En pratique, l’attention des parties souhaitant conclure une transaction pour régler les aspects financiers du marché est attirée sur les points suivants :
- la transaction doit être conclue avant que le décompte général ne devienne définitif ou porter sur des éléments n’ayant pas été réglés par le décompte général ;
- il convient d’être particulièrement vigilant sur les délais d’établissement du décompte pour éviter l’intervention d’un décompte général et définitif tacite ;
- la transaction doit permettre aux parties, conformément aux termes de l’article 2044 du code civil, de terminer une contestation née ou de prévenir une contestation à naître. Aussi, la transaction doit être précédée de la reconnaissance d’un différend, qui peut se matérialiser par la réclamation du titulaire sur le projet de décompte général du maître d’ouvrage, ou permettre un règlement amiable pour résilier le marché (pour une illustration : CAA de Marseille, 16 juillet 2012, req. n°09MA00879) ;
- par ailleurs, il est rappelé que le principe d’intangibilité du décompte général et définitif n’est pas d’ordre public (CE, 3 novembre 2014, société Bancillon BTP, req. n°372040) et que les parties peuvent toujours choisir d’y déroger au stade de la rédaction du contrat.
-
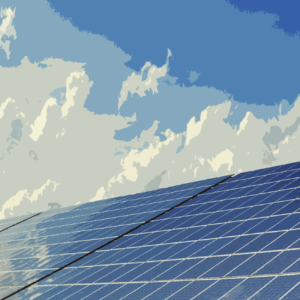
Les principales dispositions de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
Par Benoît PERRINEAU, Avocat associé
Le 13/03/2023
La loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a été publiée au Journal Officiel le samedi 11 mars dernier. Elle comprend de très nombreuses dispositions qui modifient le régime applicable aux installations d’énergies renouvelables. A titre d’illustration, et sans prétendre ici à l’exhaustivité, voici quelques évolutions introduites par ce texte :
- Zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergie renouvelable : des zones doivent être identifiées sur proposition et ensuite avis conforme des communes d’implantation. Elles pourront être intégrées dans les documents d’urbanisme ;
- Solaire :
Document-cadre : un document-cadre doit être établi par le préfet identifiant les zones ouvertes aux projets photovoltaïques. Seuls les projets agrivoltaïques pourront être réalisés en dehors des zones définies par ces documents ;
Secteurs nouvellement ouverts aux projets : des dispositions sont introduites de façon à faciliter la réalisation des projets photovoltaïques dans les zones situées aux abords des grands axes routiers, aux abords des voies ferrées, dans les communes littorales (par dérogation à la règle d’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants) ;
Parkings : les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m² doivent être équipés, sur la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables ;
Bâtiments publics, bâtiments d’activités et bâtiments commerciaux d’une emprise supérieure à 500 m² : ils doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
- Agrivoltaïsme: un cadre juridique spécifique est mis en place afin de faciliter le développement des projets agrivoltaïques ;
- Eoliennes: la délivrance des autorisations environnementales doit désormais tenir compte, le cas échéant, du nombre d’installations déjà existantes sur le territoire concerné, afin de prévenir les effets de « saturation visuelle » ;
- Dérogations à l’interdiction de destruction des espèces protégées : les projets d’installations de production d’énergies renouvelables sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (qui est une condition de délivrance de ces dérogations), dès lors qu’ils répondent à certaines conditions définies par décret en Conseil d’Etat ;
- Plan de valorisation du foncier par les entreprises : les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif est supérieur à 250 salariés au 1er janvier 2023 doivent établir un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables, avant le 10 mars 2025 ;
- Autorisations environnementales : le régime des autorisations environnementales portant sur la réalisation de projets EnR est modifié sur différents aspects. Les règles contentieuses évoluent également ;
- Power Purchase Agreement (PPA) : un cadre juridique aux contrats de vente directe d’énergie (électricité et gaz) entre un producteur et un consommateur final est fixé par la loi ;
- Commande publique : des dispositions sont introduites afin de simplifier le recours à l’autoconsommation par les collectivités.
